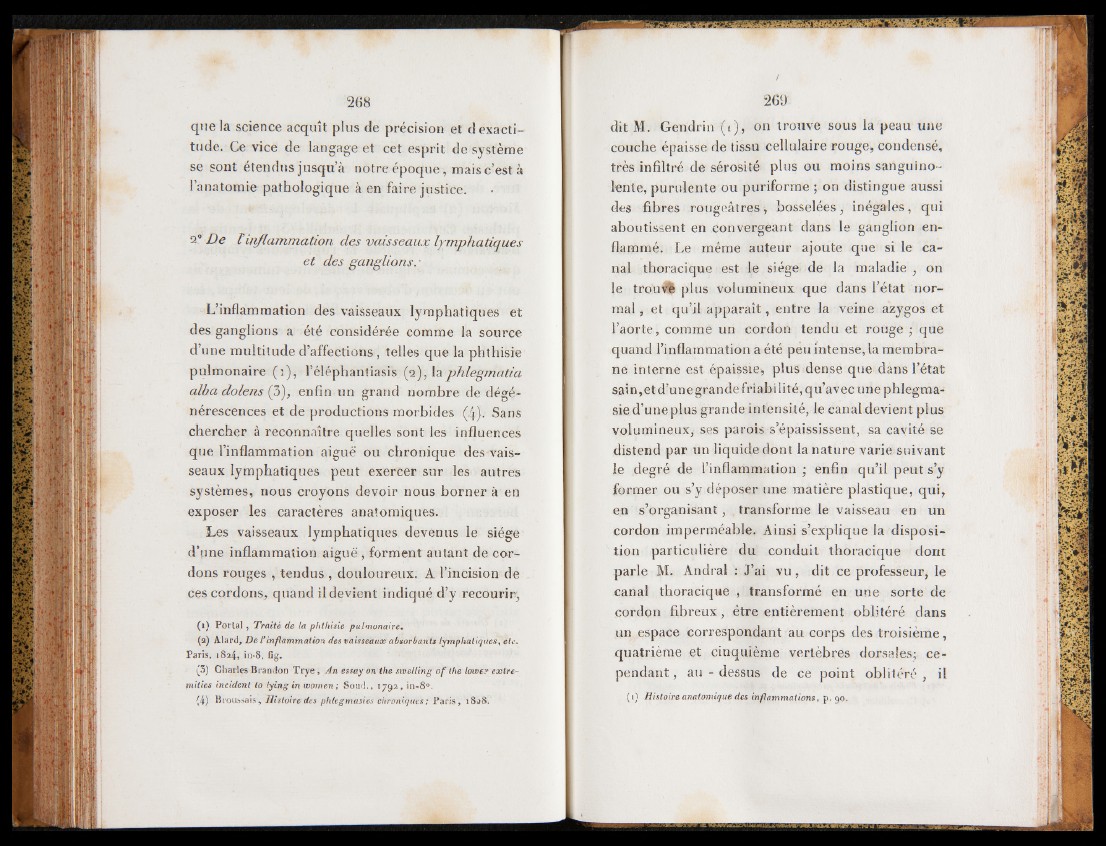
que la science acquît plus de précision et d exactitude.
Ce vice de langage et cet esprit de système
se sont étendus jusqu’à notre époque , maisc’està
l’anatomie pathologique à en faire justice.
2° De ïinflammation des vaisseaux lymphatiques
et des ganglions. •
L’inflammation des vaisseaux lymphatiques et
des ganglions a été considérée comme la source
d’une multitude d’affections, telles que la phthisie
pulmonaire (;), l’éléphantiasis (2), laphlegmatia
alba dolens (3), enfin un grand nombre de dégénérescences
et de productions morbides (4). Sans
chercher à reconnaître quelles sont les influences
que l’inflammation aiguë ou chronique desvais-
seaux lymphatiques peut exercer sur les autres
systèmes, nous croyons devoir nous borner à en
exposer les caractères anatomiques.
Les vaisseaux lymphatiques devenus le siège
d’une inflammation aiguë, forment autant de cordons
rouges , tendus , douloureux. A l’incision de
ces cordons, quand il devient indiqué d’y recourir, 1 *3
(1) Portai , Traité de la phthisie pulmonaire.
(a) Alaro, De l’ inflammation des vaisseaux absorbants lymphatiques, etc.
Paris, 1824, in-8, fig.
[3) Charles Brandon Trye , An essay on the swelling of the lower extremities
incident to lying in women ; Soud., 1792, in-8°.
{4) Broussais, Histoire des phlegmasies chroniques ; Parts, 1808.
dit M. Gendrin (1), on trouve sous la peau une
couche épaisse de tissu cellulaire rouge* condensé,
très infiltré de sérosité plus ou moins sanguinolente,
purulente ou puriforme ; on distingue aussi
des fibres rougeâtres * bosselées, inégales, qui
aboutissent en convergeant dans le ganglion enflammé.
Le même auteur ajoute que si le canal
thoracique est le siège de la maladie , on
le trouvé plus volumineux que dans l’état normal
, et qu’il apparaît, entre la veine azygos et
l’aorte, comme un cordon tendu et rouge ; que
quand l’inflammation a été peu intense, la membrane
interne est épaissie* plus dense que dans l’état
sain,et d’unegrandefriabilité,qu’avec unephlegma-
sie d’une plus grande intensité, le canal devient plus
volumineux, ses parois s’épaississent, sa cavité se
distend par un liquide dont la nature varie suivant
le degré de l’inflammation ; enfin qu’il peut s’y
former ou s’y déposer une matière plastique, qui,
en s’organisant, transforme le vaisseau en un
cordon imperméable. Ainsi s’explique la disposition
particulière du conduit thoracique dont
parle M. Andral : J’ai vu , dit ce professeur, le
canal thoracique , transformé en une sorte de
cordon fibreux, être entièrement oblitéré dans
un espace correspondant au corps des troisième,
quatrième et cinquième vertèbres dorsales; cependant
, au - dessus de ce point oblitéré , il
(t) Histoire anatomique des inflammations, p. 90.