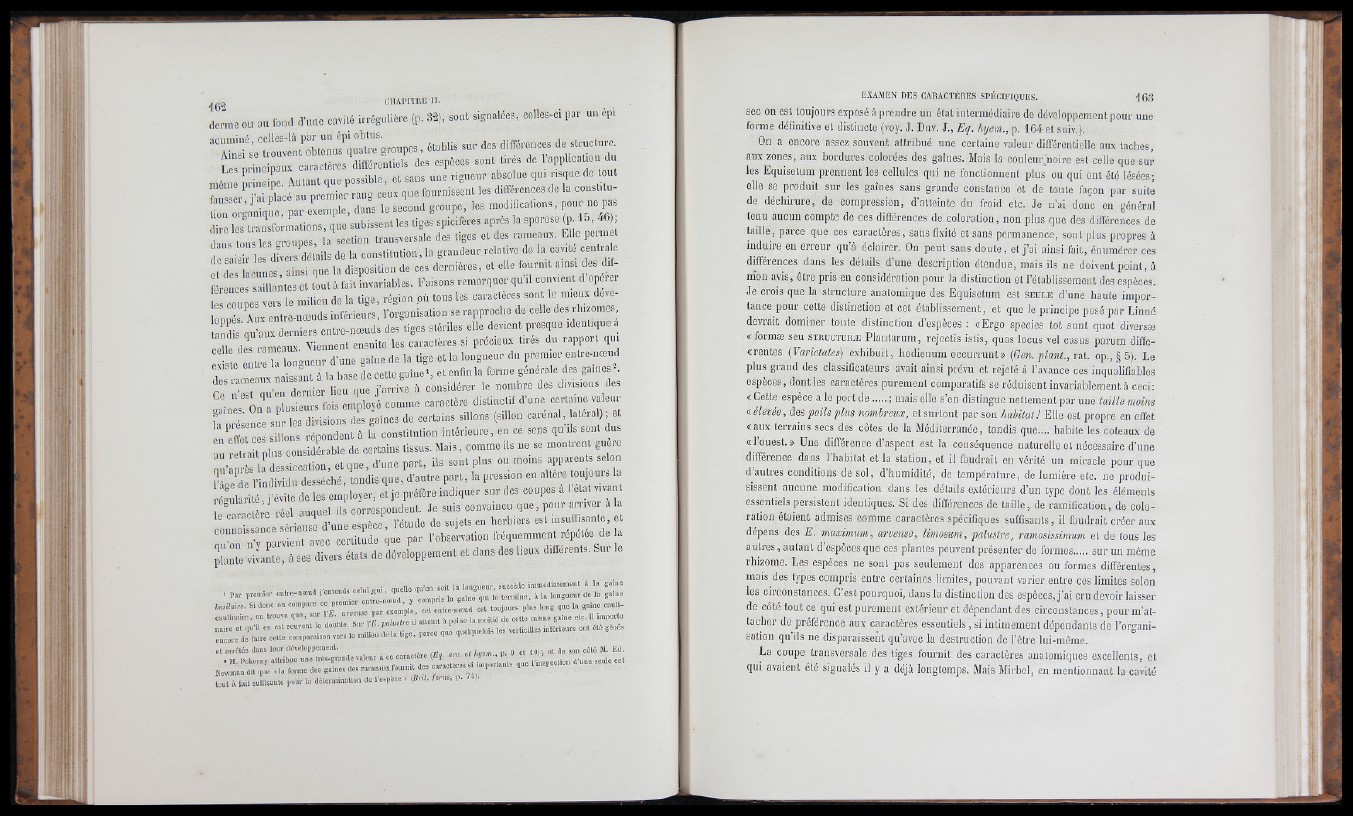
d e l e ou au fond d’uno cavité irrégulière (p. 32), sont signalées, celles-ci par un épi
1 11 confirm trnnsversalc des ti^es et des rameauN. Flie pcimet
i : d S f o i : : " : u X n , la gran^ur re,atlve de la ca.té rantrafo
i d l h c le s ainsi que la disposition de ces dernières, et elle fourn.t a.nst es différences
saillantes et tout à fait invariables. Faisons remarquer qu il convient opeiei
les coupes vers le milieu de la tige, région où tous les caracteres sont le mieux deve-
lonpés Aux entre-noeuds inférieurs, l’organisation se rapproche de celle des rhizomes,
n i ou taux derniers entre-noeuds des tiges stériles elle devient presque tdonl.que a
celle des rameaux. Viennent ensuite les caractères si précieux tires du rapport qui
existe entre la longueur d’une gaine de la tige et la longueur du premier entre-noeud
. rnissint à la base de cette gaîne^ et enfmla forme générale des gaines .
■ L a ninsieurs fois employé comme caractère distinctif d’une certaine valeur
r : i e l e s u l r l - i i s l s gaines de certains sillons (sillon caréna,, latéral) ; et
en effet ces sillons répondent à la constitution intérieure, en ce sens qu ils sont dus
au retrait plus considérable de certains tissus. Mais, comme ils ne se montrent guere
uu’ près l i dessiccation, et que, d’une part, ils sont plus ou moms apparents selon
V' a» l’individu desséché tandis que, d’autre part, la pression en altere toujouis la
rénularilé j ’évite de les employer, et je préfère indiquer sur des coupes à l’état vivant
le raraclèi'o réel auquel ils correspondent. Je suis convaincu que, pour arrivet la
le caiacleio lee^ i uisufCsanto, el
¡ X i ' n ’yTarvient »''eo certitude que par l’observation fréquemment répétée de la
¿ante vivace, à ses divers étals de développement et dans des beux différents. Su.
, r „ , e „ i . -”r6r;'Crs:;r:“7i:77“ 6»,-taire. Si do» on comtare t '™ ” j tonjonrs plue long qno la gaine caulicanllnau
e, on Irouvo quo, » ^ ¡.„[„e etc. 11 importe
i r l t l r c l t e r p l t o n L e .0 mlllou Í la tige, paroc que quclquoto.s lus vortlcdlce Intérieure ont élu géuee
cl arrêtes dans leur dévoloppemenl. , g . „i gg son oôté M. Ed.
toul à tait suffisante pour la déterniinaüon do l'ospôoo . [Bnt. /«r«. P- 7o).
sec on est toujours exposé à prendre un état intermédiaire de développement pour une
forme définitive et distincte (voy. J. Duv. J., Eij. hyem., p. 164 et suiv.).
On a encore assez souvent attribué une certaine valeur différentielle aux taches,
aux zones, aux bordures colorées des gaînes. Mais la couleur (noire est celle que sur
les Equisetum prennent les cellules qui ne fonctionnent plus ou qui ont été lésées;
elle se produit sur les gaînes sans grande constance et de toute façon par suite
de déchirure, de compression, d’atteinte du froid etc. Je n’ai donc en général
tenu aucun compte de ces différences de coloration, non plus que des différences de
taille, parce que ces caractères, sans fixité et sans permanence, sont plus propres à
induire en erreur qu’à éclairer. On peut sans doute, et j ’ai ainsi fait, énumérer ces
différences dans les détails d’uno description étendue, mais ils ne doivent point, à
mon avis, être pris en considération pour la distinction et l’établissement des espèces.
Je crois que la structure anatomique des Equisetum est s e u l e d’une haute importance
pour cette distinction et cet établissement, et que le principe posé par Linné
devrait dominer toute distinction d’espèces : «Ergo species lot sunt quot diversæ
«formæ seu s t r u c t u r æ Plantarum, rejectis istis, quas locus vel casus parum diffe-
«rentes (Varietates) exhibuit, hodienum occurrunt» (Gen. plant., ral. op., § 5). Le
plus grand des classificateurs avait ainsi prévu et rejeté à l ’avance ces inqualifiables
espèces, dont les caractères purement comparatifs se réduisent invariablement à ceci:
« Celte espèce a le port de ; mais elle s’en distingue nettement par une taille moins
«élevée, des poils plus nombreux, et surtout parson habitat! Elle est propre en effet
«aux terrains secs des côtes de la Méditerranée, tandis que.... habite les coteaux de
« l ’ouest.» Une différence d’aspect est la conséquence naturelle et nécessaire d’une
différence dans l’habitat et la station, et il faudrait en vérité un miracle pour que
d’autres conditions de sol, d’humidité, de température, do lumière etc. ne produisissent
aucune modification dans les détails extérieurs d’un type dont les éléments
essentiels persistent identiques. Si des différences de taille, de ramification, de coloration
étaient admises comme caractères spécifiques suffisants, il faudrait créer aux
dépens des E. maximum, arvense, limosum, palustre, ramosissimum et do tous les
autres, autant d’espèces que ces plantes peuvent présenter de formes sur un même
rliizome. Les espèces ne sont pas seulement des apparences ou formes différentes,
mais des types compris entre certaines limites, pouvant varier entre ces limites selon
les circonstances. C’est pourquoi, dans la distinction des espèces, j ’ai cru devoir laisser
de côté tout ce qui est purement extérieur et dépendant des circonstances, pour m’attacher
de préférence aux caractères essentiels, si intimement dépendants de l ’organisation
qu’ils ne disparaissent qu’avec la destruction de l’être lui-même.
La coupe transversale des tiges fournit des caractères anatomiques excellents, et
qui avaient été signalés il y a déjà longtemps. Mais Mirbel, en mentionnant la cavité