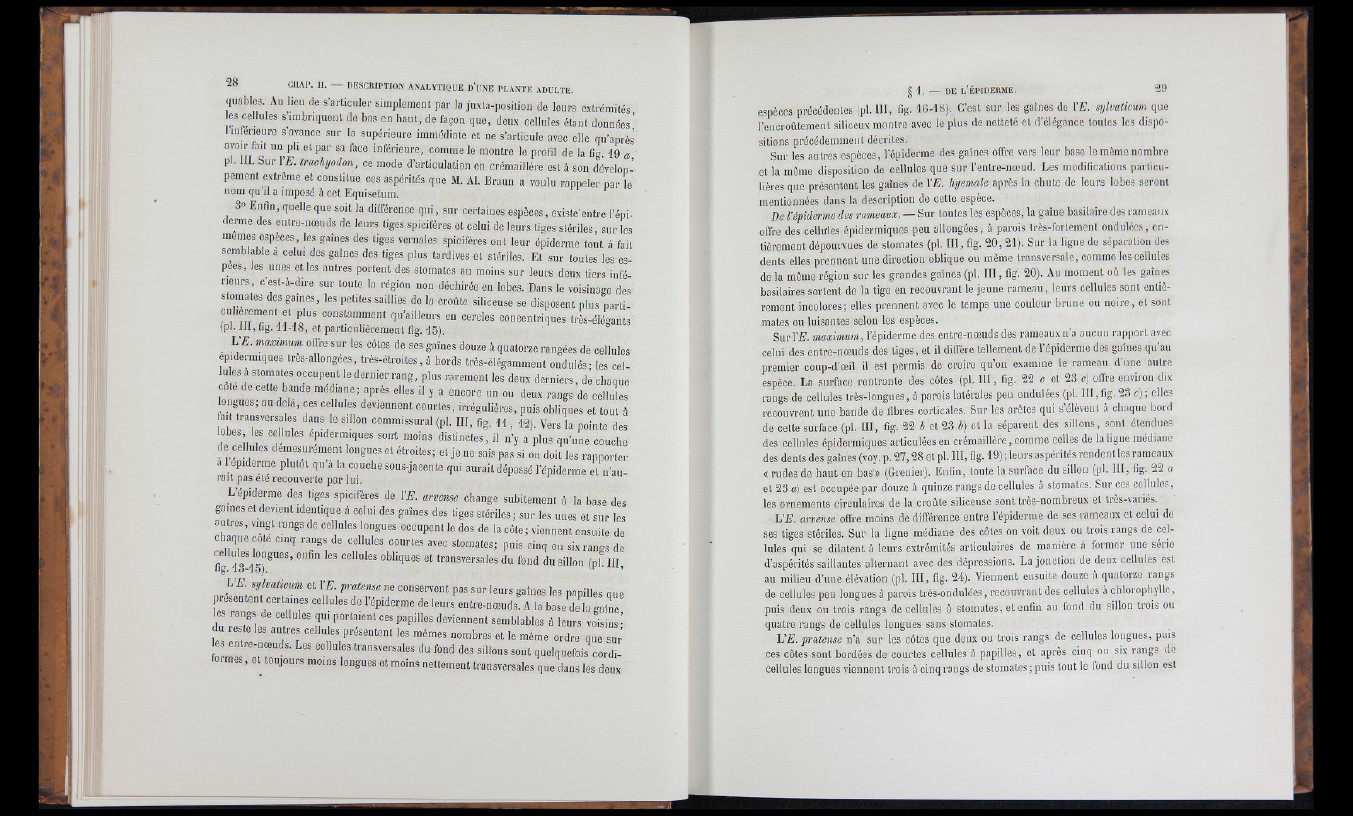
quables. Au lieu de s’arliculer simplement par la juxta-posilion do leurs extrémités
es cellules sbmbnquent de bas en haut, de façon que, deux cellules étant données’
1 inférieure s’avance sur la supérieure immédiate et ne s’articule avec elle qu’après
avoir fait un pli et par sa face inférieure, comme le montre le profil de la fi». 19 a
pl. III. Sur 1 E. trachyodon, ce mode d’articulation en crémaillère est à son develop '
pement extrême et constitue ces aspérités que M. Al. Braun a voulu rappeler par le
nom qu il a imposé à cet Equisetum.
3» Enfin, quelle que soit la différence qui, sur certaines espèces, existe’entre l’épi-
clerme des entre-noeuds de leurs tiges spicifères et celui de leurs tiges stériles sur les
memes espèces, les gaînes des tiges vernales spicifères ont leur épiderme tout à fait
semblable a celui des gaînes des tiges plus tardives et stériles. E t sur toutes les es-
pees, les unes elles autres portent des stomates au moins sur leurs deux tiers inférieurs
, c est-à-dire sur toute la région non déchirée en lobes. Dans le voisinage des
stomates des gaines, les petites saillies de la croûte siliceuse se disposent plus particulièrement
et plus constamment qu’ailleurs en cercles concentriques très-élégants
(pl. I I I , fig. 11-18, et particulièrement fig. 15).
^ L ’B. maximum offre sur les côles de ses gaînes douze à quatorze rangées de cellules
epidermiques très-allongées, très-étroites, à bords très-élégamment ondulés - les cellules
a stomates occupent le dernier rang, plus rarement les deux derniers, d^ chaque
cote de cette bande med.ane; après elles il y a encore un ou deux rangs de cellules
ongues; au delà, ces cellules deviennent courtes, irrégulières, puis obliques et tout à
ait transversales dans le sillon commissural (pl. 111, fig. H , 12). Vers la pointe des
lobes les cellules epidermiques sonl moins distinctes, il n’y a plus qu’une couche
de cellules démesurément longues et étroites; et je ne sais pas si on doit les rapporter
a 1 epideime plutôt qu a la couche sous-jacente qui aurait dépassé l ’épiderme et n’au-
lait pas ete recouverte par lui,
L ’épiderme des tiges spicifères de l’B . arvcmc change subitement à la base des
gaines et devient identique à celui des gaînes des tiges stériles ; sur les unes et sur les
autres, vingt rangs de cellules longues occupent le dos de la côte; viennent ensuite de
chaque cote cinq rangs de cellules courtes avec stomates; puis cinq ou six rangs de
cemfiesfongues, enfin les cellules obliques et transversales du fond du sillon (pi I I I ,
L ’B sylvaticum et l’B . pratense ne conservent pas sur leurs gaînes les papilles que
131 esentent certaines cellules de Tépiderme de leurs enlre-noeuds. A la base de la »aîné
es rangs de cellules qui portaient ces papilles deviennent semblables à leurs voisins ■
du reste les autres cellules présentent les mêmes nombres et le même ordre que sui-
es entre-noeuds. Les cellules transversales du fond des sillons sont quelquefois cordi-
rraes, et toujours moins longues et moins nettement transversales que dans les deux
espèces précédentes (pl. 111, fig. 16-18). C’est sur les gaînes de TB. sylvaticum que
l’encroûtement siliceux montre avec le plus de netteté et d’élégance toutes les dispositions
précédemment décrites.
Sur les autres espèces, Tépiderme des gaînes offre vers leur base le même nombre
et la même disposition de cellules que sur Tentre-noeud. Les modifications particulières
que présentent les gaines de TB. hyemale après la chute de leurs lobes seront
mentionnées dans la description de cette espèce.
De Tépiderme des rameaux. — Sur toutes les espèces, la gaîne basilaire des rameaux
offre des cellules épidermiques peu allongées, à parois très-fortement ondulées, entièrement
dépourvues de stomates (pl. I I I , fig. 20, 21). Sur la ligne de séparation des
dents elles prennent une direction oblique ou même transversale, comme les cellules
de la même région sur les grandes gaînes (pl. I l l , fig. 20). Au moment où les gaînes
basilaires sortent de la tige en recouvrant le jeune rameau, leurs cellules sont entièrement
incolores; elles prennent avec le temps une couleur brune ou noire, et sont
mates ou luisantes selon les espèces.
SurTB. maximum, Tépiderme des enlre-noeuds des rameauxn’a aucun rapport avec
celui des entre-noeuds des tiges, et il diffère tellement de Tépiderme des gaînes qu’au
premier coup-d’oeil il est permis de croire qu’on examine le rameau d'une autre
espèce. La surface rentrante des côtes (pl. I I I , fig. 22 c et 23 c) offre environ dix
rangs de cellules très-longues, à parois latérales peu ondulées (pl. I I I , fig. 23 c) ; elles
recouvrent une bande de fibres corticales. Sur les arêtes qui s’élèvent à chaque bord
de celte surface (pl. I I I , fig. 22 b el 23 b) et la séparent des sillons, sont étendues
des cellules épidermiques articulées en crémaillère, comme celles de la ligne médiane
des dents des gaînes (voy. p. 27,28 et pl. I I I , fig. 19) ; leurs aspérités rendent les rameaux
«rudes de haut en bas» (Grenier). Enfin, toute la surface du sillon (pl. I l l , fig. 22 a
et 23 a) est occupée par douze à quinze rangs de cellules à stomates. Sur ces cellules,
les ornements circulaires de la croûte siliceuse sont très-nombreux et très-variés.
L ’B. arvense offre moins de différence entre Tépiderme de ses rameaux et celui de
ses tiges stériles. Sur la ligne médiane des côtes on voit deux ou trois rangs de cellules
qui se dilatent à leurs extrémités articulaires de manière à former une série
d’aspérités saillantes alternant avec des dépressions. La jonction de deux cellules est
au milieu d’une élévation (pl. I I I , fig. 24). Viennent ensuite douze à quatorze rangs
de cellules peu longues à parois très-ondulées, recouvrant des cellules à chlorophylle,
puis deux ou trois rangs de cellules à stomates, et enfin au fond du sillon trois ou
quatre rangs de cellules longues sans stomates.
L ’B. pratense n’a sur les côtes que deux ou trois rangs de cellules longues, puis
ces côtes sont bordées de courtes cellules à papilles, et après cinq ou six rangs de
cellules longues viennent trois à cinq rangs de stomates ; puis tout le fond du sillon est