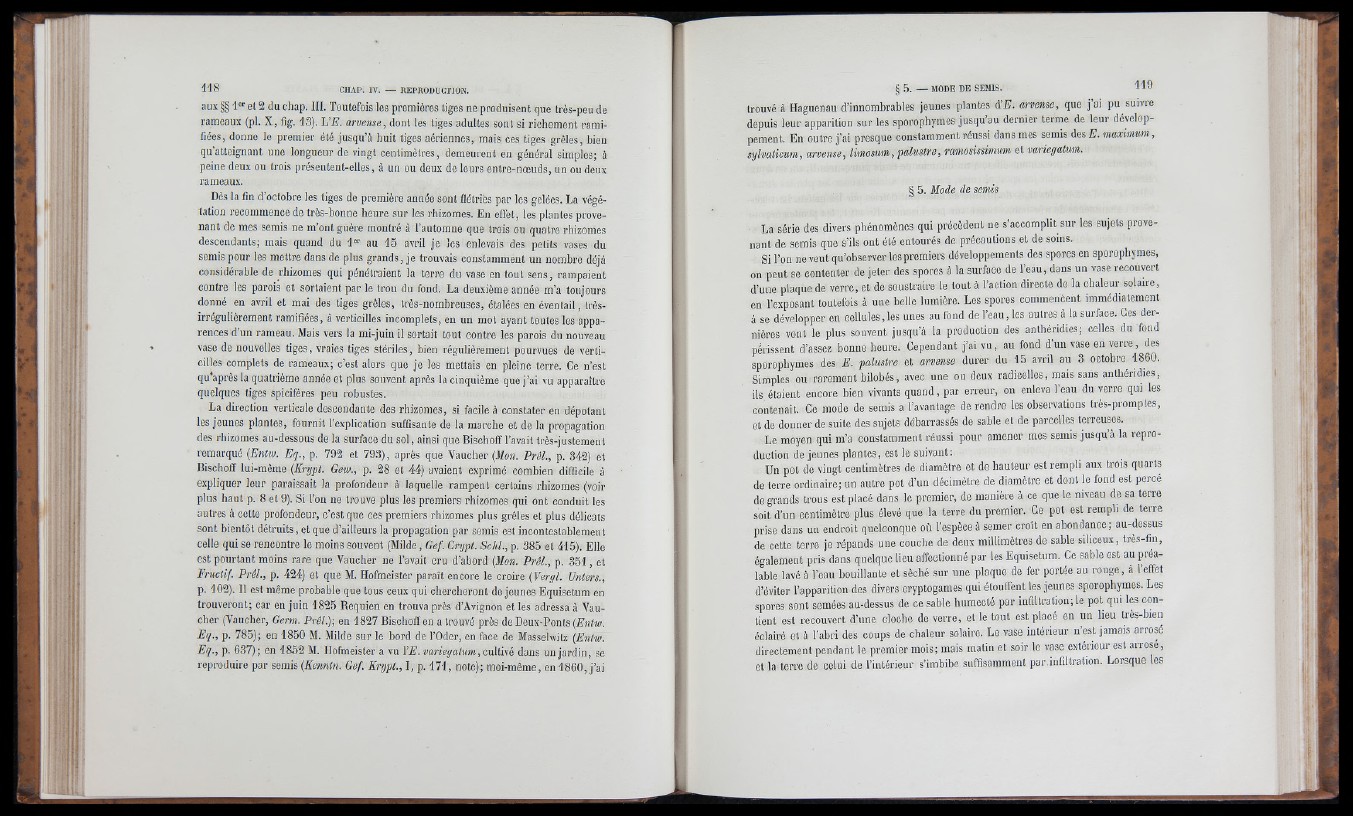
aux §§ 1 " et 2 du ehap. III . Toutefois les premières tiges ne produisent que très-peu de
rameaux (pl. X , fig. 13). L ’B . arvense, dont les tiges adultes sont si ricliement ramifiées,
donne le premier été jusqu’à huit tiges aériennes, mais ces tiges grêles, bien
qu’atteignant une longueur de vingt centimètres, demeurent en général simples; à
peine deux ou trois présentent-elles, à un ou deux de leurs entre-noeuds, un ou deux
rameaux.
Dès la fin d’octobre les tiges de première année sont flétries par les gelées. La végétation
recommence de très-bonne heure sur les rhizomes. En effet, les plantes provenant
de mes semis ne m’ont guère montré à l’automne que trois ou quatre rhizomes
descendants; mais quand du 1» au 15 avril je les enlevais des petits vases du
semis pour les mettre dans de plus grands, je trouvais constamment un nombre déjà
considérable de rhizomes qui pénétraient la terre du vase en tout sens, rampaient
contre les parois et sortaient par le trou du fond. La deuxième année m’a toujours
donné en avril et mai des tiges grêles, très-nombreuses, étalées en éventail, très-
irrégulièrement ramifiées, à verticilles incomplets, en un mot ayant toutes les apparences
d’un rameau. Mais vers la mi-juin il sortait tout contre les parois du nouveau
vase de nouvelles tiges, vraies tiges stériles, bien régulièrement pourvues de verticilles
complets de rameaux; c’est alors que je les mettais en pleine terre. Ce n’est
qu'après la quatrième année et plus souvent après la cinquième que j ’ai vu apparaître
quelques liges spicifères peu robustes.
La direction verticale descendante des rhizomes, si facile à constater en dépotant
les jeunes plantes, fournit l’explication suffisante de la marche et de la propagation
des rhizomes au-dessous de la surface du sol, ainsi que Bischoff l’avait très-justement
remarqué (Entw. Eq., p. 792 et 793), après que Vaucher (Mon. P r ê l, p. 342) et
Bischoff lui-même (Krypt. Gew., p. 28 et 44) avaient exprimé combien difficile à
expliquer leur paraissait la profondeur à laquelle rampent certains rhizomes (voir
plus haut p. 8 et 9). Si l’on ne trouve plus les premiers rhizomes qui ont conduit les
autres à cette profondeur, c’est que ces premiers rhizomes plus grêles et plus délicats
sont bientôt détruits, et que d’ailleurs ia propagation par semis est incontestablement
celle qui se rencontre le moins souvent (Milde, Gef. Crypl S c h l, p. 385 et 415). Elle
est pourtant moins rare que Vaucher ne l’avait cru d’abord (Mon. P r ê l, p. 351, et
F ructif P r ê l, p. 424) et que M. Hofmeister paraît encore le croire (Y ergl Enters.,
p. 102). I l est même probable que tous ceux qui chercheront de jeunes Equisetum en
trouveront; car en juin 1825 Requien en trouva près d’Avignon et les adressa à Vaucher
(Vaucher, Germ. Prêl); en 1827 Bischoff en a trouvé près de Deux-Ponts (Entw.
Eq., p. 785); en 1850 M. Milde sur le bord de l’Oder, en face de Masseiwitz (Entw.
Eq., p. 637); en 1852 M. Hofmeister a vu l’B . variegatum, cultivé dans un jardin, se
reproduire par semis (Kenntn. Gef. Krypt., I, p. 171, note); moi-même, cnl860, j ’ai
trouvé à Haguenau d’innombrables jeunes plantes d’B . arvense, que j ’ai pu suivre
depuis leur apparition sur les sporophymes jusqu’au dernier terme de leur développement.
En outre j’ai presque constamment réussi dans mes semis des E . maximum,
sylvaticum, arvense, limosum, palustre, ramosissimum et variegatum.
§ 5. Mode de semis
La série des divers phénomènes qui précèdent ne s’accomplit sur les sujets provenant
de semis que s’ils ont été entourés de précautions el de soins.
Si l’on ne veut qu’observer les premiers développements des spores en sporophymes,
on peut se contenter de jeter des spores à la surface de l’eau, dans un vase recouvert
d’une plaque de verre, et de soustraire le tout à l’action directe de la chaleur solaire,
en l’expo-sant toutefois à une belle lumière. Les spores commencent immédiatement
à se développer en cellules,les unes au fond de l’eau,les autres à la surface. Ces dernières
vont le plus souvent jusqu’à la production des anthèridies; celles du fond
périssent d’assez bonne heure. Cependant j ’ai vu, au fond d’un vase en verre, des
sporophymes des E. palustre et arvense durer du 15 avril au 3 octobre 1860.
Simples ou rarement bilobés, avec une ou deux radicelles, mais sans anthèridies,
ils étaient encore bien vivants quand, par erreur, on enleva l’eau du verre qui les
contenait. Ce mode de semis a l’avantage de rendre les observations très-promptes,
et de donner de suite des sujets débarrassés de sable et de parcelles terreuses.
Le moyen qui m’a constamment réussi pour amener mes semis jusqu’à la reproduction
de jeunes plantes, est le suivant:
Un pot de vingt centimètres de diamètre et de hauteur est rempli aux trois quarts
de terre ordinaire; un autre pot d’un décimètre de diamètre et dont le fond est perce
de grands trous est placé dans le premier, de manière à ce que le niveau de sa terre
soit d’un centimètre plus élevé que la terre du premier. Ce pot est rempli de terre
prise dans un endroit quelconque où l’espèce à semer croît en abondance; au-dessus
de celte terre je répands une couche de deux millimètres de sable siliceux, très-fin,
également pris dans quelque lieu affectionné par les Equisetum. Ce sable est au préalable
lavé à l’eau bouillante et séché sur une plaque de fer portée au rouge, à l’effet
d’éviter l’apparition des divers cryptogames qui étouffent les jeunes sporophymes. Les
spores sont semées au-dessus de ce sable humecté par infiltration; le pot qui les contient
est recouvert d’une cloche de verre, et le tout est placé en un lieu très-bien
éclairé et à l ’abri des coups de chaleur solaire. Le vase intérieur n’est jamais arrosé
directement pendant le premier mois; mais matin et soir le vase extérieur est arrose,
et la terre de celui de l’intérieur s’imbibe suffisamment par infiltration. Lorsque les