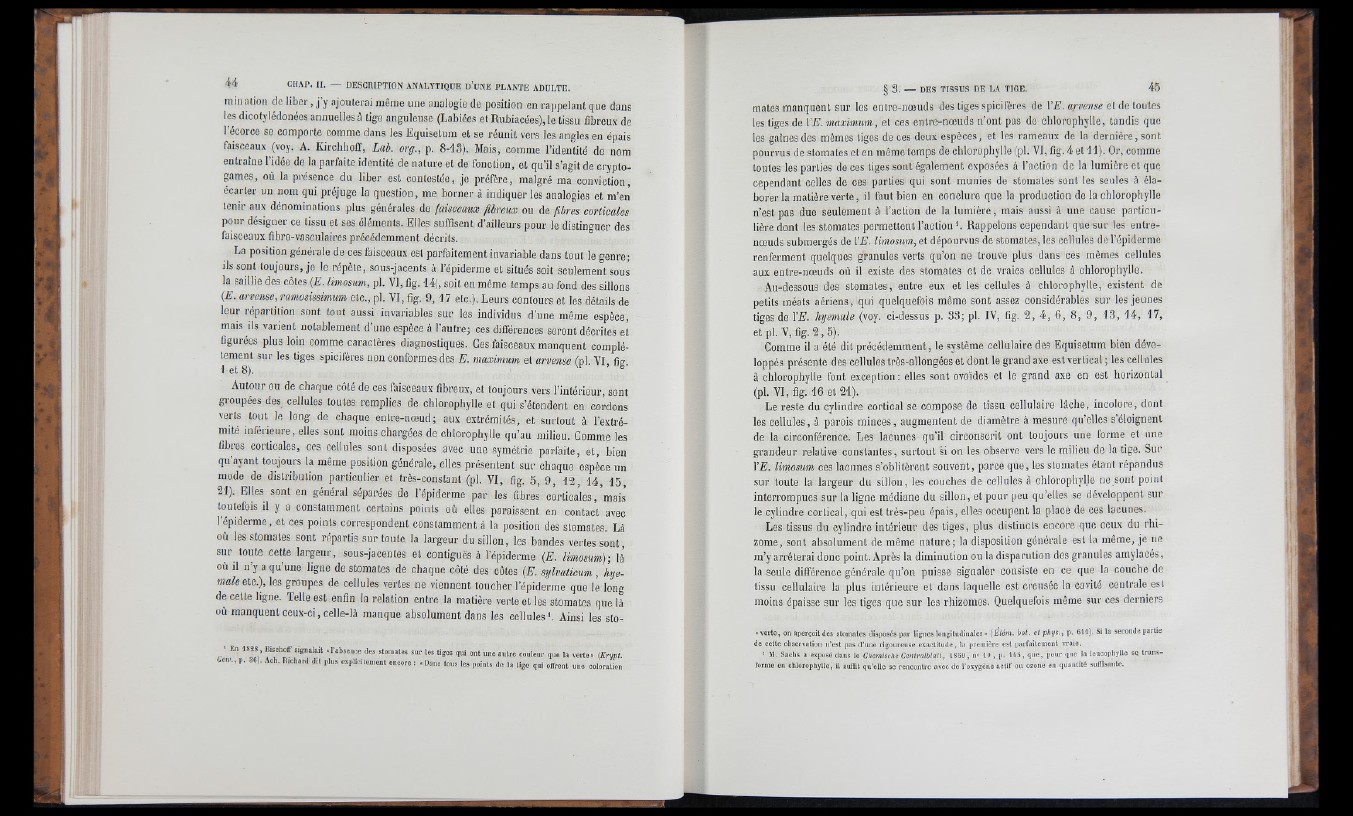
('■I
, : >1
miualioli de liber, j'y ajouterai même une analogie de position en rappelant que dans
les dicolylédonées annuelles à lige anguleuse (Labiées et Rubiacées), le tissu fibreux de
l’écorce se comporte comme dans les Equiselum el se réunit vers les angles en épais
faisceaux (voy. A. Kirchhoff, Lab. org., p. 8-13). Mais, comme l ’identité de nom
entraîne l’idée de la parfaite identité de nature et de fonction, el qu’il s’agit de cryptogames,
où la présence du liber e,st contestée, je préfère, malgré ma conviction,
ocarler un nom qui préjuge la question, me borner à indiquer les analogies et m’en
tenir aux dénominations plus générales de faisceaux fibreux ou de fibres corticales
pour désigner ce tissu et ses éléments. Elles suffisent d’ailleurs pour le distinguer des
faisceaux fibro-vasculaires précédemment décrits.
La posilion générale de ces faisceaux est parfaitement invariable dans tout le genre;
ils sont toujours, je le répète, sous-jacents à Tépiderme et situés soit seulement sous
la saillie des côtes (E. limosum, pl. VI, fig. 14), soit en même temps au fond des sillons
(E. arvense, ramosissimum etc., pl. VI, fig. 9. 17 etc.). Leurs contours et les détails de
leur répartition sont tout aussi invariables sur les individus d’une même espèce,
mais ils varient notablement d’une espèce à Tautre; ces différences seront décrites et
figurées plus loin comme caractères diagnostiques. Ces faisceaux manquent complètement
sur les tiges spicifères non conformes des E . maximum et arvense (pl VI fie
I et 8).
Autour ou de chaque côté de ces faisceaux fibreux, et toujours vers Tintérieur, sont
groupées des cellules toutes remplies de chlorophylle et qui s’étendent en cordons
verts tout le long de chaque entre-noeud; aux extrémités, et surtout à Textré-
mité inférieure, elles sont moins chargées de chlorophylle qu’au milieu. Comme les
fibres corticales, ces cellules sont disposées avec une symétrie parfaite, el, bien
qu’ayant toujours la même position générale, elles présentent sur chaque espèce un
mode de distribution particulier et trè.s-conslant (pl. V I , fig. 5, 9 , 1 2 , 1 4 , 15
21). Elles sont en général séparées de l ’épiderme par les fibres corticales, ’mais
toutefois il y a constamment certains points où elles paraissent en contact avec
Tépiderme, et ces points correspondent constamment à la position des stomates. Là
où les stomates sont répartis sur toute la largeur du sillon, les bandes vertes sont
sur toute cette largeur, sous-jacentes et contiguës à Tépiderme {E. limosum); là
où il n’y a qu’une ligne de stomates de chaque côté des côtes {E. sylvaticum , hyemale
etc.), les groupes de cellules vertes ne viennent toucher Tépiderme que le long
de cette ligne. Telle est enfin la relation entre la matière verte et les stomates que là
où manquent ceux-ci, celle-là manque absolument dans les cellules*. Ainsi les sto-
' =*8»!>lalt .l'absence des stomates sur les liges qui ont une autre couleur que la ve r te. {K rm I .
Ce«.,, p. 36). Aeh. Richard d,l plus explicitemenl encore : . Dans tous les peints de 1, lige qni ellrenl une coloration
mates manquent sur les entre-noeuds des tiges spicifères de VE. arvense et ie toutes
les liges de \'E. maximum, et ces enlre-noeuds n’ont pas de chlorophylle, tandis que
les gaînes des mêmes tiges de ces deux espèces, et les rameaux de la dernière, sont
pourvus de stomates et en même temps de chlorophylle (pl. VI, fig. 4 et H ) . Or, comme
toutes les parties de ces tiges sont également exposées à l’action de la lumière et que
cependant celles de ces parties qui sont munies de stomates sont les seules à élaborer
la matière verte, il faut bien en conclure que la production de la chlorophylle
n’est pas due seulement à l’action de la lumière, mais aussi à une cause particulière
dont les stomates permettent l’action*. Rappelons cependant que sur les enlre-
noeuds submergés de \’E. limosum, et dépourvus de stomates, les cellules de Tépiderme
renferment quelques granules verts qu’on ne trouve plus dans ces mêmes cellules
aux entre-noeuds où U existe des stomates et de vraies cellules à chlorophylle.
Au-dessous des stomates, entre eux et les cellules à chlorophylle, existent de
petits méats aériens, qui quelquefois même sont assez considérables sur les jeunes
tiges de YE. hyemale (voy. ci-dessus p. 33; pl. IV, fig. 2, 4, 6 , 8 , 9, 13, 14, 17,
et pl. V, fig. 2, 5).
Comme il a été dit précédemment, le système cellulaire des Equisetum bien développés
présente des cellules très-allongées et dont le grand axe est vertical ; les cellules
à chlorophylle font exception; elles sont ovoïdes et le grand axe en est horizontal
(pl. VI, fig. 16 el 21).
Le reste du cylindre cortical se compose de tissu cellulaire lâche, incolore, dont
les cellules, à parois minces, augmentent de diamètre à mesure qu’elles s’éloignent
de la circonférence. Les lacunes qu’il circonscrit ont toujours une forme et une
grandeur relative constantes, surtout si on les observe vers le milieu de la tige. Sur
YE. limosum ces lacunes s’oblitèrent souvent, parce que, les stomates étant répandus
sur toute la largeur du sillon, les couches de cellules à chlorophylle ne sont point
interrompues sur la ligne médiane du sillon, et pour peu qu’elles se développent sur
le cylindre cortical, qui est très-peu épais, elles occupent la place de ces lacunes.
Les tissus du cylindre intérieur des tiges, plus distincts encore que ceux du rhizome,
sont absolument de même nature; la disposilion générale est la même, je ne
m’y arrêterai donc point. Après la diminution ou la disparution des granules amylacés,
la seule différence générale qu’on puisse signaler consiste en ce que la couche de
tissu cellulaire la plus intérieure et dans laquelle est creusée la cavité centrale est
moins épaisse sur les tiges que sur les rhizomes. Quelquefois même sur ces derniers
«verte, on aperçoit des stomates disposés par lignes longitudinales» {É lém . h o l. e t p h y s ., p. 611). Si la seconde partie
de cette observation n’est pas d’une rigoureuse exactitude, la première est parfaitement vraie.
' M. Sachs a exposé dans le Chemisclie C e n lra lb la ll, 1859, n« 10 , p. U 5 , que, pour que la leucophjlle se transforme
en chlorophylle, il suflil qu’elle se rencontre avec de l’oxygène actif ou ozone en quantité suffisante.