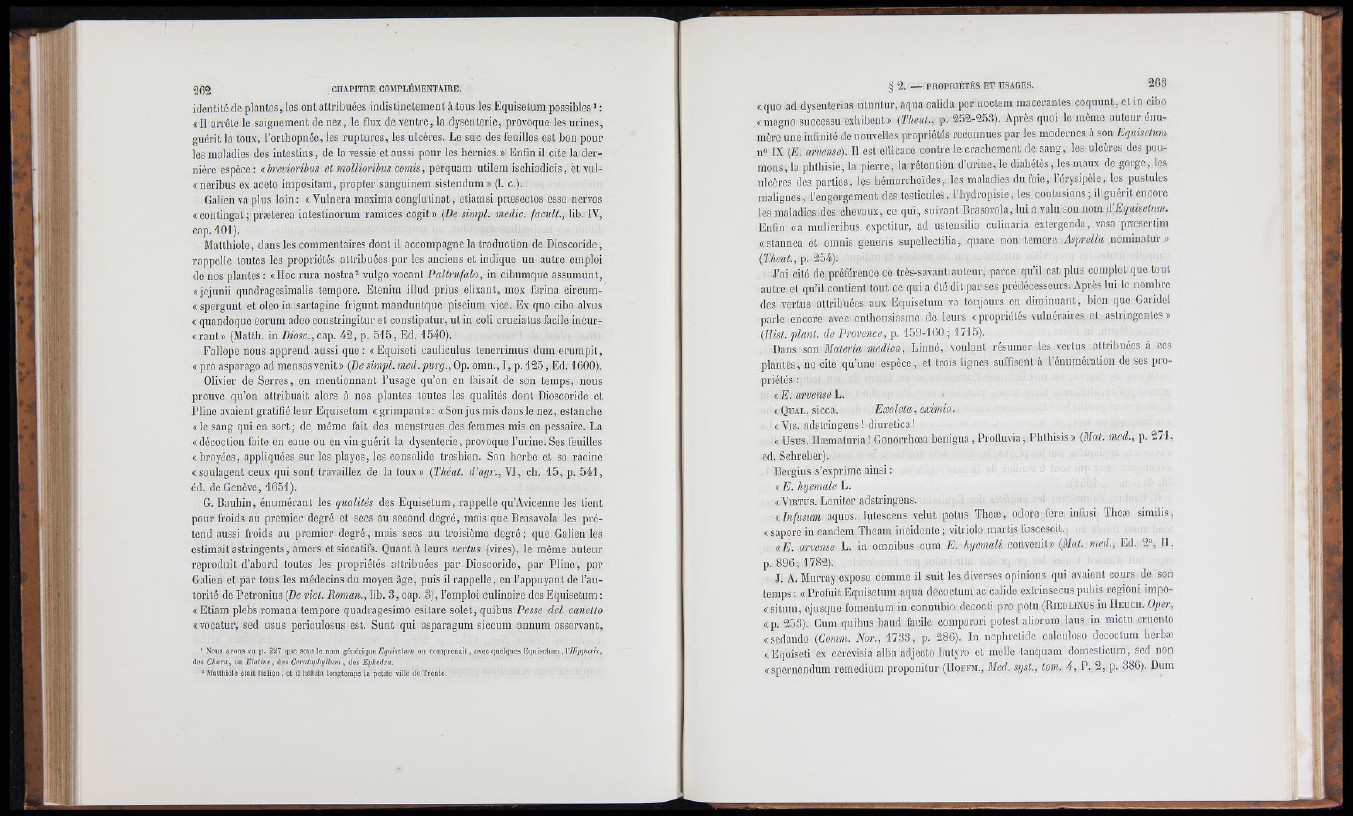
identité do plantes, les ont attribuées indistinctement à tous les Equisetum possibles’ :
« Il arrête le saignement de nez, le flux de ventre, la dysenterie, provoque les urines,
guérit la toux, l’orthopnée, les ruptures, les ulcères. Le suc des feuilles est bon poulies
maladies des intestins, de la vessie et aussi pour les hernies.» Enfin il cite la dernière
espèce: «breviorihis ct mollioribus comis, perquam utilem ischiadids, et vul-
«neribus ex aceto impositam, propter sanguinem sistendum » (1. c.).
Galien va plus loin : « Vulnera maxima conglutinat, etiamsi præsectos esse ñervos
«oontingat; præterea inteslinorum ramices cogit» {De sitnpl. medic. facuU., lib. IV,
cap. 101).
Matthiole, dans les commentaires dont il accompagne la traduction de Dioscoride,
rappelle toutes les propriétés attribuées par les anciens et indique un autre emploi
de nos plantes : «Hoc rura nostra* vulgo vocant Paltrufalo, in cibumque assumunt,
«jejtinii quadragesimalis tempore. Etenim illud prius elixant, mox farina circum-
«spergunt et oleo in sartagine frigunt manduntque piscium vice. Ex quo cibo alvus
« quandoque eorum adeo constringitur et constipatur, ut in coli crucialus facile incur-
«rant» (Matth. in Diosc.,cap. 42, p. 515, Ed. 1540).
Fallope nous apprend aussi que: «Equiseti cauliculus tenerrimus dura erumpit,
«pro asparago ad mensas venit» {De simpl. med. purg.,Op. o m a .,l, p. 125, Ed. IGOO).
Olivier de Serres, en mentionnant l ’usage qu’on en faisait de son temps, nous
prouve qu’on attribuait alors à nos plantes toutes les qualités dont Dioscoride ct
Pline avaient gratifié leur Equisetum «grimpant»: «Son jus mis dans le nez, estanche
«le sang qui en sort; de même fait des menstrues des femmes mis en pessaire. La
«décoction faite en eaue ou en vin guérit la dysenterie, provoque l’urine. Ses feuilles
«broyées, appliquées sur les playes, les consolide tresbien. Son herbe et sa racine
«soulagent ceux qui sont travaillez de la toux» {Théal. d ’agr., V I , cli. 15, p. 541,
éd. de Genève, 1651).
G. Bauhin, énumérant les qualités des Equisetum, rappelle qu’Avicenne les tient
pour froids au premier degré et secs au second degré, mais que Brasavola les prétend
aussi froids au premier degré, mais secs au troisième degré ; que Galien les
estimait astringents, amers etsiceatifs. Quant à leurs vertus (vires), le même auteur
reproduit d’abord toutes les propriétés attribuées par Dioscoride, par Pline, par
Galien et par tous les médecins du moyen âge, puis il rappelle, en l’appuyant de l’autorité
de Petronius [De vict. Roman., lib. 3, cap. S), l’emploi culinaire des Equisetum :
«Etiam plebs romana tempore quadragesimo esitare solet, quibus Pesse del canetto
«vocatur, sed usus periculosus est. Sunt qui asparagum siccum annum asservant,
' Nous avons vu p. 227 que sous le nom générique ÆçMîseiiini on comprenait, avec quelques Equisetum, VHippuriii,
lies C h a ra , un E la li n e , des C e r a lo p k y llum , des Ep h ed ra .
■ MatUiiole était italien, et il habita longtemps la petite ville de Trente.
«quo ad dysenterias utuntur, aqua calida per noctem macérantes coquunl, et in cibo
«magno successu exhibent» {Theat., p. 252-253). Après quoi le même auteur énumère
une infinité de nouvelles propriétés reconnues par les modernes à son Equisetum
n» IX [E. arvense). Il est efficace contre le crachement de sang, les ulcères des poumons,
la phthisie, la pierre, la rétention d’urine, le diabétès, les maux de gorge, les
ulcères des parties, les béraorrhoïdes, les maladies du foie, l’érysipèle, les pustules
malignes, l’engorgement des testicules, l’hydropisic, les contusions ; il guérit encore
les maladies des chevaux, ce qui, suivant Brasavola, lui a valu son nom A Equisetum.
Enfin «a mulieribus expetitur, ad ustensilia culinaria extergcnda, vasa præsertim
«stannea et omnis generis supellectilia, quare non temere Asprella nominatur »
{Theat., p. 254).
J ’ai cité de préférence ce très-savant auteur, parce qu’il est plus complot que tout
autre ct qu’il contient tout ce qui a été dit par ses prédécesseurs. Après lui lo nombre
des vertus attribuées aux Equisetum va toujours en diminuant, bien que Garidel
parle encore avec enthousiasme de leurs «propriétés vulnéraires ct astringentes»
{Ilist. plant, de Provence, p. 159-lGO; I7I5 ) .
Dans son Materia medica, Linné, voulant résumer les vertus attribuées à ces
plantes, ne cite qu’une espèce, et trois lignes suffisent à l’énumcration de ses propriétés
:
<iE. arvense h.
« Qu a l . sicca. Eæoleta, cximia.
«Vis. adstringens! diuretica!
« Usus. Hæmaturia ! Gonorrhoea benigna, Profluvia, Phlliisis » {Mal. med., p. 2 7J,
ed. Schreber).
Bergius s’exprime ainsi :
« E. hjemale L.
«ViRTUS. Lenitcr adstringens.
«Infusimi aquos. Iiitescens velut potus Tlieæ, odore fere infusi Theæ similis,
« sapore in eandem Theam incidente ; vitriolo martis fuscescit.
«E. arvense L. in omnibus cum E. hyemali convenit» {Mat. med., Ed. 2“, I I ,
p . 896; 1782).
J. A. Murray expose comme il suit les diverses opinions qui avaient cours de son
temps : « Profuit Equisetum aqua clecoctum ac calide extrinsecus pubis regioni impo-
«situm, ejusque fomentum in connubio decocti pro potu (R ie d l in u s in I I e u c i i . Ojier,
«p. 253). Cum quibus baud facile comparari potest aliorum laus in mietu cruento
«sedando {Comm. Nor., 1733, p. 280). In nephrelido calculoso decoctum herbæ
«Equiseti ex cercvisia alba adjecto butyro et mclle lanquam domesticum, sod non
«sperncndum remedium proponitur ( I I o f fm ., Med. syst., tom. 4, P. 2, p. 380). Dum