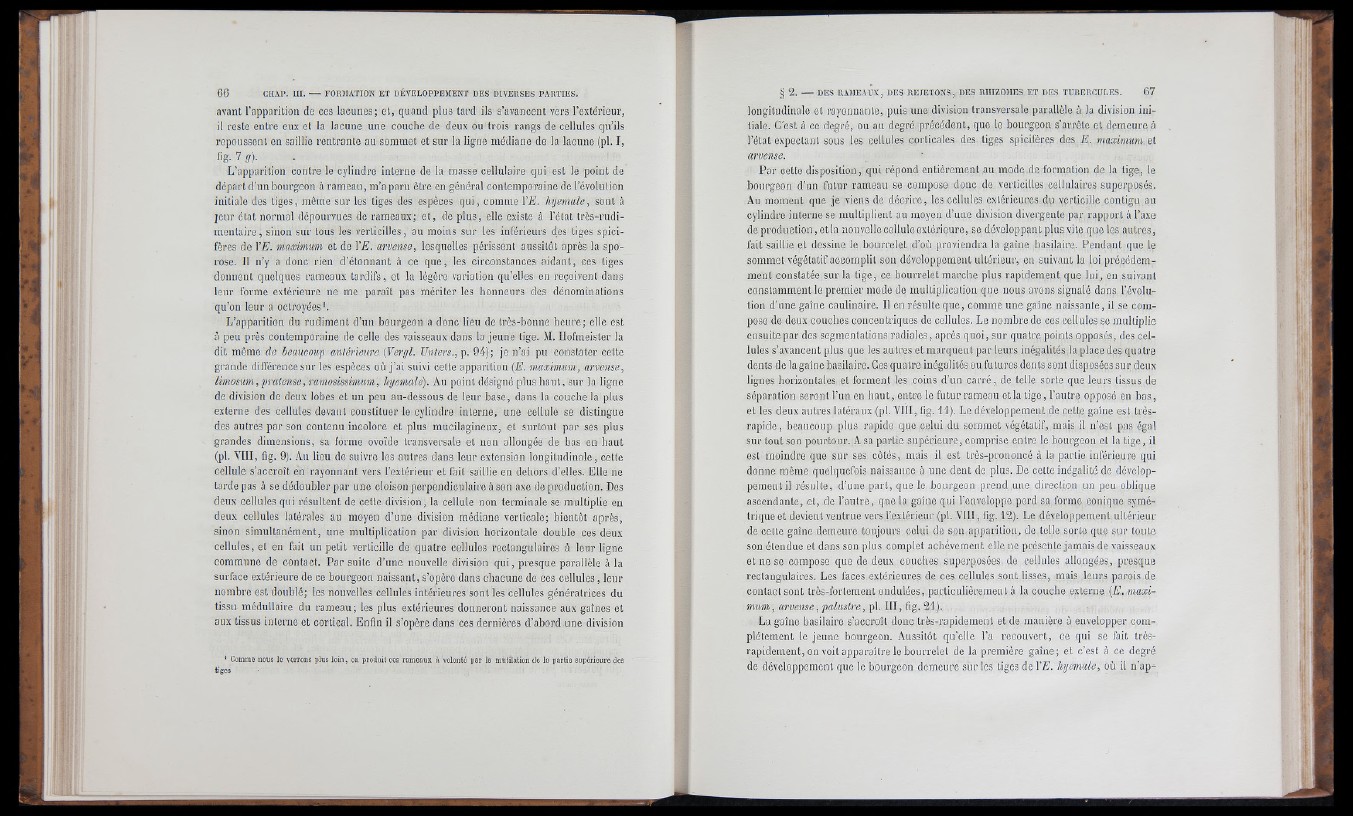
avant l'apparition de ces lacunes; et, quand plus tard ils s’avancent vers l’extérieur,
il resle entre eux et la lacune une couche de deux ou trois rangs de cellules qu’ils
repoussent en saillie rentrante au sommet et sur la ligne médiane de la lacune (pl. I,
fig. 7 (j).
L ’apparition contre le cylindre interne do la masse cellulaire qui est le point de
départ d’un bourgeon à rameau, m’a paru être en générai contemporaine de l’évoluliou
initiale des tiges, même sur les tiges des espèces qui, comme \'E. hyemale, sont à
jeur état normal dépourvues de rameaux; et, de plus, elle existe à l’état très-rudimentaire,
sinon sur tous les verticilles, au moins sur les inférieurs des tiges spicifères
de YE. maximum et de VE. arvense, lesquelles périssent aussitôt après la sporose.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, les circonstances aidant, ces liges
donnent quelques rameaux tardifs, et la légère variation qu’elles en reçoivent dans
leur forme extérieure ne me paraît pas mériter les honneurs des dénominations
qu’on leur a octroyées*.
L ’apparition du rudiment d’un bourgeon a donc lieu de très-bonne heure; elle est
à peu près contemporaine de celle des vaisseaux dans la jeune tige. M. Hofmeister la
dit même de beaucoup antérieure [Yergl. ünters., p. 94); je n’ai pu couslater cette
grande différeucesur les espèces où j ’ai suivi cette apparition [E. maximum, arvense,
limosum, pratense, ramosissimum, hyemale). Au point désigné plus haut, sur la ligne
de division de deux lobes et un peu au-dessous de leur base, dans la couche la plus
externe des cellules devant constituer le cylindre interne, une cellule se distingue
des autres par son contenu incolore et plus mucilagineux, et surtout par ses plus
grandes dimensions, sa forme ovoïde transversale et non allongée de bas en haut
(pl. Y I I I , fig. 9). Au lieu de suivre les autres dans leur extension longitudinale, cette
cellule s’accroît en rayonnant vers l’extérieur et fait saillie en dehors d'elles. Elle ne
tarde pas à se dédoubler par une cloison perpendiculaire à son axe de production. Des
deux cellules qui résultent de cette division, la cellule non terminale se multiplie en
deux cellules latérales au moyen d’une division médiane verticale; bientôt après,
sinon simultanément, une multiplication par division horizontale double ces deux
cellules, et en fait un petit verticille de quatre cellules rectangulaires à leur ligne
commune de contact. Par suite d’une nouvelle division qui, presque parallèle à la
surface extérieure de ce bourgeon naissant, s’opère dans chacune de ces cellules, leur
nombre est double; les nouvelles cellules intérieures sont les cellules génératrices du
tissu médullaire du rameau; les plus extérieures donneront naissance aux gaînes et
aux tissus interne et cortical. Enfin il s’opère dans ces dernières d’abord une division
' Comme nous le verrons plus loin, on produit ces rameaux à volonté par la mutilation de la partie supérieure des
tiges
§ 2. — D E S R A M E A U X , D E S R E J E T O N S , D E S R H IZ O M E S E T D E S T U B E R C U L E S . 07
longitudinale et rayonnante, puis une division transversale parallèle à la division initiale.
C’est à ce degré, ou au degré précédent, que le bourgeon s’arrête et demeure à
l’état expectant sous les cellules corticales des tiges spicifères des E. maximum et
arvense.
Par cette disposition, qui répond entièrement au mode de formation de la tige, le
bourgeon d’un futur rameau se compose donc de verticilles cellulaires superposés.
Au moment que je viens de décrire, les cellules extérieures du verticille contigu au
cylindre interne se multiplient au moyen d’une division divergente par rapport à Taxe
de production, et la nouvelle cellule extérieure, se développant plus vite que les autres,
fait saillie et dessine le bourrelet d’où proviendra la gaîne basilaire. Pendant que le
sommet végétatif accomplit sou développement ultérieur, en suivant la loi précédemment
constatée sur la tige, ce bourrelet marche plus rapidement que lui, en suivant
constamment le premier mode de mulliplicalioii que nous avons signalé dans l’évolution
d’une gaîne cauliuaire. I l en résulte que, comme une gaîne naissanle, il se compose
de deux couches concentriques de cellules. Le nombre de ces cellules se multiplie
ensuite par des segmentations radiales, après quoi, sur quatre points opposés, des cellules
s’avancent plus que les autres et marquent parleurs inégalités la place des quatre
dents de la gaîne basilaire. Ces quatre inégalités ou futures dents sont disposées sur deux
lignes horizontales et forment les coins d’un carré, de telle sorte que leurs tissus de
séparation seront l’un en haut, entre le futur rameau etla lige, l’autre opposé en bas,
et les deux autres latéraux (pl. V I I I , fig. I I ) . Le développement de cette gaîne est très-
rapide, beaucoup plus rapide que celui du sommet végétatif, mais il n’est pas égal
sur tout son pourtour. A sa partie supérieure, comprise entre le bourgeon el la tige, il
est moindre que sur ses côtés, mais il est très-prononcé à la partie inférieure qui
donne même quelquefois naissance à une dent de plus. Do celte inégalité de développement
il résulte, d’une part, que le bourgeon prend une direction un peu oblique
ascendante, et, de l’autre, que la gaîne qui l’enveloppe perd sa forme conique symétrique
et devient ventrue vers rextérlcur (pl, Y I I I , fig. 12). Le développement ultérieur
de celte gaîne demeure toujours celui de son apparition, de telle sorte que sur toute
son étendue et dans son plus complet achèvement elle ne préscu le jamais de vaisseaux
et ne se compose que de deux couches superposées de cellules allongées, presque
rectangulaires. Les faces extérieures de ces cellules sont lisses, mais leurs parois de
contact sont très-fortement ondulées, particulièrement à la couche externe (E. maximum
, arvense, palustre, pl. I I I , fig. 21).
La gaîne basilaire s’accroît donc très-rapidement et de manière à envelopper complètement
le jeune bourgeon. Aussitôt qu’elle l ’a recouvert, ce qui se fait très-
rapidement, on voit apparaître le bourrelet de la première gaîne; et c’est à ce degré
de développement que le bourgeon demeure sur les tiges de YE. hyemale, où il n’ap