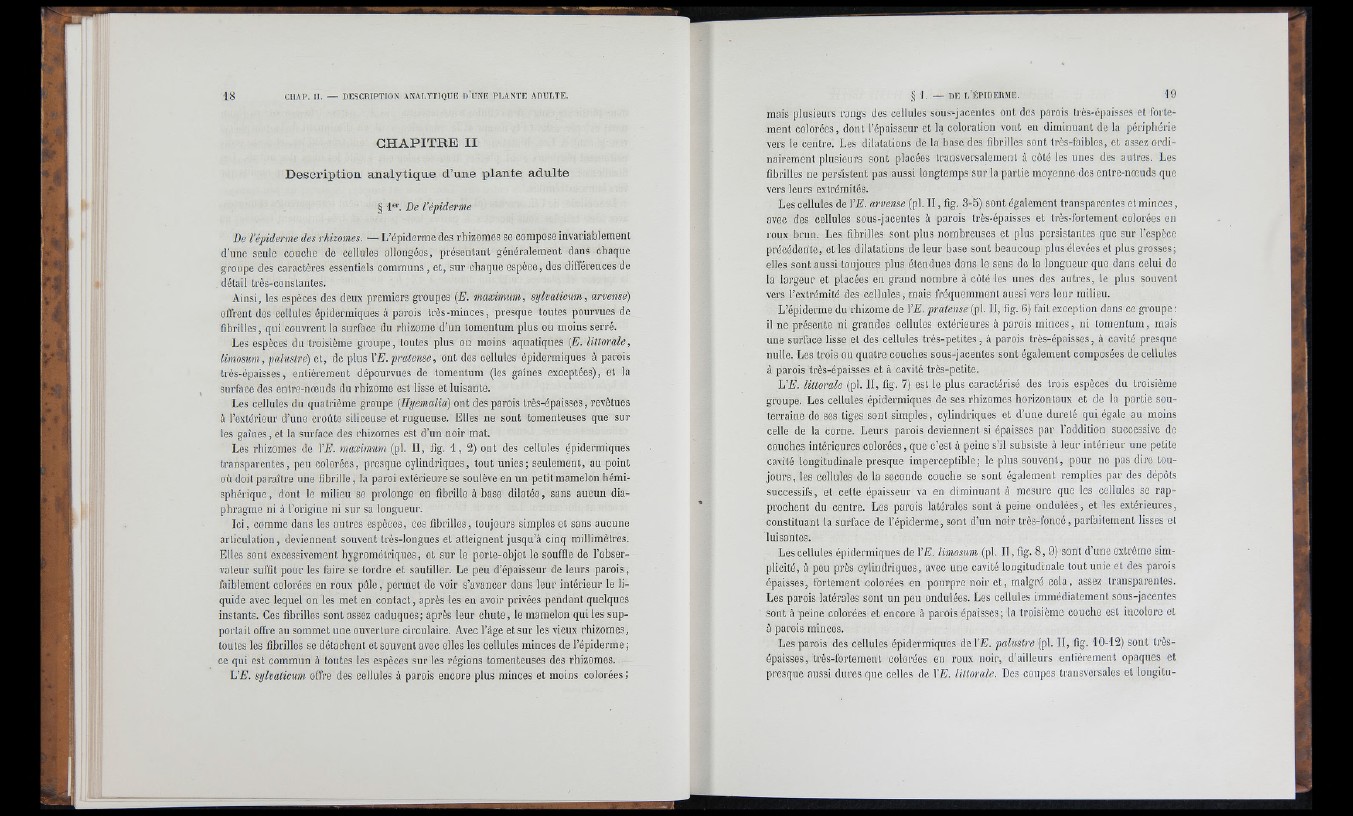
C H A P I T R E I I
D e s c r ip t io n a n a ly t iq u e d ’u n e p la n te a d u l t e
8 1“ . De Tépit
De l’épiderme des rhizomes. ~ L ’épiderme des rhizomes se compose invariablement
d'une seule couclie de cellules allongées, présentant généralement dans chaque
groupe des caractères essentiels communs, et, sur chaque espèce, des différences de
détail très-constantes.
Ainsi, les espèces des deux premiers groupes (E. maximum, sylvaliciim, arvense)
offrent des cellules épidermiques à parois très-minces, presque toutes pourvues de
fibrilles, qui couvrent la surface du rhizome d’un tomentum plus ou moins serré.
Les espèces du troisième groupe, toutes plus ou moins aquatiques [E. littorale,
limosum, palustre) et, de plus YE. pratense, ont des cellules épidermiques à parois
très-épaisses, entièrement dépourvues de tomentum (les gaînes exceptées), et la
surface des entre-noeuds du rhizome est lisse et luisante.
Les cellules du quatrième groupe (Hyemalia) ont des parois très-épaisses, revêtues
à l’extérieur d’une croûte siliceuse et rugueuse. Elles ne sont tomenteuses que sur
les gaines, et la surface des rhizomes est d’un noir mat.
Les rhizomes de YE. maximum (pl. I I , fig. 1, 2) ont des cellules épidermiques
transparentes, peu colorées, presque cylindriques, tout unies; seulement, au point
où doit paraître une fibrille, la paroi extérieure se soulève en un petit mamelon hémisphérique,
dont le milieu se prolonge en fibrille à base dilatée, sans aucun diaphragme
ni à l’origine ni sur sa longueur.
Ici, comme dans les autres espèces, ces fibrilles, toujours simples et sans aucune
articulation, deviennent souvent très-longues el atteignent jusqu’à cinq millimètres.
Elles sont excessivement liygrométriques, et sur le porte-objet le souffle de l’observateur
suffit pour les faire se tordre et sautiller. Le peu d’épaisseur de leurs parois,
faiblement colorées en roux pâle, permet de voir s’avancer dans leur intérieur le liquide
avec lequel on les met en contact, après les en avoir privées pendant quelques
instants. Ces fibrilles sont assez caduques; après leur chute, le mamelon qui les supportait
offre au sommet une ouverture circulaire. Avec l’âge et sur les vieux rhizomes,
toutes les fibrilles se détachent et souvent avec elles les cellules minces de l’épiderme;
ce qui est commun à toutes les espèces sur les régions tomenteuses des rhizomes.
L ’B. sylvaticum offre des cellules à parois encore plus minces et moins colorées ;
mais plusieurs rangs des cellules sous-jacentes oui des parois très-épaisses et fortement
colorées, dont l’épaisseur et la coloration vont en diminuant de la périphérie
vers le centre. Les dilatations de la base des fibrilles sont très-faibles, et assez ordinairement
plusieurs sont placées transversalement à côté les unes des outres. Les
fibrilles ne persistent pas aussi longtemps sur la partie moyenne des enlre-noeuds que
vers leurs extrémités.
Les cellules de l’B . arvense (pl. I I , fig. 3-5) sont également transparentes et minces,
avec des cellules sous-jacentes à parois très-épaisses et très-fortement colorées en
roux brun. Les fibrilles sont plus nombreuses et plus persistantes que sur l’espèce
précédente, et les dilatations de leur base sont beaucoup plus élevées et plus grosses;
elles sont aussi toujours plus étendues dans le sens de la longueur que dans celui de
la largeur et placées en grand nombre à côté les unes des autres, le plus souvent
vers l’extrémité des cellules, mais fréquemment aussi vers leur milieu.
L ’épiderme du rhizome de l’B . pratense (pl. II, fig. 6) fait exception dans ce groupe :
il ne présente ni grandes cellules extérieures à parois minces, ni tomentum, mais
une surface lisse et des cellules très-petites, à parois très-épaisses, à cavité presque
nulle. Les trois ou quatre couches sous-jacentes sont également composées de cellules
à parois très-épaisses et à cavité très-petite.
L ’B. littorale (pl. I I , fig. 7) est le plus caractérisé des trois espèces du troisième
groupe. Les cellules épidermiques de ses rhizomes horizontaux et de la partie souterraine
de ses liges sont simples, cylindriques et d’une dureté qui égale au moins
celle de la corne. Leurs parois deviennent si épaisses par l ’addition successive de
couches intérieures colorées, que c’est à peine s’il subsiste à leur intérieur une petite
cavité longitudinale presque imperceptible; le plus souvent, pour ne pas dire toujours,
les cellules de la seconde couche se sont également remplies par des dépôls
successifs, et cette épaisseur va en diminuant à mesure que les cellules se rapprochent
du centre. Les parois latérales sont à peine ondulées, et les extérieures,
constituant la surface de l’épiderme, sont d’un noir très-foncé, parfaitement lisses et
luisantes.
Les cellules épidermiques de l’B. limosum (pl. I I , fig. 8 , 9) sont d’une extrême simplicité,
à peu près cylindriques, avec une cavité longitudinale tout unie et des parois
épaisses, fortement colorées en pourpre noir et, malgré cela, assez transparentes.
Les parois latérales sont un peu ondulées. Les cellules immédiatement sous-jacentes
sont à peine colorées et encore à parois épaisses; la troisième couche est incolore et
à parois minces.
Les parois des cellules épidermiques de l’B . palustre (pl. I I , fig. 10-12) sont très-
épaisses, très-fortement colorées en roux noir, d’ailleurs entièrement opaques et
presque aussi dures que celles de l'B. littorale. Des coupes transversales et longilii