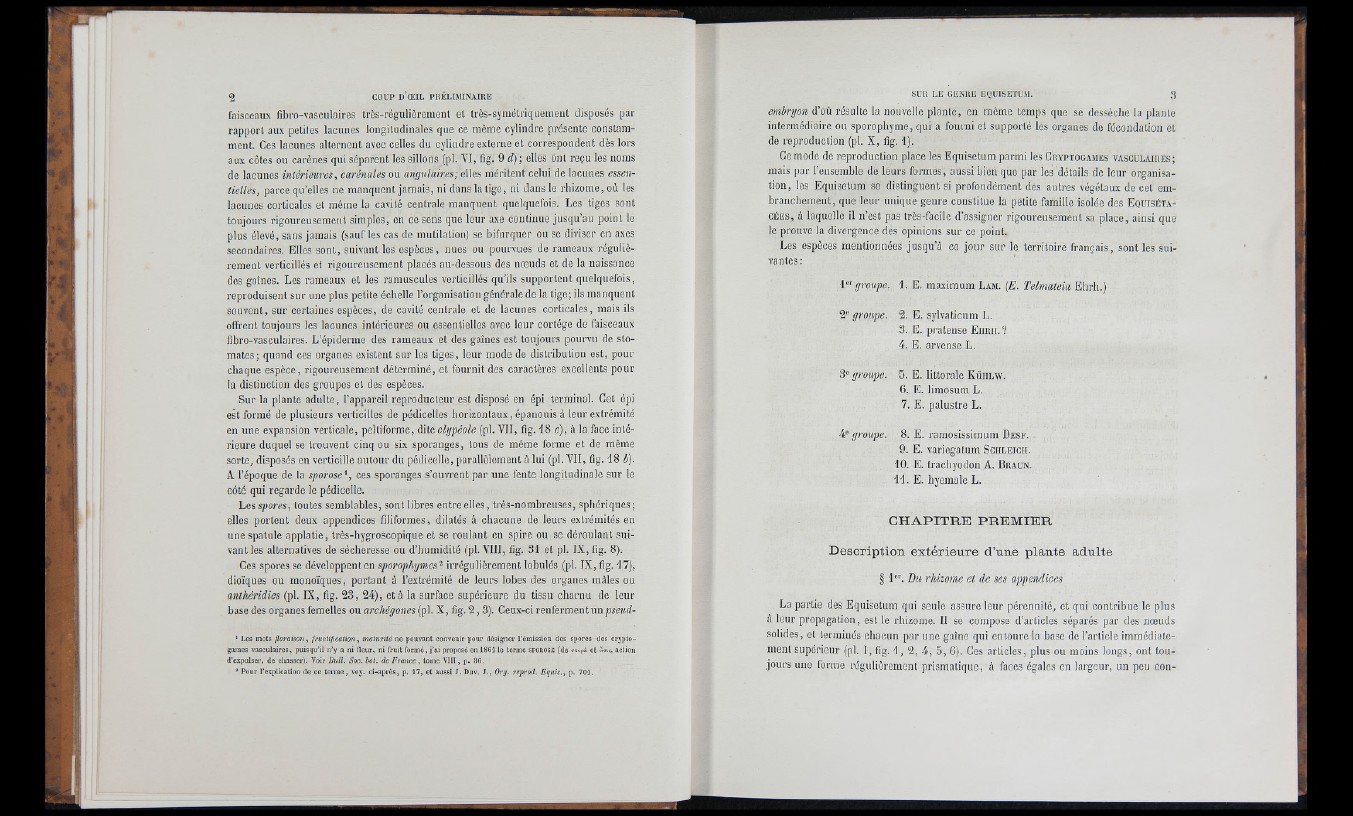
2 COUP d ’oe il PRÉLIMINAIRE
faisceaux fibi'o-vasculaires très-régulièrement et très-symétriquement disposés par
rapport aux petites lacunes longitudinales que ce même cylindre présente constamment.
Ces lacunes alternent avec celles du cylindre externe et correspondent dès lors
aux côtes ou carènes qui séparent les sillons (pl. Y l, fig. 9 if); elles ont reçu les noms
de lacunes intérieures, carénales ou angulaires; elles méritent celui de lacunes essentielles,
parce qu’elles ne manquent jamais, ni dans la tige, ni dans le rhizome, où les
lacunes corticales et même la cavité centrale manquent quelquefois. Les tiges sont
toujours rigoureusement simples, en ce sens que leur axe continue jusqu’au point le
plus élevé, sans jamais (sauf les cas de mutilation) se bifurquer ou se diviser en axes
secondaires. Elles sont, suivant les espèces, nues ou pourvues de rameaux régulièrement
vertieillés et rigoureusement placés au-dessous des noeuds et de la naissance
des gaines. Les rameaux et les ramuscules vertieillés qu'ils supportent quelquefois,
reproduisent sur une plus petite échelle rorganisation générale de la tige; ils manquent
souvent, sur certaines espèces, de cavité centrale et de lacunes corticales, mais ils
offrent toujours les lacunes intérieures ou essentielles avec leur cortège de faisceaux
fibro-vasculaires. L ’épiderme des rameaux et des gaines est toujours pourvu de stomates;
quand ces organes existent sur les tiges, leur mode de distribution est, pour
chaque espèce, rigoureusement déterminé, et fournit des caractères excellents pour
la distinction des groupes et des espèces.
Sur la plante adulte, l’appareU reproducteur est disposé en épi terminal. Cet épi
est formé de plusieurs verticilles de pédicelles horizontaux, épanouis à leur extrémité
en une expansion verticale, peltiforme, dite clypéole (pl. Y I I , fig. 18 c), à la face intérieure
duquel se trouvent cinq ou six sporanges, tons de même forme et de même
sorte, disposés en verticille autour du pédicellc, parallèlement à lui (pl. Y I I , fig. 18 b).
A l’époque de la sporose', ces sporanges s’ouvrent par une fente longitudinale sur le
côté qui regarde le pédicelle.
Les spores, toutes semblables, sont libres entre elles, très-nombreuses, sphériques;
elles portent deux appendices filiformes, dilatés à chacune de leurs extrémités en
une spatule applatie, très-hygroscopique el se roulant en spire ou se déroulant suivant
les alternatives de sécheresse ou d’humidité (pl. Y II I, fig. 31 et pl. IX , fig. 8).
Ces spores se développent en sporophymes"' irrégulièrement lobulés (pl. IX , fig. 17),
dio'iques ou monoïques, portant à l’extrémité de leurs lobes des organes mâles ou
anthèridies (pl. IX , fig. 23, 24), et à la surface supérieure du tissu charnu de leur
base des organes femelles ou archégones (pl. X , fig. 2,3). Ceux-ci renferment un pseud-
' Les mots flo r a is o n , fr u c tific a tio n , m a tu r ité ne pouvant convenir pour désigner l’émission des spores des cryptogames
vasculaires, puisqu’il n’y a ni fleur, ni fruit formé, j ’ai proposé en 1861 le terme sporose (de tmopo et action
d’expulser, de chasser). Voir B u ll. S o c . bot. d e F r a n c e , tome V I I I , p. 36.
* Pour l’explication de ce terme, voy. ci-après, p. 17, et aussi J . Duv. J . , Org. rep ro d . E q u is ., p. 701.
S U R L E G E N R E E Q U IS E T U M .
embryon d’où résulte la nouvelle plante, en même temps que se dessèche la plante
intermédiaire ou sporophyme, qui a fourni et supporté les organes de fécondation et
de reproduction (pl. X , fig, 1).
Ce mode de reproduclion place les Equisetum parmi les Cryptogames vasculaires;
mais par l’ensemble de leurs formes, aussi bien que par les détails de leur organisation,
les Equisetum se distinguent si profondément des autres végétaux de cet embranchement,
que leur unique genre constitue la petite famille isolée des E quiséta-
C É E S , à laquelle il n’est pas très-facile d’assigner rigoureusement sa place, ainsi que
le prouve la divergence des opinions sur ce point.
Les espèces mentionnées jusqu’à ce jour sur le territoire français, sont les suivantes:
1“,
2'
1. E. maximum L am. [E. Telmateia Ehrh.)
2. E. sylvaticum L.
8. E. pratense Eimii.?
4. E, arvense L.
3" groupe. 5. E . l itto r a le K ü h lw .
6 . E, limosum L.
7. E, p a lu s t r e L.
4" groupe. 8 . E . r am o s is s im um De s f .
9. E. variegatum Schleich .
10. E. trachyodon A. B raun.
11. E. hyemale L.
C H A P IT R E P R EM IE R
D e sc r ip tio n e x té r ieu r e d ’une plan te adulte
§ 1“ . Du rhizome et de ses appendices
La partie des Equiselum qui seule assure leur pérennité, et qui contribue le plus
à leur propagation, est le rhizome. Il se compose d’articles séparés par des noeuds
solides, et termines chacun par une gaine qui entoure la base de l’article immédiatement
supérieur (pl. I , fig. 1 , 2, 4, 5, 6). Ces articles, plus ou moins longs, ont toujours
une forme régulièrement prismatique, à faces égales en largeur, un peu con