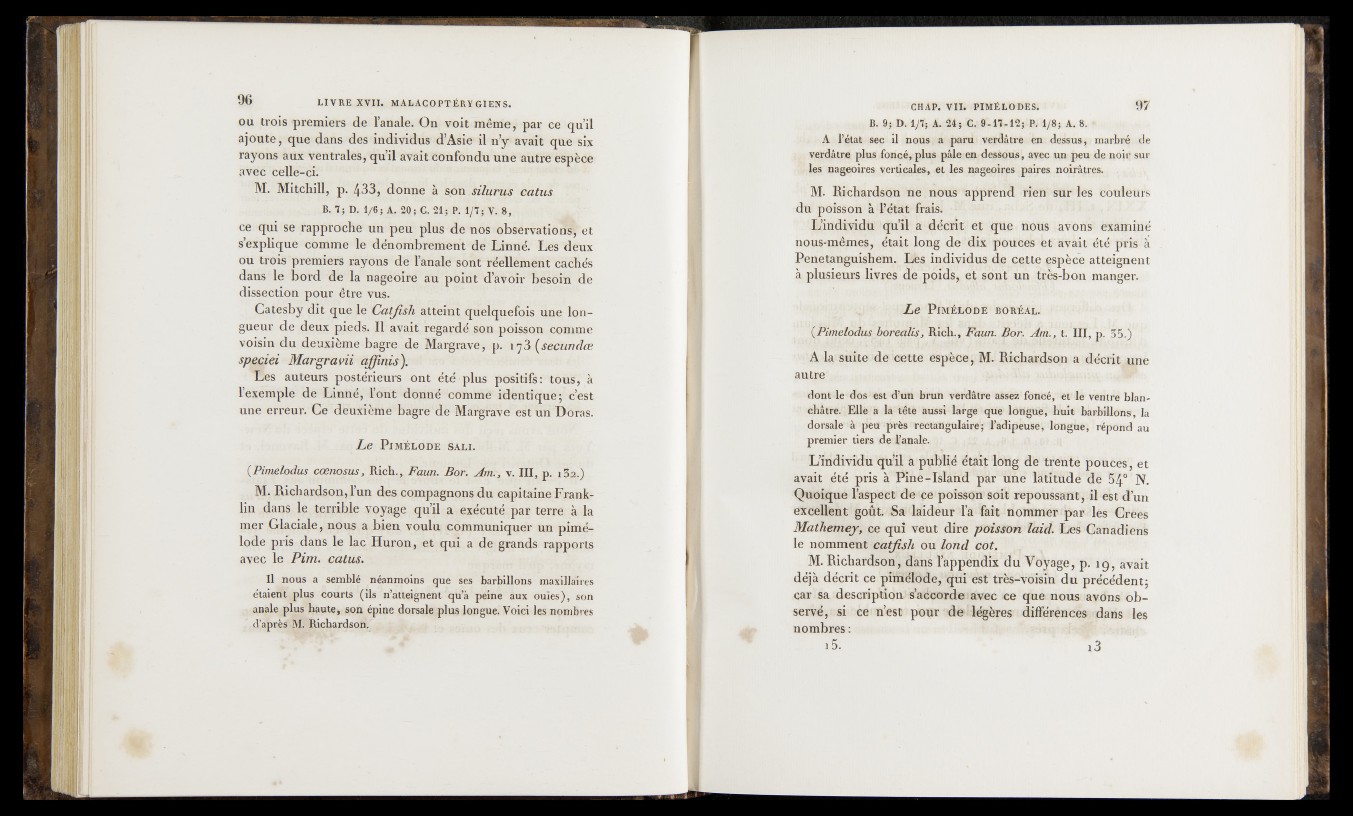
L I V R E X V I I » M A L A Ç Q P T É R Ï G - Ï E Î t S .
ou trois «premiers de Fanale. Cm voit inême ^par eé qu’il
ajoute , que dans des individus d’Asie^il n’y^uvàit qüe$ix
rayons aux ventrales, qu’il avait confondu une autre espèce
avec celle-ci;
M. Mitchill, pÇ^3 3 j donne a jspn silurus catus
B. 1 ; D. 1/6 ; A, 20 ; G. 21 ;-R ijk > V. 8 ,
cè qui se rapproche un peu plus de nos ôbservatiora|t‘et
s’explique comme le dénombrement de Linné. Les deux
ou trois premiers rayons de 1 anale sont réellement cachés
dans le bord de la nageoire au point d avoir besoin lde
dissection pour être vus. !
Catesby dit que le Catjish atteint quelquefois une longueur
de deux pieds. Il avait regardé son poisson eomme
voisin du deuxième bagre’d e Margrave, p. \fâ{secitndoe
sp ^ e i Margravii qffinis).
TSes auteurs postérieurs ont été plus positifs: tou^f à
1 exemple de Linné, l’ont donné comme identiquejte’est
une erreur. Ce deuxième bagre de Margrave^eift uri'Do'ras.
| L e PlMELODE SALI.
(Pimelpdus coenosus, Rich., Faun. B o r. Am.', v. III, p. i 3a.)_
M. Richardson, l’un des compagnons du capitaine Franklin
le}$prribile yqyage qu’il a exécuté pa| terre à In
mer Glaciale, nous a bien, voulu communiquer un pimé-
lode pris dans le lac Huron, et qui a de grands rapports
avec le Pim. catus.
Il nous a semblé néanmoins que ses- barbillons maxilîÉtes
étaient q>lus courts (ils n’atteignent ‘qu’à peine aux ouïes), son
anale plus haute,, son, épine dorsale plus longue. Voici les nombres
(Vaprès M. Richardson.
iP SfiÉ I? VII» PHAÉLOBESi I
B. 9j Dvl/Ï; -A. 24^ ®.= 9- 41- 125^14/%.A. 8.
| À l’éta®i sec il noua* a paru* verdâtre.èn. deàsus, marbré de
verdâtre plus foncé, plus pâle en dessous, af^c un peu de noiij sur
les nageoires, verqpa^, .et les nageoires paires noirâtres.
M. Richardsdune nbüs^ppVênd rieh sur les couleurs
du poisson à ; l*é*àt frais* 1
Mndividii qn.’il a décrit et que hotolavôns' examiné
nous-mêmes, était long deJdix poucek :fet hvait été1 pris à
Penetanguishem. Les individus d,e jgfltte ,i|spàce atteignent
à plusieurs livres du poids, et sont un très-bon manger.
L e PîMÉLODÉ BORÉAL.; ‘
ÇPiateloditS; boreülisj Rich., Faun. B o r .Æ È LV III, p. J5.) !
A la suitoiâe î^ette espUt®, M. Riohtàd^nadée â tdine
autre
dont-le dos est d’un brun verdâtre assez foncé, -etlé ventre blanchâtre;*
®llèM a là tête aussi large qife lôfigüeyh<uit barbillons, la
dorsale à jièuprès 'rëëtafigülâieé^ #âdipeüsëy lOfigîté, ■ répond au
premier tiers de ÿîinale.
L’individu quai à publié màïflëttg dé 'tfeMé poncés; et
avait été pris à Pme-ïsïâtfd pàr ^ h é latbüdé dë Üf4°’N.
Quoique l’aspeet da poissqmsoit feponssaflt, il est d’un
excellent goub ^âiCMdéur l’â -fàk nonmiéï'i^af alès Grées
Mathemejr, ce qui veut diré pïïisstm îkié. ééS>Gànâdiéns
le nomment catjish ou lond cot.
M* Richardson, dans 1 appéndix dti VbVage, p. ig y avait
déjà du précédant;
car sa description' s^aéeorde: avec ce que nous avdns observé,;
si èefn’est^poiiÉr de>H^ères différences? dans les
nombres :
i 5 . i3