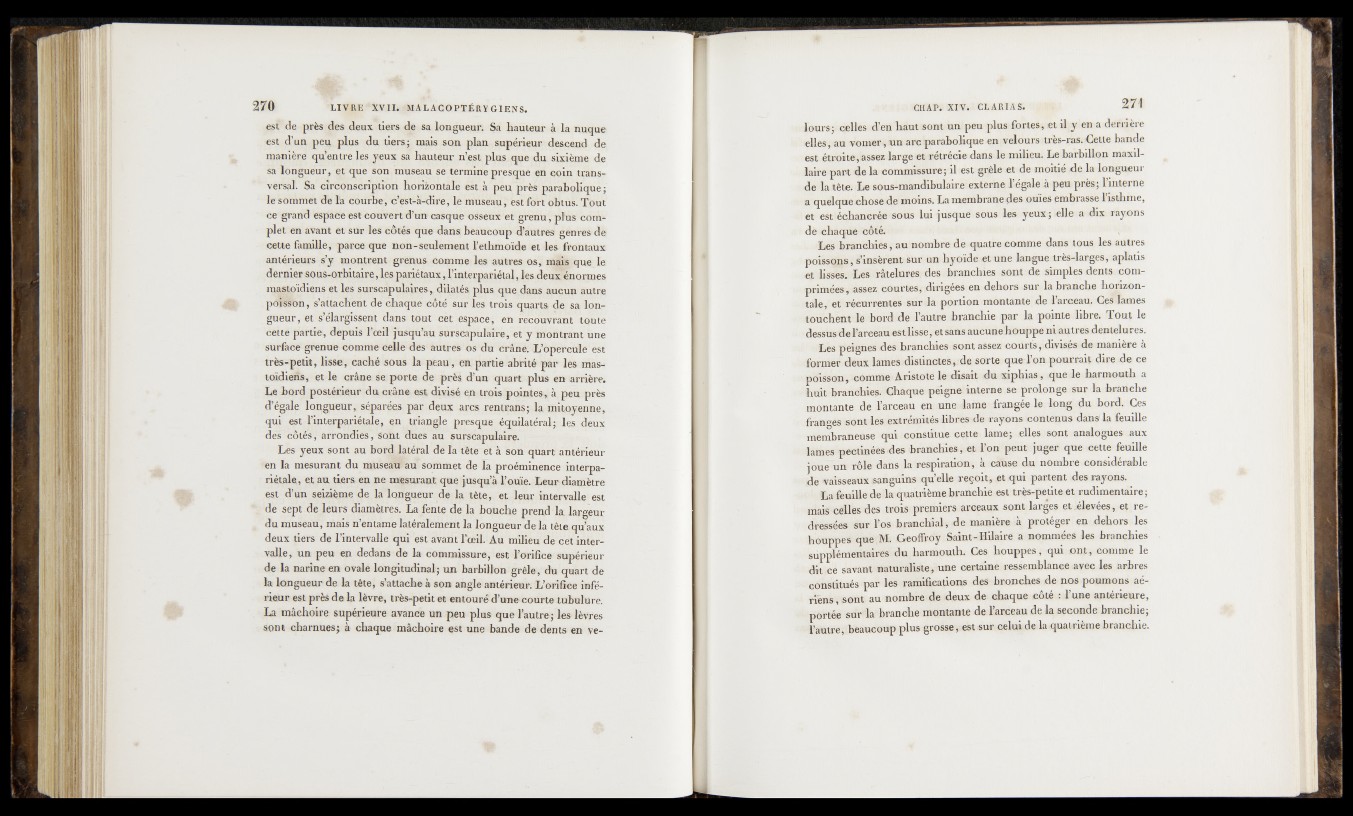
est de près des deux tiers de sa longueur. Sa hauteur à la nuque
est d’un peu plus du tiers.; mais son plan supérieur descend de
manière qu’entre les yeux sa hauteur n’est plus., que du sixième de
sa longueur , et que son museau se termine presque en eoin transversal.
Sa circonscription horizontale est à peu près parabolique ;
le sommet dë la courbe, c’est-à-dire, le mustàiU est fort ôbtû's. Tput
ce grand espace est couvert d’un casque oSseux et grenu, plus cdm-
plet en avant et sur les côtés que dans beaucoup d’autres genres de
cette famille, parce que non-seulement l’ethmoïde et les. frontaux
antérieurs s’y montrent grenus comme les autres os,, que 1®
dernier sous-orbitaire, lespariétaux, l’interpariétal, les deu^mormes
magjpïdiens et les surscapulatres ^ dilatés plus, que dans æuçun autre
pdfllbn, s’attachent de chaque coté sur les trois quarts de sa longueur,
et ^élargissent dans tout cèt espace, en recouvrant toute
cette partie, depuis l’oeil jusqu’au surscapulaîre,ety montrant une
surfàcé grenu© comme celle des autres os du crâne. L’opercùïê
très-petit, lisse, caché sous la peau, e®, partie abrité par les mas-
tcüdi^s, et le crâne se porte de près d’un quart, plus en arrière.
Le bord postérieur du crâne est divisé en trois pointes, à peu près
d’égale longueur, séparées, par deux arcs rentrans; la, mitoyenne,
qui est l’interpariétale, en triangle presque équilatéral ; p e j_ deux
dei côtés ; arrondies, Soht dues au surscapuïaire.
Lés yeux sont au bor^fetéfal de la tète et à son quart antérieur
‘en la mesurant du museJiPair sommet de la proéminence interpariétale,
et au tiers en ne mesurant; que jusqu’à l’ouïe. Leur diamètre
est d’un seizième de la longueur de la tète., et leur intervalle est
: de sept de leurs diamètres. La fente de la bouche prend la largeur
„ du museau, mais n’entame latéralement la longueur delà tête qu’aux
deux tiers de l’intervalle qui est avant l’oeil. Au milieu decet intervalle,
un peu en dedans de la commissure, est l’orifice supérieur
de la narine en ovale longitudinal,' un barbillon grêle, du quart de
la longueur de. la tête, s’attache a son angle antérieur. L’orifice inférieur
est près de h lèvre, très-petit et entouré d’une courte tubulure.
La mâchoire supérieure avance un peu plus que l’autre j les lèvres
sont charnues; à chaque mâchoire est une bande de dents en ve-
^«trs;. ©plies dten haut sontmnipea^fd^lories, et iby en a derrière
elles, au vomer-, unarc paraimMque eniveiaurs très-ras. Cette bande
est êmoiffiejïàssez large ess iritrêrie dans, lé nnlieu. Le barbillon maxillaire
part de la commissure ; il est goêle et de moitié de. la longueur
«de la têtes Le l’interne
a quelque iehosè^ inoinss La membrane des ouïes pmhrassêKsdame,
et ©stéchuïicrêe sons lui jusque sous les yeux?; ielle a dix rayons
d è ch aqæ c ô té .’
Les branchies, au nombre de quatre comme dans tous les. antres
pcûss|||s ; insèrent sur un hpesâe^fiiine kugue très-larges, aplatis
et lisses. Les râteluresvdes. branchies sont de simples dents, comprimée,
«assez courtes, dirigées en dehors .sue la branche fa^zon-
tale, et récurrentes sUrda; portion montante de Taneeau. Gelâmes
touchent le bord de l’autre hranchie par la pointe libre. Tout le
dessus de f arceau estlissefj et sans ancunehouppe ni ant res dentelures.
Les peines desTranchiessont assez courts, divisés de manière à
former deux ImésdisdiBsteài.'dfeiMlr^? que l’on pourrait dire de ce
poisson, -comme Aristote le disait du xiphias, que le harmouth a
huit branchies. Chaque peigne. interne se prolonge sur la branche
montante de l’arceau en; aine,dame frangée le long du, bord. Ces
frangès sontles esatrémités libres?dOarayons contenus dans' la Feuille
membraneuse qui constitue- cette lame^-jelles' sont analogues,aux
lames peminées des branchies, e t l’on peut juger que ^ © feuille
• jôuPum rôïé dansda respiration, à cE&se du nombre considérable
de vaisseaux «sanguins qu’elle rffoi%#t qui partent des. rayons.
La feuiUede la quatiièmebranchifi est très-peûte et rudimentaire;
niais celles des trois premiers arceaux sont; larges et jélevées, e$ redressées
sur los brauchial ÿde manière 4 protéger en dehors les
houppes que.M. Geoffeôy Saint-Hilaire a nonanées les branchies
supplémentaires du harmouth. Ces houppes ; qui oni* nomme le
dït cé savant naturaliste, une certaine reisemhianee avec les arbres
constitués par les ramifications des bronches de nos poumons aériens
, sont au nombre de deux de chaque côté î Tune antérieure,
porté® sùrTa branche montante de l’arceau de la seconde branchie;
l’autre, beaucoup plus grosse ,est sur celui de la .quatrième branchie.