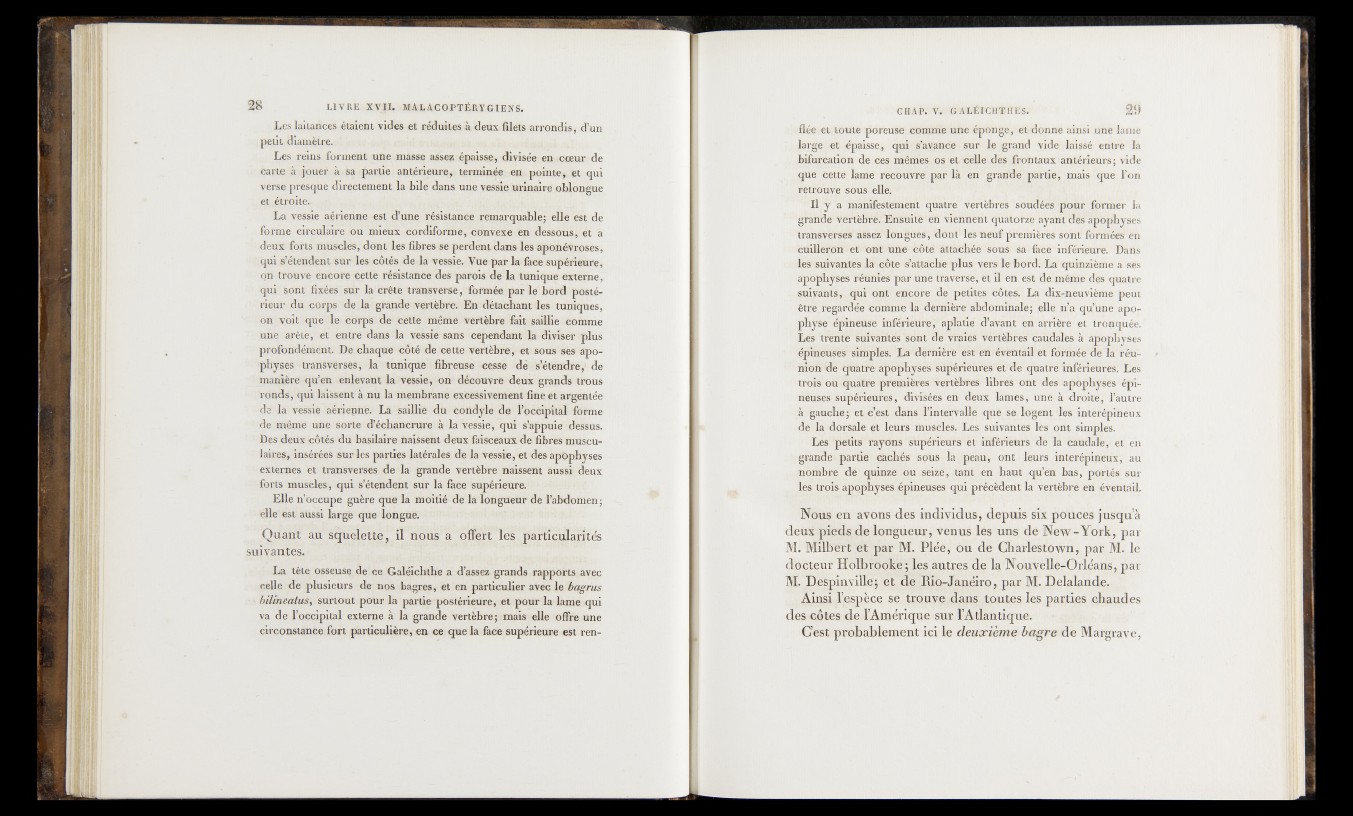
Les laitances étaient vides et réduites4 deux filets arrondis, d’un
petit diamètre. :
Les reins forment une masse asseg ,épaisse^ divisée enucceur de
carte à jouer à isa partie;antérieure,; terminée en» pointe, çt .qui
verse presque directement la bile dans une vn&^e urinaire nblongue
ett^troite.- ,
La vessie aérierine-est d’une résistance remarquable; èlle és| dé
forme circulaire ou mieux cordiforme, GÔnvexe en dessous, et à
deux forts muscles, dont les fibres se perdent dans les aponévroses,
qui s’étendent sur les côtés de la vessie. Vue par la fàcë supérieure,
gn trouve encore nette résistance des parois de la tunique externe,
qui Sont fixées sur la crêté transvérsè, formée par le bord postérieur
du corps de .la grande vertèbre. En détachant-les tuniques,
on voit que le corps; de cette même vertèbre fait saillie comme
une arête, et entre dans la vessie sans cependant la diviser plus
profondément. De chaque -côté de nette vertèbre, c t SOüs ses apophyses
tr ans verses, : la tunique fibreuse cesse de s’étendre,* de
__manière qu?eU enlevant la vessie, on! découvre deux -grands trous
'ronds, qtii laissent' à nu la membrane excessivement fine et argentée
de la vessiè aériepttë. La saillie- du edödyle de l’öe6ipital- äförme
de même une sorte d’échancrure à la Vessie, qui s’appuie dessus.
Des deux çêtésdü bagilairé naissent deux faiseéaux de fibres musculaires,
insérées sur les parties latérales de là Véssie, etïdès a p ||^ s e s
externes et transverses de la grande vertèbre naissent aussi deux
forts muscles, qui s’étendent sur la face supérieure.
Elle n’occupe guère que la moitié de la longueur de l’abdomen ;
elle est aussi large que longue.
Quant au squ e le tte , il nous a offert les particularités
suivantes, .
La tête osseuse de ce Galéichthe a d’assez grands rapports avec
celle de plusieurs de nos bagres, et en particulier avec le bagrus
bîlineatus, surtout pour la partierposférieure, et pour la lame »qui
va de l’occipital externe à" la grande vertèbre ;}inais elle offre une
circonstance fort particulière, en ce que la face supérieure est ren-
• fiée-;et» toute poreuse eomoeje une éponge, et donne ainsi une lame
la rg e ^ p a is s e ,, qui- s’avance ^sur le-grand vide' laissé entre la
bifurcation de ces mêmes, ,og excelle des frontaux antérieurs ; vide
que ; cette lame recouvre par là en grande partie, mais que l ’on
” retrquV'ë^sdüSi^lïè'r^'''
il y ‘a manifestement quatreWfrteBrës souaées^pour former la
grân’de” vëirèBfe.1 Eosüité Ai Viennent qmtorzlyayaht des apophyses
trabsVérs'eS assez loh‘|*êfes^ dont’les neuf ptëûfiérëÿ sont formées en
cuillerorf1 e#%ftt uâé 4 ôtë‘ ittaidiéc AoUs* sa-faôë 'inférieure. Dans
les suivantes Ja .côte »’attache plus» vers le bord. La quinzième à ses
apophy&es-^réhrîïes' par ûn^tPavër^^, et il en est de même des quatre
suivants, qui o ® ’ ptçhrq^éypptipp, côtes. La dix-neuvième1 peut
êtreJrégârGé,Â^mm e la dernlerë abdominale; .plie, n’a qu’une apophyse
épineuse inférieure^ aplatie Idwant en arrière et tronquée.
Les trente suivantes^onfdë Traies vêrfèjîfes^’caudales à âpophyses
épiri&hfets^siffîplës. La d émi’ère est- 'elî! évfentâil'et formée de la réu-
ni'ofi^te qohtrë SpO-physèV 'siipérîeùrëâ^èt1 de" quatre mféiàeüres. Les
t’rb^d'U'fqua'tife premières vertèbres‘ libres ont des -apophyses épi-
nèuses süpériéùreV, divisé^ en deux lamfes, une à-droite, l’autre
à gaiidhe"; et « ’est dans fintAfvalile que, se, logent des ipterépineux
aMfer dorsale et leürs mUg<?lifes|îLes suivantes'les ont simples.
Les'petits rayons supérieurs et inférieurs de la cauda%, ét eh
grande-partie cachés « o u s p e a u * ont leurs interépineux,: au
nombre de quinze ou .seize, tant en hapt qu’en bas, portés sur
■ les trois apophyses épineuses qui précèdent la vertèbre en éventaiil.
Nous a avons des individus* depuis six pouces ju sq u ’à
deux p ie d s do lon gu eu r* v enu s les uns de N ew -Y o r k * pa r
M; M ilb e ït et par M. P lé e ,! ou de Cha rle stown, p a t M. le
do c teu r H o lb ro o k e ; les autres de l^ N o u v è île -O rle an s, pa r
M. De spinv iïle j et de B io - Ja n é iro , par M. Delalande.
A in s i^ ’e s p ^ g sè trouv e dans .to-utes les parties chaudes
d e sp o te s de l’A in érique sur l’Atlantique.
G’est probablement ici le d e u x ièm e b a g r e û t Margrave,