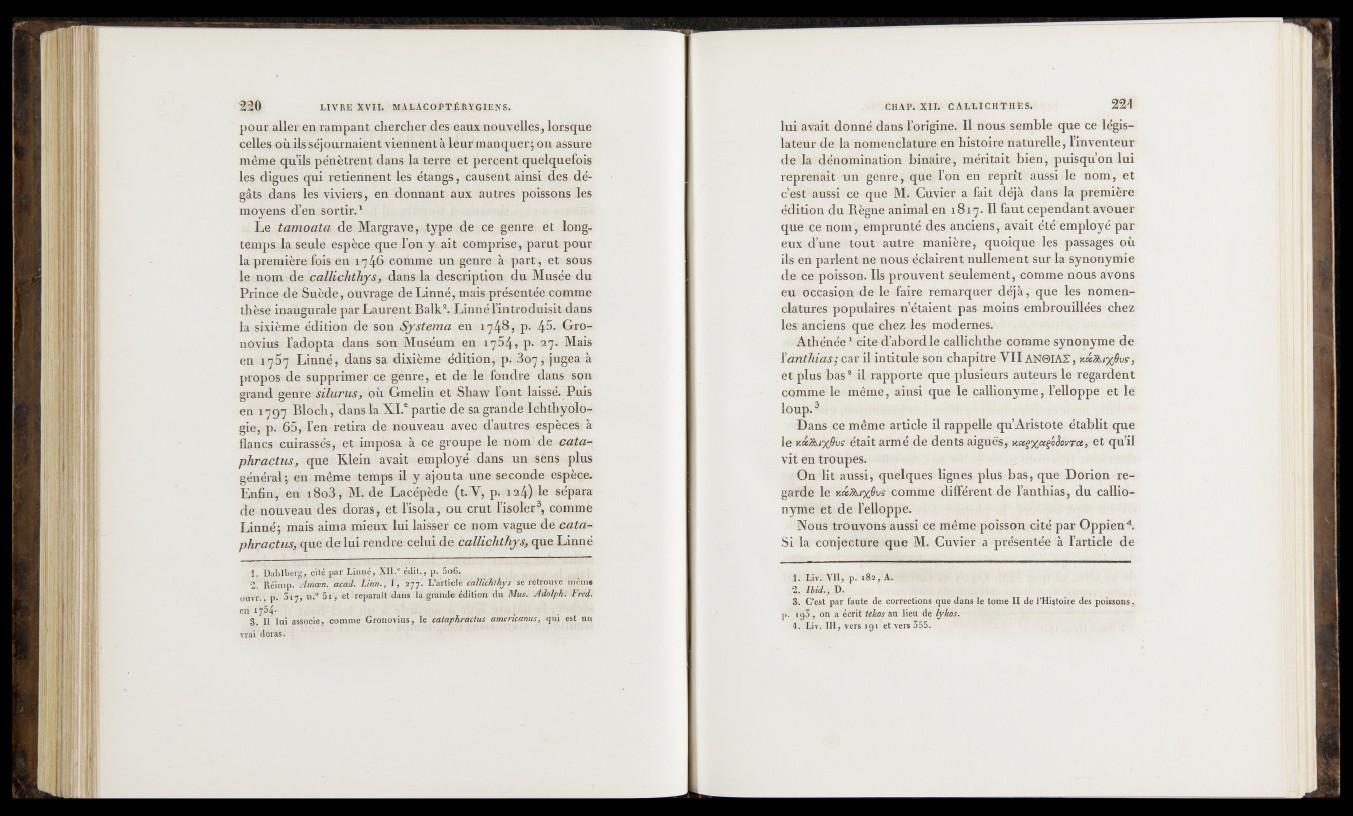
220
pour aller en rampant cher cherdçs eaux nouvelles , lorsque
celles où ils séjournaient viennent à leur‘manqueripon assure
même qu’ils pénètrent dans la terre et percent quelquefois
les digues qui retiennent les étangs, causent ainsi des dégâts
dans les viviers, en donnant aux autres poissons les
moyens d’en sortir.1
Le tamoata der Margrave, type ,de oe genre et long-
tempsla seule espèce que l’on y. ait comprise., parut pour
la première, fois en 17.4Ü nomme un genre, à parUy et* sous
le nom de calUchthySy dans la description du Musée du
Prince de Suède, ouvrage de Linné, mais présentée comme
th èsé inaugurale par Laüren ti B alk K :Liun é l’in tro^iwsit dans
la sixième édition de son Systema en /i 748? p- ’ 45- Gsro-
novius l’adopta dans son Muséum en Mais
en i y% Linné j dans sa dixième léâiÊiiümp&fà&q- pfugeæfc*à-
proposa de supprimer ce î^nrqA ot de de* fondée dans; son
grand genre silurus, où Gmelin et Shaw l’ont laissé. Puis
en;* w j Bloch,Mans la Xtt.etpartie de sa grande Ichthyolo-
gie, p. 65, l’en retira de nouveau avec d’autres, espèces^ à
flancs cuirassés,* et imposa à cè groupe le nom de cata-
phractus, que Klein avait employé dans, un sens plus
général y én même «temps il y ; ajouta une. seconde espÉUe#
Enfin, enytBoây.M&de Lacépède (t..¥, p^ma^le sépUta
de nouveau des doras, efed’isok j; ou crut l’isoler^ comme
Linné; mais aima mieux lui laisser ce nom vague Aè catn-
phraçtm,^p& dplui rendre celui de callickthy% que Linné
1 cité par Linsé, XlI.e,édiL,
W W oeM W b B? acad. Liriïi., 1 , 2 7 7 ; Ü arlîâe'caU um ^irW retrouvemême
oûrr. , 3 >V ét Jréparaît dans lAgrëmd&édïtistf'du MussiÆàfyhtWkd.
e s . r j$ £ î; f ; j ij-sff-1 ' ; .* I : V » 91 & '0 ffjl M M j|sp
3. U lui associe, .comme Gronovius, Wcàtaphractus amencanus, qïn est uri
vrai doras. |
lui avait donné dans l’origine. Il nous'semble que ce législateur
de la nomenclature en histoire naturelle, ^inventeur
d e là dénominations binait-e., méritait bien,. puisqu’on lui
raptenàit un ' genref que l’on- en Pèprif^aiis&i de nom, et
c’estnanssi^ ce que M-, Cuvier a fait' déjà dans la première
édition du.Règne animal eiiifl.^. Il faut Cependant avouer
que' ce nom,< emprunté dies;anciens, avait été'employé par
eux d’une -tout autre manière, quoique les passages où
ils en; pla rient la synonymie
de* ce poisson. Ils prouvent séelcuient, »Gomme nous avons
eu, occasion de le foire remarquer déjà,* que les nomenclatures
pOpulaifes nétaieUt-pas moins embrouilléeS chez
les* anciens .que: chez les$modernes.
AtheftéGL-cite d’abord le ©allichthe comme synonyme de
Ycmthias; car il intitule son chapitre VII AN0ÏA£, Kcc&.i%ôvsy
etplus bas2 il rapporte que plusieurs aüt'eurs le regardent
comme le même, ainsi que le callionyme, l’elloppe et le
loup.3
Dans ce même article il rappelle qu’Aristote établit que
le était armé de dents aiguës;, Kuç%ctçoSovrctïet qu’il
vit en troupes* ;
On lit aussi, quelques;lignes plus bas, que; Dorion regarde
le KC6%.t%ôvs comme different de l’anthias, du callionyme
et de felloppe.
Nous trouvons aussi ce même pufssqiicité par Oppién4.
Si la conjecture que M.: Gùvier a: pftfeentéè à l’article de
1. Liv.i V3I,Tfp$ii82, A,
SI. Ibid., D.
3. C’est par faute de corrections que dans le tonie II de l’Histoire des poissons,
p. 1 ç} 3 ,. oti a écrit tekos au lieu;de Ifkosi-
4. Liv. III, versirgi et vers 355»;',