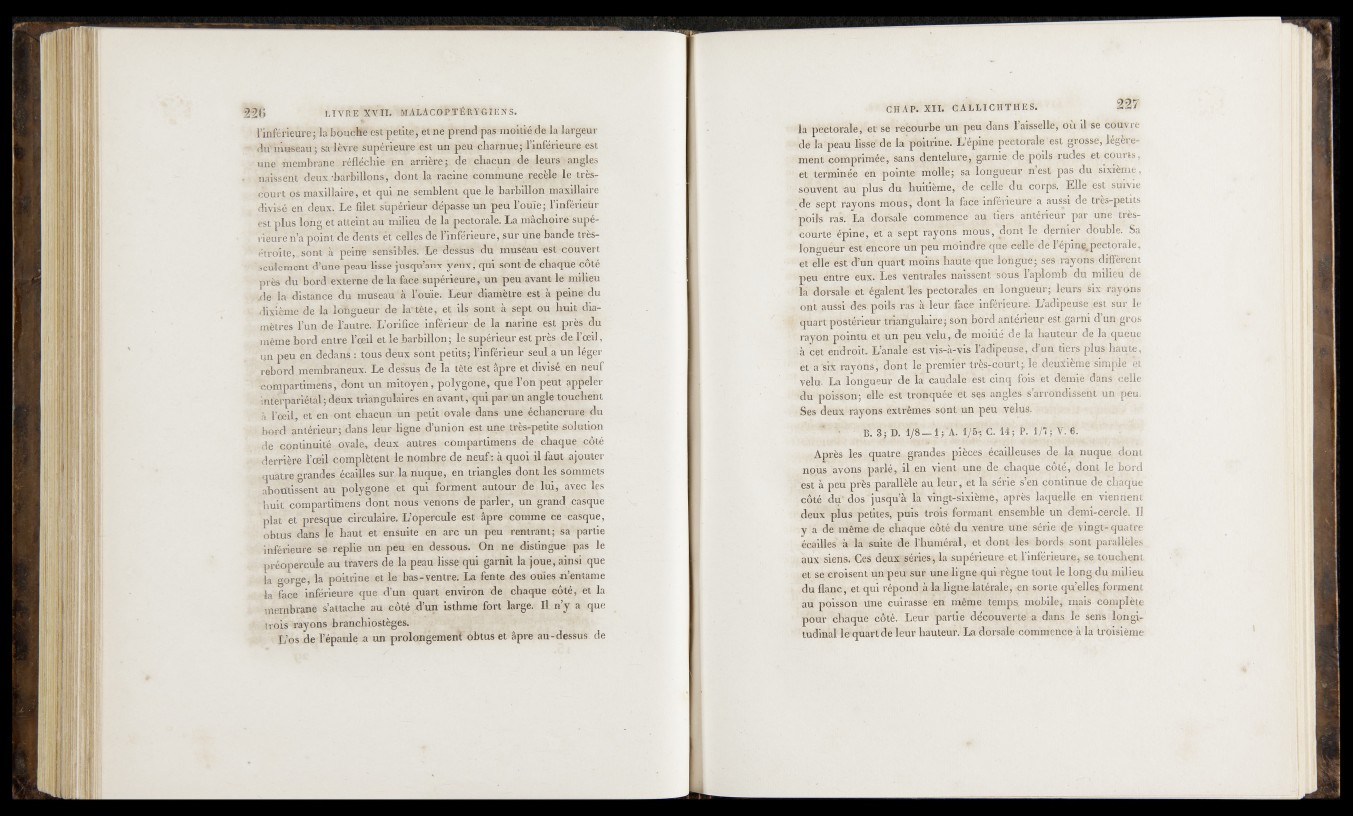
2 2 0 L IV R E X V II. MÀLAC.OP.TÉRYGIENS.
vEinférieure«la bbucllé estpetiite, et ne {»rend pas moitié de la largeur
du'museau; salèvre supérieure est un peu charnue; l’mférieme est
une mcmbiane réfléchie en ariicre;, ^.eÿcliacun de leursj angles
- naissent'deux-barbillons., dont la l'açine commune recèle le très-'
cburt os maxillaire, et qui ne semblent que.le barbillon maxillaire
divisé,, en deux. Le filet supérieur .dépasse un peu l’oipé; l'inférieur
est plus long et atteint au milieu de la pectorale. La mâchoire.s,upé-
. ueure n’a point de dents et celles de l’inférieure, sur une bande fpès-
''leB®étlïent d%îfeqiëaü4isse jùsqtfaux yeux,' qui sont'dé «haque udté
près du bard?e‘xterne dtria fece supérieure , un -peu avant; te milieu
. .de la distfefiçe du müseau àdferne. Leur diamètre est à peine du
dixième-de la longueur de la’tète, et ils sam.;à.%£qpt ou huit diamètres
l’un de l’autre.‘L’orifidçpinférifitn-'^e la narine est près-du
même bord entre l’oeil et le barbillon ;, le.ju^érieur est près. d.e^l’peil,
un peu en dedansj tpus deux sont petits; 1 inférieur seul.a un léger
rebord.membraneux! Le dessus Se îâ lêt’ê esT^pre et divisé, en neuf
’■ éompartimens, dont un mitoyen, polygônè, que l’on peut appeler
interpariétal;déux triangulaires en avant, qui par un angle touchent
à l’oeil et en ont chacun un petit ?ôyale dans une échancrur-e du
bord antérieur; dans leur ligne d’union est une très^petite solution
de continuité .ovale, deux autres gcpmpartimens de cbaquç.côté
derrière l’oeil complètent le nomly^.de neuf5: à quoi il fayt ^qnter
quatre grandes écai|les sur la. nuque, en triangles dont les sommets
aboutissent âu polygone .et qui forment automùdé lui, avril
“huit compartiinens^dont nous'venons de parler, un grand^casque
plat et presque circulaire. L’opercule est âpre comme ce casque,
obtus dahs lè haut et ensuite en are un peu rentrant; s a ’ partie
inférieure se replie un- pèu en dessous. On ne distingue* pas le
préc^erculfe au travers delà peamiifsf'iqni garnît laqmae j. ainsi que
la gorge ; là poitrine et lie bas- ventre; La fente, des ouïes n’entame
la face inférieure^»que d’un quart environ de chaque noté, dt .la
meinbraùé s’attache au. côté d ’un isthme fort large. Il n’y a que
s trois rayons branchiostèges.
. L’os jde l’épanle a nn prolangememf obtus et âpre au-dessus, de
la pè^orafo,*oeP së' recourbe uré peu-dans l’aisselfe, où .ihse è#ù?re
de-la peau liss#de la poitrine.-L’épine peëto'jrale est grosse, .légèrement
comprimée, sans dentelure,^ garnie;de poils rudes etcpurts,
et terminée en pointe molle; sa longueur n est, pas du sixième,,
Souvent 'au;’plus du huitième, de belle du corps. Elle .est suivie
de'sept' rayons mous, dont la‘ face inférieure a aussi de très-petits
®joife ras. La doifeafe '-commence a ltie rs , antérieur ptfr une très-
-coùrte épine, et a sept rayons mous, dont le dernier double: Sa
longueur est encore un peu moindre que celle de l'épine.pectorale,
et elle est d’un quart moins haute que longue; ses rayons diffèrent
peu entre eux. Les ventrales naisseni sOùs: l’aplomb du milieu de
là dorsale et égalent les pectorales en longueur; leurs six rayons
- ont aussi des: poils -ràs à leur face inférieure! L’adipeuse est sur le
. quart postérieur triangulaire; son bord antérieur est.garni d’un-.gros
’ rayon pointu et un peu velu,, de moitié de la hauteur de la qiuéue
•à cet endroit.. L’anale'- est vis-à-vis' 1 adipeuse, d’un tiers plus haute,
et a six rayons, dont le premiér .très-court;, le. deuxième simple et
vélu- La longueur de la caudale .est cinq fois et. demie dans celle
du poisson; elle est tronquéefet ses! angles s'arrondissent un peu.
Ses deux rayons extrêmes sont sun peu vitù f > 2
N B. 3 ; B! 1 > l ! i f ? 'î» '?W ; Y . é.
Après les quatre^ grande^p^qe^écai^euses^de la nuque^ dont
npus avoxisvpaçlèyll^e^y.ie^uunç> dq^chaque jcotç, dpn^ Iebprd
'est à peu près parallèle àufeùivét lti-serie s*éü çëminue de çiraqùe
coté du^dosJ jusqu’à' 1a vingt-sixième, apfèfc laquelle en viennent
deux -plus petites, puis trois- formant ensemble un demi-cercle. Il
y: a de même dfe chaqrae côtridu centre üné.série de rings* quatre
écailles à la suite de l’humeial, et dont les bords sont parallèles
aux siens. Ces, deux^éries , ija*snpérieum et ^
et sç*l»qisent unpétfsur unedi'gne^mfègnfi tom^e lon-g.du.milieu
du flanc», et,.qui répond;à!a,ligne,4at.ér.ale, en sorte qu’elle^fbrfpent
au poisson une cuirasse en même temps mobile, mais Cor»piètre
pour chaque partie découverte^a dans ,fe seiis longitudinal
leqùartdeleur hauteur.1 La dorsale commence-Ma troisième