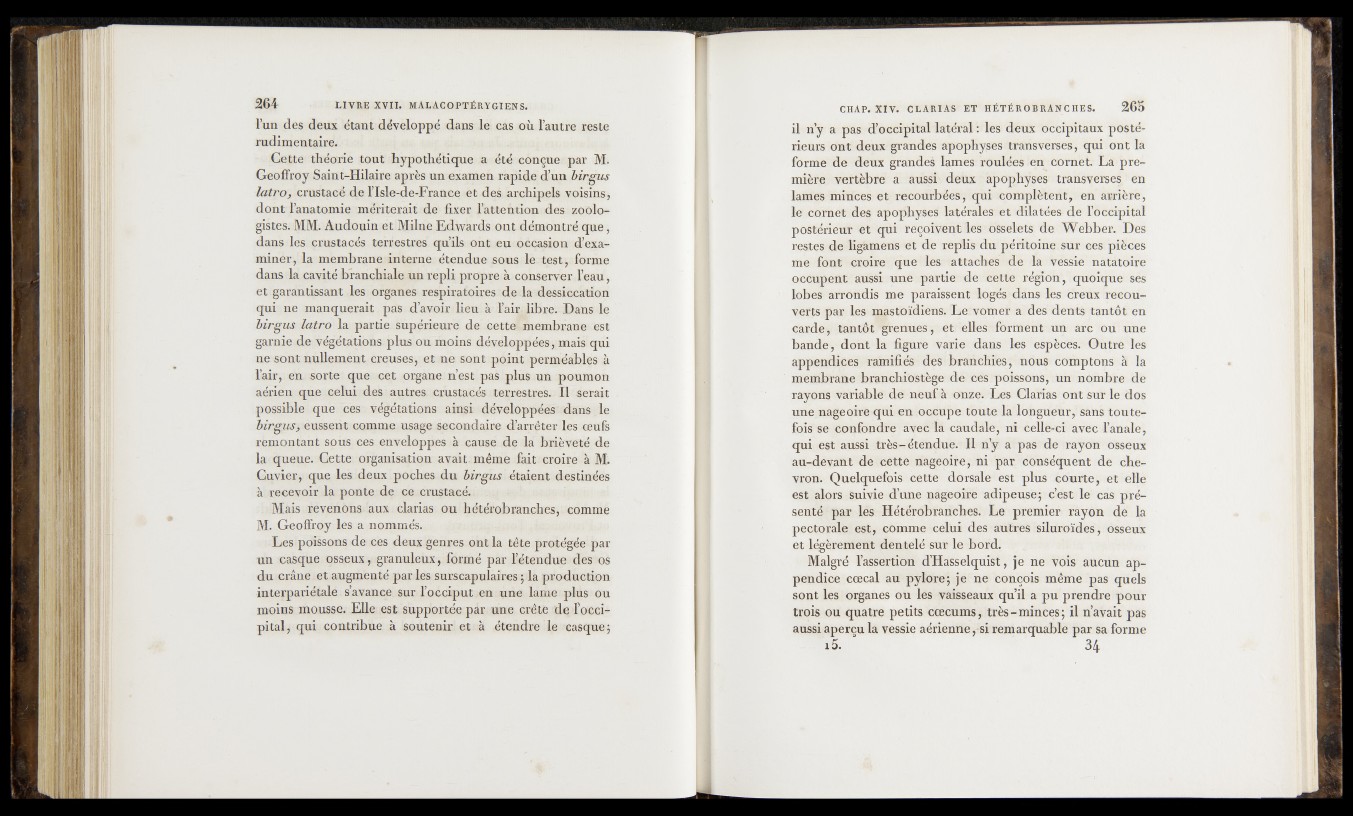
264- LIVRE XVII.
l’un des deux étant développé dans le cas où l’autre reste
rudimentaire.
C e tte th éo rie to u t h y p o th é tiq u e a é té conçue: par M.
Geoffroy Sain t-H ilaire après u n examen rap id e d ’u n birgus
latroy cru stacé d e HsIe-de-Franee -èt dés» a rch ip e ls voisins,
d o n t l’anatomie m é rite ra it d e fixer r a tte n tio n :des zo o lo -
gistesaMM. A u d o u in et:Milne E d ^ f e d ê io n t d ém o n tré q u e ,
dans lesiçru stacés terrestres q u ’ils ..ont e u 'o c c a sio n d ’exam
in e r, la m em b ran em n te rn e ié ten d u e ÆOus le a tp sty fo rm e
dans la! cavité b ran ch ia le u n rep li p ro p re à >conserver l’e a u ,
e t .garantissant des organes Respma&firesAdja^aAlesshseâtibn
q u i n e m an q u e ra it pas d ’avoir lieuià*' l’aindibijec D an s le
birgus latro la partie,sup,ôrieure de! cetteCmeMibrane est
garnie:de végétatibns p lus o u moins développées „mais q u i
n e so n t nullemen t, creuses, e t n e so n t p o in t perméables à
l’a ir, em sorte q u eace|t organe.; n ’est pas p lu s ,u n p o um o n
aérien q u e x e lu i des aiitres c ru s ta c é si te rrestres. I l se ra it
p o ssible queVéfâ^ végétations a in s i rléveloppééss dans le
ù ù ’gp&s'jîeussent ctmime usageusecondaire d ’a rrê te r 'les'æeufs
rem o n ta n t spùsj ces. enveloppes à -cause .de la b rièv e té de
la queue» 'GétaciUJrganisa|Âeii avait même f a it1 croire a M.
Gqvier, q u e les d eux poches d u ù r r g k ^ é te ie n t destinées
àbrecevoir la p o n te d e c éx ru sta e é ït; i3
I ;-Màis revenbnsti.’aux clarias o u i h é t érobranohresp commé
M. Geoffroy les^a/nommés«. -
Lespdïssons de.ces deux genres oht la tête protégée par
un casque pss,eux yugranuleüx, formé par MtenÉue des*3«©s
du i crâne J et augmenté p ar les surs capulairesr; :1a production
interpariétale s’avance, sur l’occiput en une lame plus ou
moins mousse. Elle .est supportée pàr une crête dq »l’occipital,
qui < contribue, Jt Isbutenirl etuà .étendre le xasque ;
CH A P. XIV. CLARIAS ET HÉTÉROBRAN CHES. 265
il n’y a pas d?occipitaliatéral : les deux occipitaux postérieurs
ont deux grandes apophyses transverses, qui ont la
forme de deux grandes lames roulées en cornet. La première
vertèbre^ai aussi deux apophyses transverses en
lames minces et recourbées,1 qui .complètent, en arrière,
le cornet des apophyses latérales^et dilatées de l’occipital
postérieur et qui reçoivent les oiselets de Webber. Des
restes de ligamens et de replis1 du péritoine, sur ces pièces
me font croire que les “'attaches de la vessie natatoire
occupent aussi une partie de cette région*, quoique ses
lobes arrondis me paraissent dogés;dans les creux recouverts
par l,est mastoïdiens. Le*vomer^a des dents tantôt en
eardeytantot^grenues, et réellesfo raient un arc ou une
bande, dont la figure varie dans les espèces. Outré les
appendices ramifiés - des1 brainchifesp.nous comptons! a la
membrane branchiostège de eés‘poissons, un nombre de
rayons variable do neuf à onze. Les Clarias ont sur le dos
une.nageoire qui en occupe toute la longueur," sans toutefois
se confondre avec la caudâle, ni cellè-*ci avec l’anale,
qui est aussi Jrès'-r étendue. • Il n’y a pas de rayon osseux
au-devant de cette nageoire, ni par. 'donséquent de chevron
» Quelquefois eètté dorsale est plus éourte, et elle
est alors suivie d’une nageoiré adipeuse; c’ést le cas présent^
par lés Hétérobranchesi Le premier rayon dé la
pectorale; est, comme celui des autres siluroïdes, osseux
et légèrement dentelé sur le bord.
Malgré l’assertion d’Iïasselquist, je ne Ÿois aucun appendice
coecal au pylore ;ge ne conçois même pas quels
sont les organes ou les vaisseaux qu’il a pu prendre pour
trois ou quatre petits cæcums, très - minces ; il n’avait pas
aussi aperçu la vessie aérienne,-si remarquable par sa forme
i 5. “ 3 4