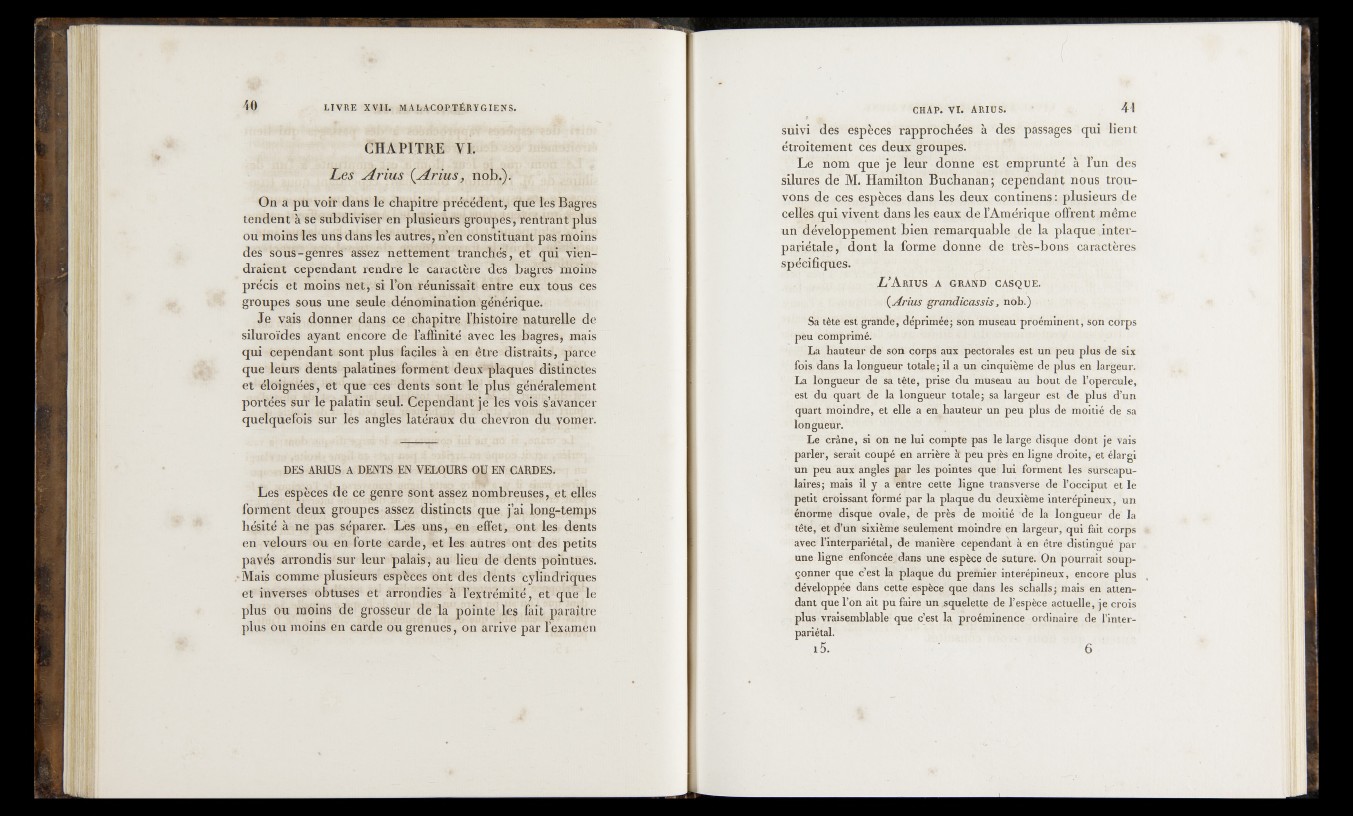
CHAPITRE MM
■£é$ A r iu s (A r iu s , nofc^jV
On a pti. voit'dàrtiâ le chapitre précédent, que les Bagres
tendenù*i%è süKdi¥î^iv en^plôsifeûi^^gl^ikpti^^ëétïànf plus
ou moins les uns dan^iès’ âAtr^ l^én constituant pas moins
des sous - gén’rès’ fs$êez ‘nettement; trancîfésf ét1 <|uîfvPen-
draient cependant rendre le caractère dés hantés' lirioins
précis et moins net, si lvon réunissait entre eux tous lés
groupes sous une seule.dénomination générique. *
Je vais donner dans ce chapitre l’iiistoire naturelle dé
siluroïdes ayant encore de laffinité-avèe» les-bagres, mais
qui cependant sont plus faciles à :e® être distraits!, ^ 8 c e
que leurs dents palatines forment1 déh#spaquæs distiiK^es
et; étoignéês’, et que ees dents sont le plus généralement
poWpil'Sut lé pamîittééub Cependant fêlés'vp^^^nnçer
quelquefois sur lés“ ââgm^latærà^x dm cnevten dÇ^op|er.
DES ABttJS . A DSSmpN VEEOTRS ( |jM Æ A R D lS r
Tes* especes de cl genre sont assez nombreuses . J t elles
forment deux groupes assez distincts que, j^ai long-temps
hésité A-né pas, séparer. Les un#,-enTeff^t, ©nt« les* dents
e4-^lern®sfoiMisei*'forte ©arde,let lest autres-1 ont? des petits
pavés arrondisf sur leuv^afeisr; au lie# de'#enlfô pëibtfflés.
Mais comme pki£^j#ëS|&gél' ont des dents cylindriques
et1 invéïSéS ,éltiîsiè^ èt* â¥iohdiésPa~Lél^iîiîïë 3 eT^^iièit;le
pldé Ou moins deé^tdi§^f HflTa poihie ^f e s J a r a r t r e
pliis ou moins en cardé ou grenues, ©n arrive par 1 çxaro,en
suivi dès espèces rapprochées à des passages qui lient
étroitement ces deux groupés.
Le nom que je leur donne est emprunté à l’un des
silures de. M. Hamilton Buchanan; cependant nous trouvons
de ^ces^espèces dans les deux continens : plusieurs de
celles qui vivent dans les eaux de l’Amérique offrent même
un développement bien remarquable^cle la plaque vinter-
pari.étale, dont la forme donne de très-bons caractères
spécifiques.
Z / A rIUS A GRAND CASQUE, [il
. (A riu s. grandicassis, nob.) -
Sa tête est grande, déprimée; son museau proéminent, son corps
’ peu comprimé.
La hauteur de son corps aux pectorales est un peu plus de six
fois, dans la longueur totale; il a un Cinquième de plus en largeur.
La longueur de sa tête, prise du museau au bout de l’opercule,
est du quart de la longueur totale; sa largeur est de plus d’un
quart moindre, ,èt?jelle a en hauteur un peu plus de moitié de sa
longueur.
Le crâne, si on ne lui compté pas le large disque dont je vais
, parler,1 serait coupé en arrière S peu près en ligne droite, et élargi
un peu aux angles par les pointés que lui forment les surscapulaires;
mais il y a ^ntre cette ligne transversé de l’occiput et le
petit croissant formé par la plaque dü deuxième interépineux, un
énorme disque ovale," de près de moitié ‘de la longueur de la
tête, et d’un sixième seulerpent moindre en largeur, qui fait corps
avec l’interpariétal, de manière cependant à en être distingué pat-
une ligné enfoncée;dans une espèce de suture. On pourrait soupçonner
que cest la plaque du preftiier interépineux, encore plus
développée dans cètte espèce que . dans les schalls ; mais en attendant
que l’on ait pu faire un squelette de l’espèce actuelle, je. crois
plus vraisemblable que c’est la proéminence ordinaire de l’inter-
pariétal.
l 5 . 6