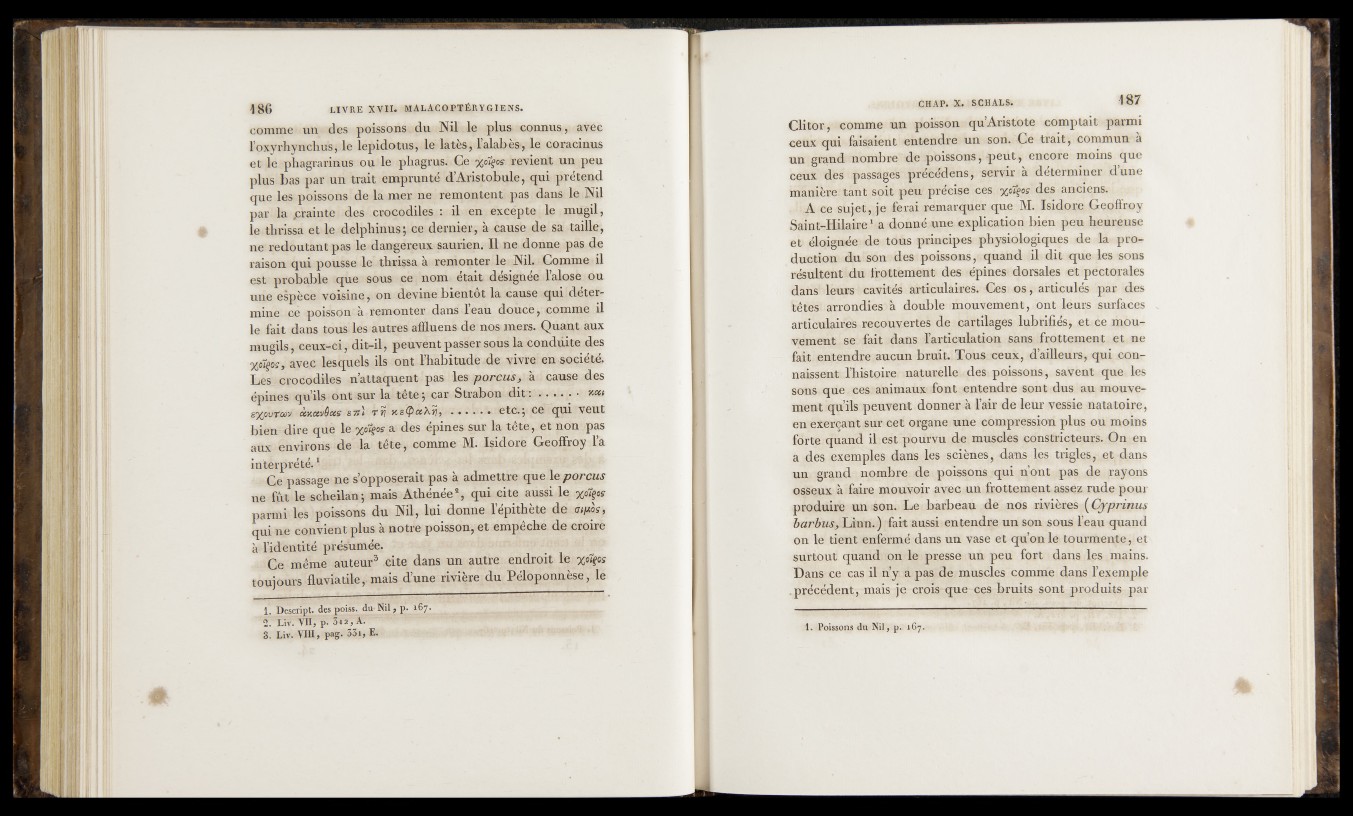
comme un des poissons. du NiL le plus connus,»>&&&
l’oxyrhynchus* le lepidotus, le latès., l’alabès-, le coraeinus
e t^ a phagrarinus oij^le^hagrusi-.Êje revient u n ,peu
plus bas par un trait emprunté d’Aristobitle, qui prétend
que les poissons de la meï.vne..remopJ^pastdân^.JàiHïl
par la .crainte des crocodiles il en ek€^ptet le mngilj
le thrissa el le delphinus5.ee dernier, à cause de sa. taille,
ne redoutant pas le-dangereux saurien. Il ne* donne pas de
raison qui pousse leIthçifsa à remonter lei^iWGommeil
est probable ajhe sous ce nom était désignée l’alose qu
une espèce voisiner on devine bientôt Ifccause qui ctetgr-
mine^nê ^oidsônc-à, tera^te*.- dans d’eaii disuee^xeomme il
le fait dans tous, les autres affluens de nos mers. Quant aux
mugils j ceux-ci, dit-il, peuvent passer, sous la conduite des
5S#oî> ayep lesquels ils ont Ibabitude de vivre? en,société»
Les crocodiles n’attaquent pas les poveus, a . cause des
épines qu’ils - ont sur la tèteycar Strabon dit : .. . . . • K&
£%Mj!pMvl ccKcevôotç ' g rifks(p.ctXviiy^ i» . ... . eti^jf icé'qui veut
bien dire que \c %oïços a des épines sur la- tête, et nonvpas
aux environs de la tête, comme M. Isidore Gep^roy fa
interprété.^“
» jQé passage ne s’opposerait pas a admettre quele porcus
ne fjxt le scbeilan; mais Athénée®, qui cite aussidq
parmi les poissons du Nil, lui donne.l’épithète de vms,
qui ne convient plus à notre poisson, et empêche. de croire
àd’identité présumée. - r ; a
Ce m êm e auteur3 cite dans un autre endroit le-%«*or
toujours fluviatile, mais d’une rivière du Péloponnèse, le
1. bescript. des poiss. du- ifol, P»
'ff'îiv . Tff,
3. J*T. YIH, pagrffli, E.
Clitor , iieoimme un poisson qu’Aristote comptait parmi
ceux qui faisaient entendre un son. Ce trait^ commun a
un grand nombre de poissons, «peut* encore moins que
ceux des passages préëe'dens j servir à déterminer id une
manièM?|tânt spit peu/ précise ces %©fe5'des anciens.
A ce sujet, je ferai remarquer que M. Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire1 a donné une explication bien peu heureuse
et* élqdgaïéode tous principes physiologiques de la production
sourdes poissons,«quand ib dit que les isons
résuhtentidu frottement des mpinesïdorsales é le c to ra les
dans’ leurs cavités articulaires. Ces os,articulés par des
létesLarropdiesDli double mouvement, ont leurs surfaces
articulaires recouvertes de cartilages lubrifiésj. et ce mouvement
se fait ..dans l’articulation sans frottement et « ne
fait enltêndre/aucun bruit.. Tous ceux, d’ailleurs, qui jEion-
naisseafelbfeteieet' natui5ellettdesipoissons, savent que, les
sons- qüe,ces^animaux font entendre sont dus au mouvement
qu’ils peuvent donner à l’air de leur vessie natatoire,
en exerçant sur cet organe une compression plus ou moins
forte quand il;est pourvu de muscles çons&icteurs. Ornen
a des exemples dans les sciènes, danslgs trigles^et, dans
un gra^nd ;,nombre de poissons qui n ont pas. de rayons
osseux à faire mouvoir avec un frottement assez rude pour
produire un «on» Le barbeau de nos iimm^;{Cjrprmus
barbus, Linn. ) Lit aussi entendre un son sons l’eau quand
on le tient enfermé dans un vase et qu’on le tourmente,;et
surtout quand, on le presse un peu fort dans les»,mains.
Dans ce cas il ny a pas de muscles comme dans l’exemple
. précédent, mais je crois- que ees bruits sont produits par
1 .-Poissons dû Nil, p.. 1 6 7 .