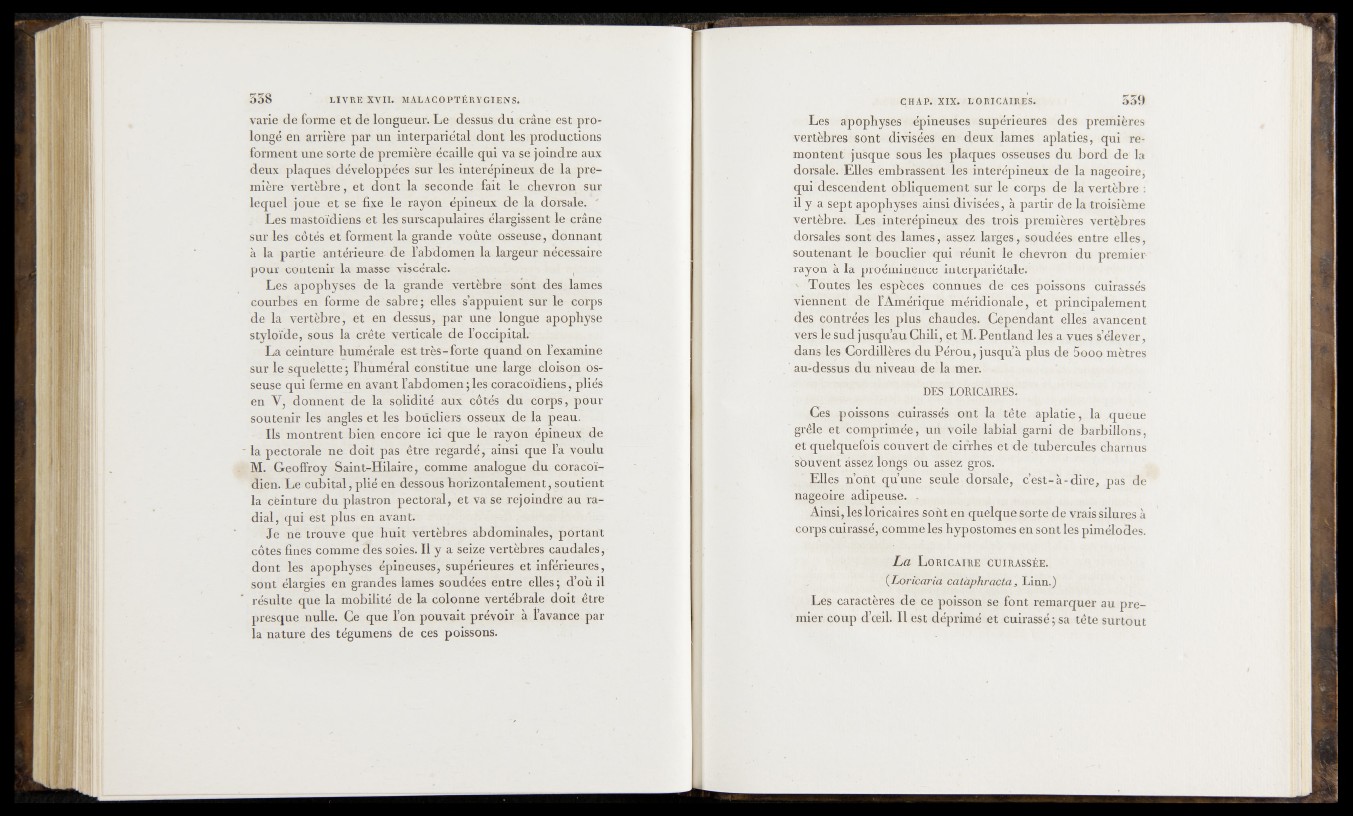
338 ’ LIVRE XYII. MALACaPTiÉRY&IENS;
varie de forme et de longueur. Le dessus, du crâne e&t prolongé
en arrière par un interpariétal , dont leSiproductions
forment une sorte de prémâèrèMcaille qui va sûfoibdre aux
deux plaques développées sur les interépinëux de la première
vertèbre, et dont la seconde fait le „chevron sur
lequel joue et se fixe le rayon épineux de la dorsale, f
j Les mastoïdiens et les surscapulaires élargissent le crâne
sur les côtés et forment la grande voûte osseuse, /doünant
à la partie antérieure de l’abdomen la largeurHÈieçefsaire
pour contenir la masse viscérale. |
Lés apophyses dé la grande vertèbre sont des lames
courbes en forme de sabre; elles s’appuient sur le corps
de la vertèbre J et en dessus, par une longue apophyse
styloïde, sous la crête verticale de l'occipital.'
La ceinture humérale est très-forte quand ou l'examine
sur le squelette ; Fhuméral constitue une large cloison Oiseuse
qui ferme en avant l’abdomen ; les coracoïdiens , pliés
en V, donnent de la solidité aux côtés, du corps, pour
soutenir les angles et les boucliers osseux de la peau,
Ils montrent bien encore ici que le rayon épineux de,
la pectorale ne doit pas être regarde|~ainsi' que la voulu
M. Geoffroy Saint^Hilairej comme analogue>4 u corâcoï-
dien. Le cubital, plié en dessous horizontalement ^soutient
la cfeinture du plastron pectoral, et va &é rejoindre? au radial,
qui est plus en avant.
Je né. trouve que huit vertèbres abdominales, portant
côtes fines comme des soies. Il y a seize, vertèbres caudales ;
dont les apophyses épineuses, supérieures et inférieures,
sont élargies en grandes lames soudées entre elles ; d’ou il
résulte que la mobilité de la colonne vertébrale doit être
presque nulle. Ce que l’on pouvait prévoir à l’avance par
la nature des tégumens de ces poissons.
CH AP. XIX. L'ORICAIRES. . 339
Les apophyses épineuses supérieures des premières
vertèbres sont divisées en deux lames aplaties, qui re+
montent jusque sous les plaques osseuses du bord de la
dorsale. Elles embrassent les interépineux de la nageoire;
qui descendent obliquement sur le corps de la vertèbre :
l:ityt;a sept apophyses.ainsi divisées, à partir de la troisième
vertèbre. Les. interépineux des trois premières vertèbres
dorsales sont des lames, assez larges.,■ soudées entre elles,
soutenant le bouclier qui réunit le chevron du premier
rayon à'la proéminence interpariétale.
9 Tôutés, les connues der‘ cés poissons cuirassés
vienûent.de l’Amérique méridionale, et principalement
dejflcontroes les plus chaudes. Cependant elles avancent
vejçs le sud jusqu’au Chili, et M. Pendand les a vues s’élever,
dansdes,Cordillères du Pérou, jusqu’à plus de 5ooo mètres
au-dessus du niveau de la mer.
DES LQRICAIRES.
Ces poissons -cuirassés ont la tête aplatie, la quèue
grêle et comprimée , un voile labial garni de barbillons,
jet quelqueftfis couvert de éi Ah es et de tubercules charnus
sbuvent àssèzlbügs ou assez gros.
^ ' EJJes nçnt qu’une seule dprsale, c’est-à-dire, pas de*
nagjqqpe adipeuse,. ^ ^
Ainsi, les Ipripair^s spht en quelque sorte de vrais silures à
corps cuirassé, comme les hypostomes en sont les pimélodes.
L a L o r ic a ir e c u ira s s é e .
* (Loricaria catàphracta, Lion.)
Les caractères de ce poisson se font remarquer au premier
coup d’oeil. Il est déprimé et cuirassé ; sa tête surtout