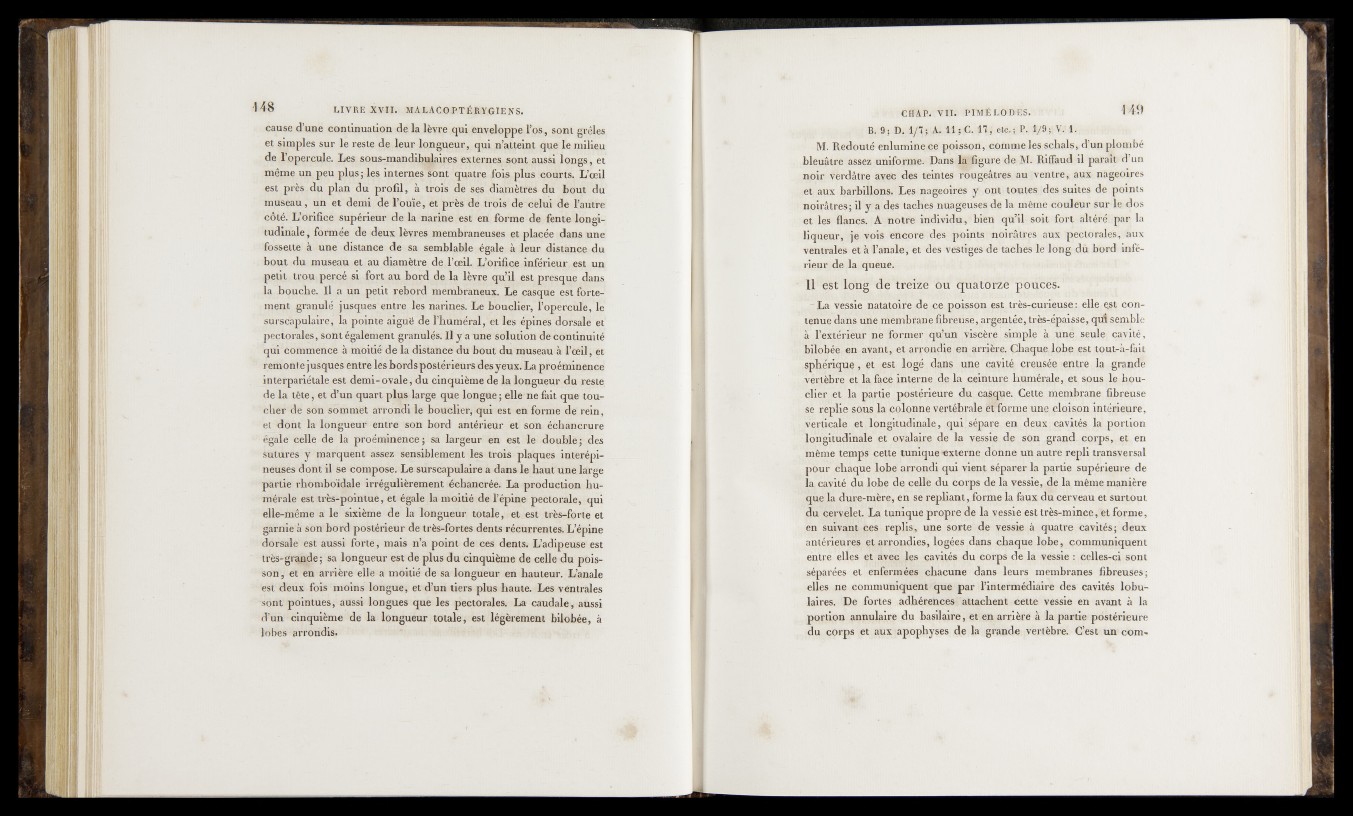
4 4 8 L I V R E X V I I . M Â ;& A C # i> .T É R .Y ! ( Î IE N S .
cause d’une continuation de la lèvre qui enveloppe l’os, sont grêles
et simples sur le reste de leur longueur, qui n’atteint que le milieu
de 1’,opercule. Les sous-mandi^^^ires externes sont aussi longs» et
même un. peu plus; les internes sont quatre loi,srplus couprts, L’oeil
est près du plan du profil, à trois de ses diamètres du bout du
museau, un et demi de l’ouïe, et près de frdis de celui de l'autre
côté. L’orifice supérieur de lia narine est en forme de fente longitudinale
, formée de deux lèvres membraneuses et placée dans une
fossette à une distance de sa semblable égale a^euf distance du
bout du museau et au diamètre d ^ l’oeil. L’orifice inférieur est un
petit trou.percé si fort au bord de la lèvre qu’il est presque dans
la bouche. Il^a un petit rebord membraneux. Lé casque est fortement
granulé jusques*entre les narines. Le bouclier, i’ojjèrçtilè, le
surscapulaire, la pointe aiguë de rÈuméral^Uties épines dorsale et'
pectorales, sont également granulés. Il y a une solution de continuité
qui commence à moitié de la distance du bout du museau à l’oeil, et
r emonte jusques entre les bords postérieurs des y eux. La proéminence
interpariétale est demi-ovale, du cinquième de la. longueur du reste
de la tète, et d’un quart plus large que longue ; elleme fait que toucher
dé son sommet arrondi le bouclier; qui est en. forme de rein,
et dont la longueur entre son bord antérieur et sou échancrure
égale celle de la proéminence ; sa largeur en est le double; des
futures y marquent assez sensiblement les trois plaques interépineuses
dont il se compose. Le surscapulaire a dans le haut une lsîrge
partie rhomboïdale irrégulièrement écbancrée. La production humérale
est très-pointue, et égale la moitié de l’épine pectorale, qui
elle-même a le sixième de la longueur, totale, et est très-forte et
garnie "a son1 bord postérieur de très-fortes dents récurrentes. L’épine
dorsale est aussi forte, mais n’a point de ces dents. L’adipeuse est
très-gr^de; sa longueur est de plus du cinquième de celle du poisson,
et in arrière elle à' moitié de sa longueur en hauteur. L’anale
est deux fois moins longue, et d?un tiers plus haute. Les ventrales
sont pointues, aussi longues que les pectorales. La caudale» aussi
d’un cinquième de la longueur totale; est légèrement bilohée, à
lobes; arrondis.
fé C ii'E irf lït. I 4 4 9
M. Redoüté* enhimin^é' pi^ssoh,:..«spjfijmedesscfeals, d’up plombé
b l e u â t r e J | | | i g u r e de JVI- Riffaud -il parait' d’un
npir verdâtre àyeo dès peintes rougèâtres, au ^ventre, aux nâgeohes
et aux barbillons. Les nageoires y^opt.toutes des suites de points
noirâtres; il y; a des taches nuageusesdê la même douleur sur le dos
et les flancs. À notée individu, bien qû’il «oit fort altéré-par la
liqueur, je vois encore des points noirâtres aux ‘pectorales., 'aux
ventrales et à d’anale, et des vêstigés de’taehesfedongdû bord inférieur
, de la queue.
ll' est lôiig deWeiîze ou quatôrâë poucës.1 .
'L a vessie natatoiredev çe poisson est^très-jcurieuse: elle qst contenue
dans une membrane fibreuse, argentée, très-épaisse, qut semble
à l’extérieur ne former qu’un viscère simple à une seule, cavité,
bilobéë en avant, et arrondie en arrière. Chaque lobe est tout-à-fait
.sphérique , et est. logé dans une cayité creusée entre la grandi
vertèbre et la face interne de la ceintqçp humérale, et, ^u§,,le bouclier
et la partie postérieure du casoue. Cette membrane fibrepse
-sé replie s q u s la colonne vertébrale emortoe une cloison intérieure,
verticale et, longitudinal«, qui'.sémre, e,n. dpux: cavités la .porjion
longitudinale et ovalaire de h vessie de son grand,, cçrps, et en
même temps cette tunique «externe donqe un autre repli transversal
pour chaque lobe arrondi qui vient séparer la partie supérieure de
la cavité du lobe de celle du corps de la yessie,de la même manière
que la dure-mère, en se repliani^^fqçme la faux du cerveau et surtout
du Cervelet. La tunique propre de la yes^e^sj; très-mince,ht forme,
en suivait replis» une so^te de vessie .à quatre cavités; deux
antérieures §t arrondies, logées .dans chaque lobe, communiquent
entre elles et avecjes cavités du corps çlè,la vessie :,celles-ci sont
séparées et, enfermées chacune dans leurs membranes fibreuses;
elle® ,ne communiquent que par l’intermédiaire des cavités lobulaires.
De fortes adhérences» attachent hetté. vessie en avant à la
portion annulaire du basilaire, et en arrière à la partie postérieure
du qprps et aux apophyses de h grande: vertèbre. G’est un corn