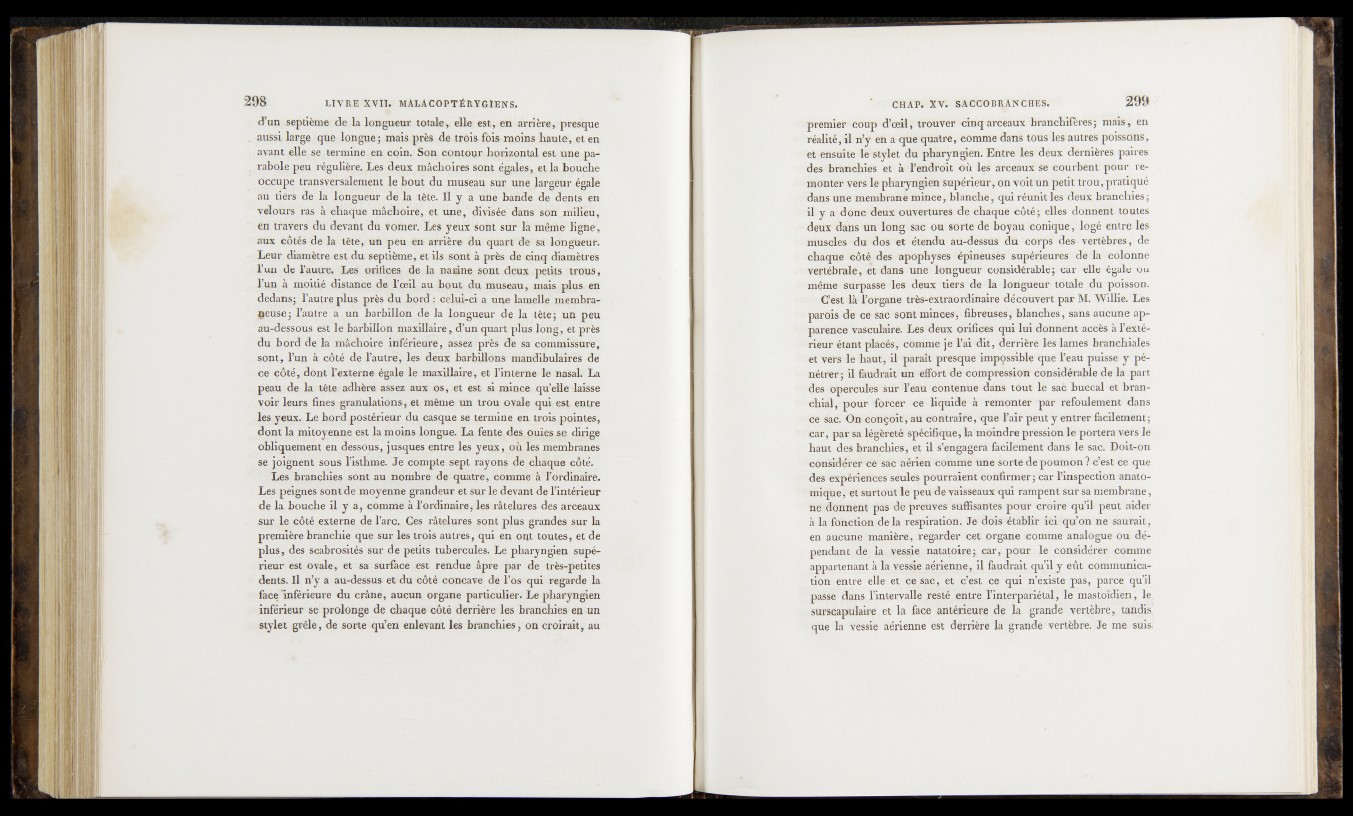
d’un septième de la longueur totale, elle est, en arrière, presque
_ aussi large que longue; mais près de trois fois moins haute, eten
avant elle se termine en, coin. Son contour horizontal est une pa-
. rabole peu régulière. Les deux mâchoires sont égales, et la bouche
Occupe transversalement le Bout du museau sur une largeur égale
au tiérs de lai longueur de la tête. Il y, a une bande' de dents en
velours ras a Chaque mâchoire, ét Upe, divisée dans son'milieu,
en travers du devant du vomer. Les yeux sont sur’ là même ligne',
aux côtés de la tête, un peu en arrière- du quart de 'sa longueur;
* Leur diamètre est du septième, étais sont.à près de cinq; diamètres
l’un de l’autre. Les orifices de la saisine sont deux petits trous,
l’un à moitié distance de l’oeil au bout- du museau, mais plus, en
dedans; l’autre plus près du bord : celui-ci a.une larmellp membraneuse;
l ’autre a un barbillon de la longueur de la tète; ,un peu
au-dessous est le barbillon maxillaire , d’un quart plus lôrig, et près
du bord de la mâchoire inférieure, assez près dé Sà cqmtùissure,
sont, l’un à côté de l’autre, les deux barbillons mandibulaires de
ce côté, dont l’externé égale le maxillaire, et l’interne le nasal. La
peau de k tête adhère assez aux es, et est si mince qu’elle laisse
voir leurs fines-granuktions, et même un trou ovale qui est entre
les yeux. Le bord postérieur du casque se termine en trois pointes,
dont la mitoyenne est la moins longue. La fente des ouïes se dirige
obliquement en dessous, jusques entre les yeux, où lés membranes
se joignent sous l’isthme. Je compte sept raÿon§ dé chaque côte.
Les branchies sont au nombre dç quatre, comme à l’ofdmaifè.
Les peignes sont de moyenne grandeur et sur le devant de l’intérieur
de la bouche il y a, comme à l’orcfinaire, les.ràtelures des arceaux
sur le çôté externe de l’arc.. Ces râtelures sont plus grandes sur k
première branehie que sur les trois autres, qui en ont toutes, et de
plus, des scabrosités sur de petits tubercules. Le pharyngien supérieur
est ovale, et sa surface est rendue âpre par de très-petites
dents. Il n’y a au-dessus et du côté concave de l’os- qui regarde 1a
face Inférieure du erâne, aucun, organe particulier. Le pharyngien
inférieur se^prolonge de chaque côté derrière les branchies en un
stylet grêle, de sorte quren enlevant les brianchies} on croirâitÿau
premier coup d’oeil, trouver cinq arceaux branchifères; mais, en
■ réalité, il n’y en a que quatre, comme dans tous les autres poissons,
et . ensuite le stÿlet du pharyngien. Entre les deux dernières paires
des branchies et à l’endroit où les arceaux se courbent pour remonter
vers le pharyngien supérieur, on voit un petit trôu, pratiqué
dans une membrane mince, blanche, qui réunit les deux branchies ;
il y a donc deux Ouvertures de chaque côté ; elles donnent toutes
deux dans un löng säG OU sWte de boyau conique, logé entre les
musoles du dos et étendu âü-dessüs du corps des vertèbres, de
chaque côté des apophyses épineuses supérieures de la colonne
vertébrale, et dans une longueur considérable; car elle égale ou
même surpasse les deux tiers de 1a longueur totale du poisson.
C’est -là i’organe très-extraordinaire découvert par M. Willie. Les
parois de ce sac sont minces, fibreuses, blanches, sans aucune Apparence
vasculaire. Les deux orifices, qui lui donnent accès à l’extérieur
étant placés, comme je l’ai dit, derrière les lames branchiales
et Vèrs ledaàut, il paraît presque impçssible que l’eaü puisse y pénétrer
; il faudrait un effort de-compression considérable de 1a part
des ^eréUléS'Sur l’eau contenue dans tout le sac buccal et branchial,
pour forcer -ce liquide à remonter par refoulement dans
ce ùac. -On conçoit, au contraire, que Pair peut y entrer facilement ;
pa-f, par sa légèreté spécifique, k moindre pression le portera vers le
haut des branchies, et il s’engagera facilement dans le sac. ©oit-on
eônridèr# ‘sAc aêrienCôôime une sorte de poumon ? c’est ce que
des éxpérieôôes seules pourraient confirmer ; car l’inspection anatomique,
et surtout le pôade vtiisseaüxqui rampent sur sa membrane,
ne ,donnent pas depreuvéssuffisantes pour croire qu’il peut aider
à la fonction delà respiration. Je dois établir ici qu’on ne saurait,
eü aucune manière, regarder cet organe comme analogue ou dépendant
de. k vessie nartatoire; car ; pour le considérer comme
appartenant à 1a vessie aérienne, il faudrait qu’il j f eût communica-
tjon entre elle et ce sac, et c’est ce qui n’existe pas, parce qu’il
pa.s.&e dans ^’intervalle resté entre ï’interpariétal, le mastoïdien, le,
surscapulaire et» la face antérieure de la grande vertèbre, tandis,
que k vessie aérienne est derrière 1a grande vertèbre. Je me suis.