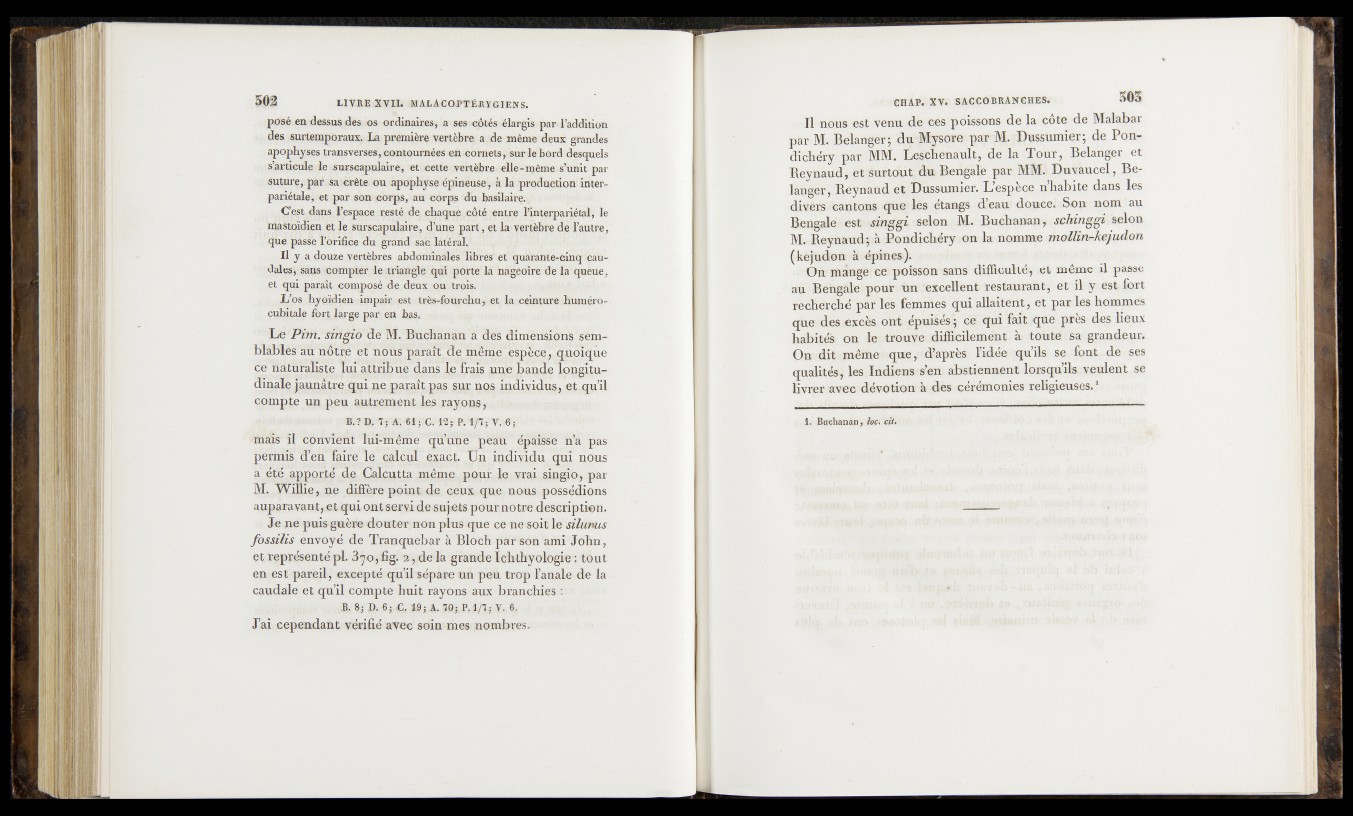
peséen dessus des os ordinaires, a ses -cfôtès. élargis par-l'addition
des surtemporaux; La première vertèbre; a.de même deux grandes
apophyses transverses, contournées en cornets,istarle bord desquels
s’articule le surscapulaire, etcette vertèbre elle-inème>s’unit par
suture,, par sa crête ou apophyse «épineuse, à la -production interpariétale.,
et par son .corps, au corps du basilaire.,
Ç’est dans l’espace resté de, chaque ,côté entre l’interpariétal, le
mastoïdien et le surscapulaire, d’une part , et la vertèbre de l’autre,
que passe l’orifice du grand sac jàtéral.
Il y a douze vertèbres abdpïümÿlêà libres et quàrânte^cinq caudales;
sans compter le .triangle qui porte la nageoire de la queue,
et qui paraît composé de deux:»QU'.trois.
Jt^GS hyoïdien impair, est Uès-fbijrchu, et la ceinture fiuméro-
cubitale fort, large par. qn bas-.
h e Pim. sirigio ûe M. Buchanan: à des dimensions semblables
au nôtre et nous paraît"'de même èspècq- quoique
çîè nalüra^^ dans ;fr%is bài^e^ûpgjdtudinale
jaunâtre qui nepaqptpas sur nos indiyidp§,7qttqu’il
compte un peu autrement les rayons,
■ B.>? B, |SÉÉ| 61 ; C. 42;- :
mais il convient lui-même quune peau épaisse n’a pas
pèrmis d’eii faire lé calcul exact. Üu-individu qui nous
a été appâte de Ç^lputta même pqp|j(|e vrai singio, par
M. Willie, ùç diffère point de ceux que nous possédions
auparavant, .et qui ont servi de (sujets pour notre description.
Je ne puis guère douter non plus que ce ne soit le siluMis
fossilis envoyé de Tranquebar à Bloch par soii arhi John,
pt représentépl. 3 poy fig; 2 ,de la grande Ichthyologief: tbut
en est pareil, excepté quil sépare un peu trop l’anale de la
caudale et qu’il compte huit rayons aux branchies^
&. U J?> f j 4Ù m i ï , W » -Y«
J’ai cependant vérifié avec soin mes nombres.
Il nous est venu dp ces poissons die la cote de Malabar
par M. Belanger; deMysore p a r M. Dussumîer; de Pondichéry
par MM. Leschenault, de la Tour, Belanger et
Reynaud, ètüsur-toût du Bengale pat MM. Buvàucel, Bélanger^
Reynaud.et Dussuini|4 .L’^ è Ge n’habite dans les
divers cantons que lés étangs d’eau; 4ôuee* nom au
Bengale est- singgi (Selon M.: Buchanany schinggi selon
M. Reyhaud^à Po ndiehéry on la nomme mollin^kejudon
l^ ê j^ d o n # ? é p *n e s ) i ^ m0 § - '■
- On mange-èe poisson sans difficulté, et même il passe
au Bengale pour un excellent restaurant^ et il y est fort
recherché par les femmes qui allaitent,, et par lés hommes
que des excès, ont épuisés ce qui fait que près des beux
habités on le trouve difficilement à- toute ; sa grandeur.
On dit même' que,; d?aptès qu’ilss seAfcùtdè ses
qualités, les lndiens s’en détiennent lorsqu’ils veulent se
livrer‘avec dévotion à dés cérémonies religieuses;1
1. Buchanan, ïoc. cit.