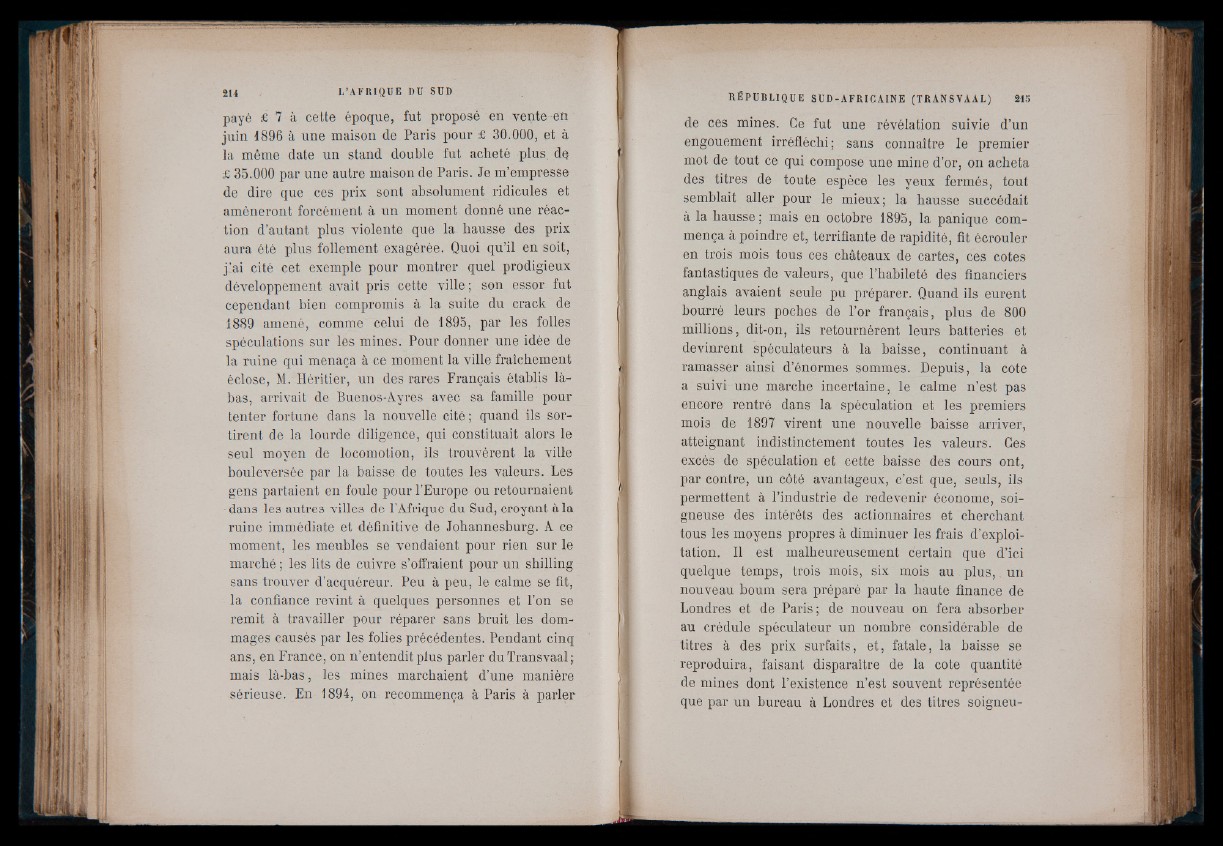
payé £ 7 à cette époque, fut proposé en vente -en
juin 1896 à une maison de Paris pour £ 30.000, et à
la même date un stand double fut acheté plus, dq
£ 35.000 par une autre maison de Paris. Je m’empresse
de dire que ces prix sont absolument ridicules et
amèneront forcément à un moment donné une réaction
d’autant plus violente que la hausse des prix
aura été plus follement exagérée. Quoi qu’il en soit,
j ’ai cité cet exemple pour montrer quel prodigieux
développement avait pris cette ville; son essor fut
cependant bien compromis à la suite du crack de
1889 amené, comme celui de 1895, par les folles
spéculations sur les mines. Pour donner une idée de
la ruine qui menaça à ce moment la ville fraîchement
éclose, M. Héritier, un des rares Français établis là-
bas, arrivait de Buenos-Ayres avec sa famille pour
tenter fortune dans la nouvelle cité; quand ils sortirent
de la lourde diligence, qui constituait alors le
seul moyen de locomotion, ils trouvèrent la ville
bouleversée par la baisse de toutes les valeurs. Les
gens partaient en foule pour l’Europe ou retournaient
•dans les autres villes de l’Afrique du Sud, croyant à la
ruine immédiate et définitive de Johannesburg. A ce
moment, les meubles se vendaient pour rien sur le
marché ; les lits de cuivre s’offraient pour un shilling
sans trouver d’acquéreur. Peu à peu, le calme se fit,
la confiance revint à quelques personnes et l’on se
remit à travailler pour réparer sans bruit les dommages
causés par les folies précédentes. Pendant cinq
ans, en France, on n ’entendit plus parler duTransvaal;
mais là-bas, les mines marchaient d’une manière
sérieuse. En 1894, on recommença à Paris à parler
de ces mines. Ce fut une révélation suivie d’un
engouement irréfléchi; sans connaître le premier
mot de tout ce qui compose une mine d’or, on acheta
des titres de toute espèce les yeux fermés, tout
semblait aller pour le mieux; la hausse succédait
à la hausse; mais en octobre 1895, la panique commença
à poindre et, terrifiante de rapidité, fit écrouler
en trois mois tous ces châteaux de cartes, ces cotes
fantastiques de valeurs, que l’habileté des financiers
anglais avaient seule pu préparer. Quand ils eurent
bourré leurs poches de l’or français, plus de 800
millions, dit-on, ils retournèrent leurs batteries et
devinrent spéculateurs à la baisse, continuant à
ramasser ainsi d’énormes sommes. Depuis, la cote
a suivi une marche incertaine, le calme n ’est pas
encore rentré dans la spéculation et les premiers
mois de 1897 virent une nouvelle baisse arriver,
atteignant indistinctement toutes les valeurs. Ces
excès de spéculation et cette baisse des cours ont,
par contre, un côté avantageux, c’est que, seuls, ils
permettent à l’industrie de redevenir économe, soigneuse
des intérêts des actionnaires et cherchant
tous les moyens propres à diminuer les frais d’exploitation.
Il est malheureusement certain que d’ici
quelque temps, trois mois, six mois au p lu s ,, un
nouveau boum sera préparé par la haute finance de
Londres et de Paris; de nouveau on fera absorber
au crédule spéculateur un nombre considérable de
titres à des prix surfaits, et, fatale, la baisse se
reproduira, faisant disparaître de la cote quantité
de mines dont l’existence n ’est souvent représentée
que par un bureau à Londres et des titres soigneu