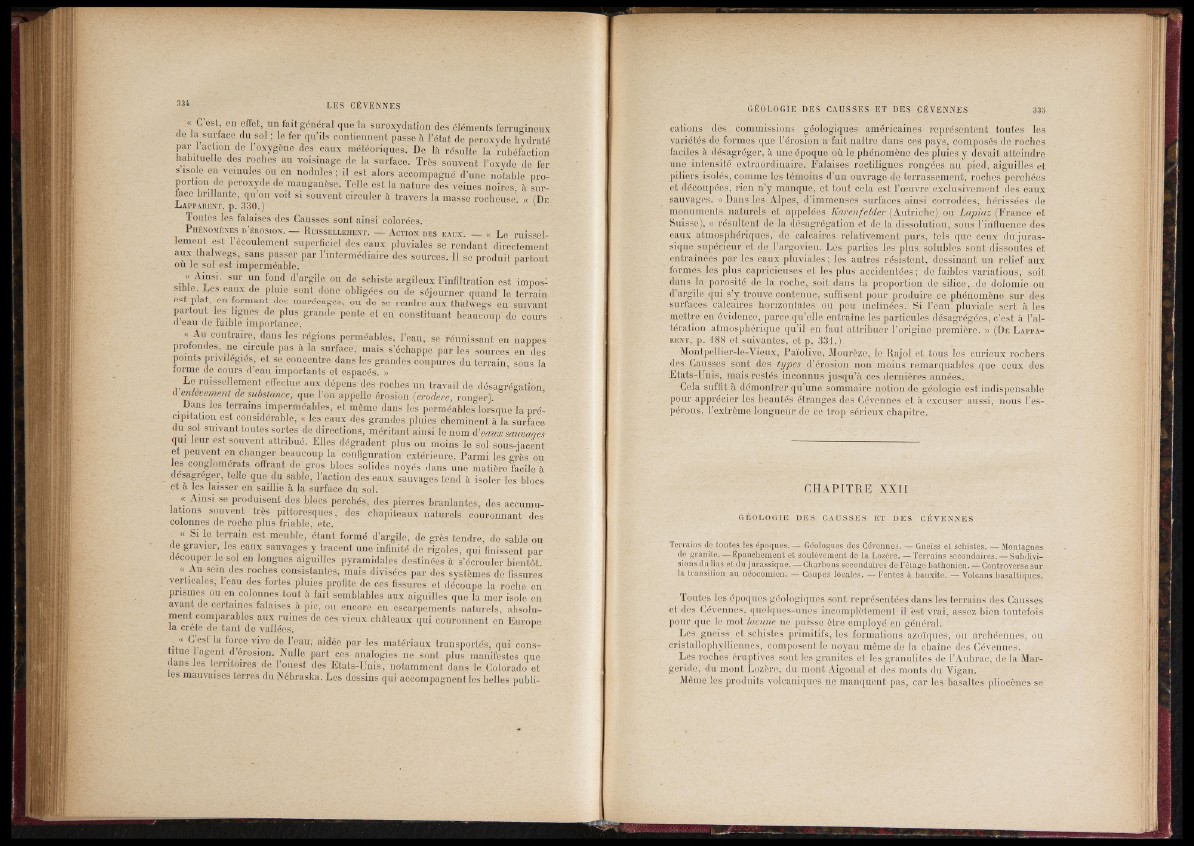
« C est en effet un fait général que la suroxydation des éléments ferrugineux
de la surface du sol ; le fer qu’ils contiennent passe à l ’état de peroxyde hydraté
par 1 action de l’oxygène des eaux météoriques. De là résulte la rubéfaction
habituelle des roches au voisinage de la surface. Très souvent l’oxyde de fer
s isole en veinules ou en nodules; il est alors accompagné d’une notable proportion
de peroxyde de manganèse. Telle est la nature des veines noires à surface
brillante, qu’on voit si souvent circuler à travers la masse rocheuse « ("De
L a p p a r e n t , p . 330.) ' '
Toutes les falaises des Causses sont ainsi colorées.
P h é n o m è n e s d ’é r o s io n . — R u is s e l l e m e n t . — A c t io n , d e s e a u x . — « Le ruissellement
est l’écoulement superficiel des eaux pluviales se rendant directement
aux thalwegs, sans passer par l’intermédiaire des sources. Il se produit partout
ou le sol est imperméable.
Ü AlTIlS1 ! sur “ n fond d’argile ou de schiste argileux l’infiltration est imposé
sible Les eaux de pluie sont donc obligées ou de séjourner quand le terrain
est plat, en formant des marécages, ou de se rendre aux thalwegs en suivant
partout les lignes de plus grande pente et en constituant beaucoup de cours
d eau de faible importance. •
« Au contraire, dans les régions perméables, l’eau, se réunissant en nappes
profondes, ne circule pas à la surface, mais s’échappe par les sources en des
points privilégiés, et se concentre dans les grandes coupures du terrain, sous la
lorme de cours d eau importants et espacés. »
Le ruissellement effectue aux dépens des roches un travail de désagrégation
d enlevement de substance, que l’on appelle érosion (érodere, ronger).
_ Dans les terrains imperméables, et même dans les perméables lorsque la précipitation
est considérable, « les eaux des grandes pluies cheminent à la surface
tlmsol suivant toutes sortes de directions, méritant ainsi le nom d'eaux sauvaaes
qui leur est souvent attribué. Elles dégradent plus ou moins le sol sous-jacent
et peuvent en changer beaucoup la configuration extérieure. Parmi lés grès ou
les conglomérats offrant de gros blocs solides noyés dans une matière facile à
désagréger, telle que du sable, l ’action des eaux sauvages tend à isoler les blocs
et à les laisser en saillie à la surface du sol.
« Ainsi se produisent des blocs perchés, des pierres branlantes, des accumulations
souvent très pittoresques, des chapiteaux naturels couronnant des
colonnes de roche plus friable,, etc.
« Si le terrain est meuble, étant formé d’argile, de grès tendre, de sable ou
de gravier les eaux sauvages y tracent une infinité de rigoles, qui finissent par
découper le sol en longues aiguilles pyramidales destinées à s’écrouler bientôt
« Au sein des roches consistantes, mais divisées par des systèmes de fissures
verticales, 1 eau des fortes pluies profite de ces fissures et découpe la roche en
prismes ou en colonnes tout à fait semblables aux aiguilles que la mer isole en
avant de certaines falaises à pic, ou encore en escarpements naturels, absolu-
ment comparables aux ruines de ces Vieux châteaux qui couronnent en Europe
la crete de ta n t de vallées.
« C’est la force vive de l’eau, aidée p a r le s matériaux transportés, qui constitue
1 agent d’érosion. Nulle part ces analogies ne sont plus manifestes que
dans les territoires de l’ouest des Etats-Unis, notamment dans le Colorado et
les mauvaises terres duNébraska. Les dessins qui accompagnent les belles publications
des commissions géologiques américaines représentent toutes les
variétés do formes q u e f ’érosion a fait naître dans ces pays, composés de roches
faciles à désagréger, à une époque où le phénomène dés pluies y devait atteindre
une intensité extraordinaire. Falaises reetilignes rongées au pied, aiguilles et
piliers isolés, comme les témoins d’un ouvrage de terrassement, roches perchées
et découpées, rien n ’y manque, et tout cela est l’oeuvre exclusivement des eaux
sauvages. » Dans les Alpes, d’immenses surfaces ainsi corrodées, hérissées de
monuments naturels et appelées Karenfelder (Àutriche);-.ou Lapiaz (France et
Suisse), « résultent de la désagrégation et de la dissolution, sous l’influence des
eaux atmosphériques,'de calcaires-relativement purs, tels que ceux du ju ra ssique
supérieur et de l’argovien. Les parties les plus Solubles sont dissoutes-et
entraînées par les eaux pluviales ; les autres résistent, dessinant un relief aux
formes les plus capricieuses et les plus accidentées; de faibles variations, soit
dans la porosité de la roche, soit dans la proportion de silice,,-de dolomie ou
d’argile qui s’y trouve contenue, suffisent pour produire ce, phénomène sur des
surfaces calcaires horizontales ou peu inclinées. Si l’eau pluviale sert à les
mettre en évidence, parce qu’elle entraîne les particules désagrégées, c’est à l ’altération
atmosphérique qu’il en faut attribuer l ’origine première. )> (D e L a p p a -
r e n t , p. 188 et suivantes, et p. 331.) .
Montpellier-le-Vieux, Païolive, Mourèze, le Rajol et tous les curieux rochers
des Causses sont dqs types d’érosion non moins remarquables que ceux des
Etats-Unis; mais restés inconnus jusqu’à ces dernières années..
Cela suffit à, démontrer qu’une sommaire notion de géologie est indispensable
pour apprécier les beautés étranges des Cévennes et à excuser aussi, nous l’espérons,
l’extrême longueur de ce trop sérieux chapitre.
C H A P IT R E X X II
GÉOLOGIE DES, CAUSSES ET D ES CÉVENNES
Terrains de toutes les époques. — Géologues des Cévennes. — Gneiss et schistes. — Montagnes
de granité. — Épanchement et soulèvement de la Lozère. — Terrains secondaires. — Subdivisions
du lias et du jurassique. —, Charbons secondaires de l ’étage b athonien. — Controverse sur
la transition a u néocomien. — Coupes locales. — Fentes à bauxite. — Volcans basaltiques.
Toutes les époques géologiques sont représentées dans les terrains des Causses
et des Cévennes, quelques-unes incomplètement il est vrai, assez-bien toutefois
pour que le mot lacune ne puisse être employé .en général.
Les |gneiss et schistes primitifs, les formations azoïques, ou archéennes, ou
cristallophylliennes, composent le noyau même de la chaîne des Cévennes.
Les roches éruptives sont les granités et les granulites de l’Aubrac, de la Mar-
geride, du mont Lozère, du mont Aigoual et des monts du Vigani
Même les produits volcaniques ne manquent pas, car les Basaltes pliocènes se