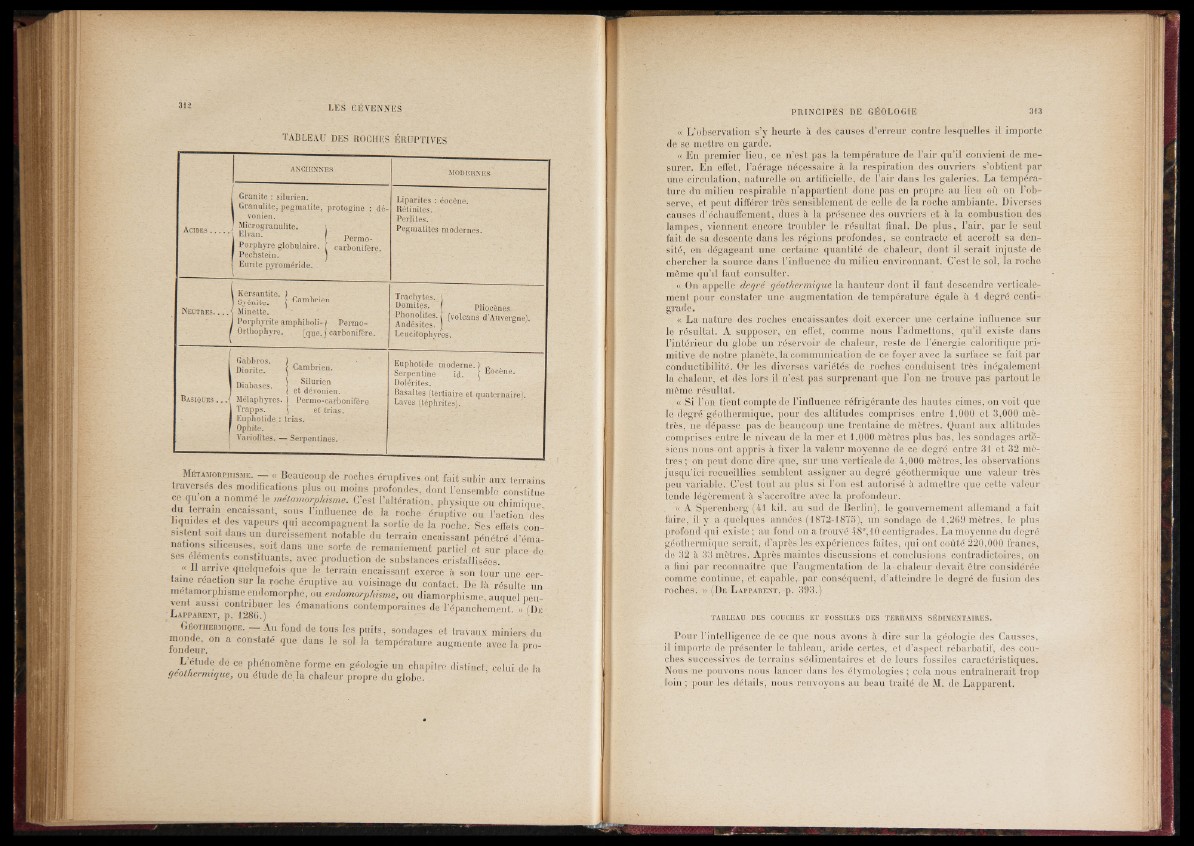
Ac id e s .........
ANCIENNES MODERNES
Granite : silurien.
Granulite, pegmatite, protogine : dé-
vonien.
Microgranulite.
Elvan- Permo-
Porphyre globulaire. i carbonifère.
Pechstein.
Eurite pyroméride.
Lipariles : éocène.
Réliniles..
Perlites.
Pegmatites modernes.
Neutres. . , .
1
Kersantite. ) ' .
Syénite. j Cambrien.
Minette.
Porphyrite amphiboli-J Permo-
Orthophyre. [que;. ) carbonifère.
Trachytes./]
Domites. r Pliocènes.
Phonolites. ( (volcans d ’Auvergne).
Andésites. 1
Leucitophyres.
Basiques . . J
Gabbros. ) •
Diorite. ] Cambrien.
Diabases. ( eft SdÎIeuyroimeae n.
Mélaphyres. j Permo-carbonifère
Trapps. \ et trias.
Euphotide : trias.
Ophite. '
Yariolîtes. — Serpentines. -
Euphotide moderne. )
Serpentine id. J Éocène.
Dolérites.
Basaltes (tertiaire e t quaternaire).
Laves (téphri tes)
Métamorphisme. — « Beaucoup de roches éruptives ont fait subir aux terrains
traversés des modifications plus ou moins profondes, dont l ’ensemble constitue
ce q u o n a nommé le métamorphisme. C’est l’altération, physique ou chimioue
- du terrain encaissant, sous 1’mfluence do la roche éruptive ou l’action des
liquides et des vapeurs qui accompagnent la sortie de la roche. Ses effets consistent
soit dans un durcissement notable du terrain encaissant pénétré d’émanations
siliceuses, soit dans une sorte de remaniement partiel et sur place de
ses éléments constituants, avec production de substances cristallisées.
1 11 a m Ye quelquefois que le terrain encaissant exerce à son tour une certaine
réaction sur la roche éruptive au voisinage du contact. De là résulte un
métamorphisme endomorphe, ou endomorphisme, ou diamorphisme auquel peuvent
aussi contribuer les émanations contemporaines de l ’épanchemont /¿D e
¿APPARENT, p . 1286.) ' t Y >
Géothermique. — Au fond de tous les puits, sondages et travaux miniers du
f o n d e ’ °n a C°nstaté (iue (lans le so1 la température augmente avec la pro-
L’étude de ce phénomène forme en géologie un chapitre distinct celui de la
géothermique, ou étude de la chaleur propre du globe.
« L’observation s’y heurte à des causes d’erreur contre lesquelles il importe
de se mettre en garde.
« En premier lieu, ce n ’est pas la température de l’air qu’il convient de mesurer.
En effet, l’aérage nécessaire à la respiration des ouvriers s’obtient par
une circulation, naturelle ou artificielle, de l’air dans les galeries. La température
du milieu respirable n ’appartient donc pas en propre au lieu où on l ’observe,
et peut différer très sensiblement de celle de la roche ambiante. Diverses
causes d’échauffement, dues à la présence des ouvriers et à la combustion des
lampes, viennent encore troubler le résultat final. De plus, l’air, p a r le seul
fait de sa descente dans les régions profondes, se contracte et accroît sa dèn-
sité, en dégageant une certaine quantité de chaleur, dont il serait injuste de
chercher la source dans l’influence du milieu environnant. C’est le sol, la roche
même qu’il faut consulter.
« On appelle degré géothermique la hauteur dont il faut descendre verticalement
pour constater une augmentation de température égale à 1 degré centigrade.
« La nature des roches encaissantes doit exercer une certaine influence sur
le résultat. A supposer,- en effet, comme nous l’admettons, qu’il existe dans
l ’intérieur du globe un réservoir de chaleur, reste de l’énergie calorifique primitive
de notre planète,la communication de ce foyer avec la surface se fait par
conductibilité. Or les diverses variétés de roches conduisent très inégalement
la chaleur, et dès lors il n ’est pas surprenant que l ’on ne trouve pas partout le
même résultat.
« Si l’on tient compté de l’influence réfrigérante des hautes cimes, on voit que
le degré géothermique, pour des altitudes comprises entre 1,000 et 3,000 métrés,
ne dépasse pas de beaucoup une trentaine de mètres. Quant aux altitudes
comprises enlre le niveau de la mer et 1,000 mètres plus bas, les sondages artésiens
nous ont appris à fixer la valeur moyenne de ce-degré entre 31 et 32 mètre
s; on peut donc dire que, sur une verticale de 4,000 mètres, les observations
jusqu’ici recueillies semblent assigner au degré géothermique une valeur très
peu variable. C’est tout au plus si; Bon est autorisé à admettre que cette valeur
tende légèrement à s’accroître avec la profondeur.
. « A Sperenberg (41 Uil. au sud de Berlin),. le gouvernement allemand a fait
faire, il y a quelques années (1872-1878), un sondage de 1,269 mètres, le plus
profond qui existe; au fond o n a tro u v é 48°,10 centigrades. La moyenne du degré
géothermique serait, d’après les expériences faites, qui ont coûté 220,000 francs,
de 32 à 33 mètres. Après maintes discussions et conclusions contradictoires, on
a fini par reconnaître que l’augmentation de la - chaleur devait être considérée
comme continue, et capable, par conséquent, d’atteindre le degré de fusion des
roches. » (.De L apparent, p. 393.)
TABLEAU DES COUCHES ET FOSSILES DES TERRAINS SÉDIMENTAIRES.
Pour l ’intelligence de ce que nous avons à dire sur la géologie des Causses,
il importe de présenter le tableau, aride certes, et d’aspect rébarbatif, des couches
successives de terrains sédimentaires- et de leurs fossiles caractéristiques.
Nous ne pouvons nous lancer dans les étymologies ; cela nous entraînerait trop
loin ; pour les détails, nous renvoyons au beau traité de M. de Lapparent.