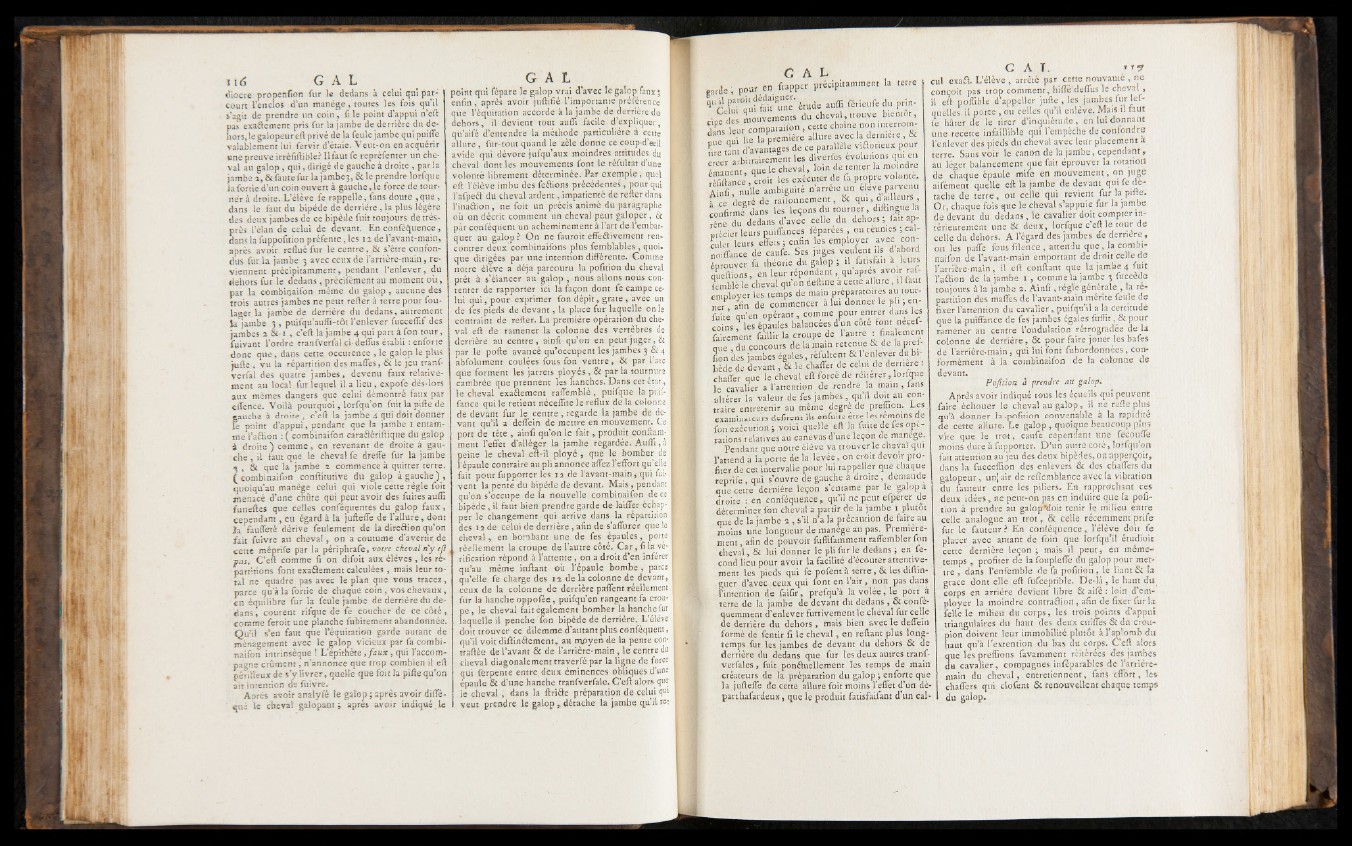
ii 6 G A L
diocre propenfion fur le dedans à celui qui parcourt
l’enclos d’un manège , toutes les fois qu’il
s’agit de prendre un coin, fi le point d’appui n’eft
pas exactement pris fur la jambe de derrière du dehors,
le galopeur eft privé de la feule jambe qui puiffe
valablement lui fervir d’étaie. Veut*on en acquérir
une preuve irréfiftible? Il faut fe repréfenter un cheval
au galop, qui, dirigé de gauche à droite , par la
jambe a, & faute fur la jambe3, & le prendre lorfque
lafortie d’un coin ouvert à gauche ,1e force de tourner
à droite. L’élève fe rappelle, fans doute ,que ,
dans le faut du bipède de derrière , la plus légère
des deux jambes de ce bipède fuit toujours de très-
près l’élan de celui de devant. En conféquence,
dans la fuppofition préfente, les 12. de l’avant-main,
après avoir reflué fur le centre, ,6c s’être confondus
fur la jambe 3 avec ceux de l’arrière-main, reviennent
précipitamment, pendant l’enlever , du
dehors fur le dedans , précifément au moment où,
par la combinaifon même du galop, aucune des
trois autres jambes ne peut refter à terre pour fou-
lager la jambe de derrière du dedans, autrement
la jambe 3 , puifqu’auffi-tôt l’enlever fucceflif des
jambes 2 & - i, c’eft la jambe 4 qui part à fon tour,
fuivant l’ordre tranfverfal ci- deflùs établi -.enforte
donc que, dans cette occurence , le galop le plus
jufte , vu la répartition des maffes, & le jeu tranfverfal
des quatre jambes, devenu faux relativement
au local fur lequel il a lieu , expofe dès-lors
aux mêmes dangers que celui démontré faux par
effence. Voilà pourquoi, lorfqu’on fuit la pifte de
gauche à droite , c’eft la jambe 4 qui doit donner
te point d’appui, pendant que la jambe 1 entam-
me l’aâion : ( combinaifon caradériftique du galop
à droite ) comme, en revenant de droite à gauche
, il faut que le cheval fe dreffe fur la jambe
9 , & que la jambe 2 commence à quitter terre,
Q combinaifon conftitutive du galop à gauche ) ,
quoîquau manège celui qui viole cette règle foit
menacé d’une chute qui peut avoir des fuites aufli
funeftes que celles conféquentes du galop faux,
cependant, eu égard à la juftefle de l’allure, dont
Ja fauffeté dérive feulement de la diredion qu’on
fait fu'rvre au cheval, on a coutume d’avertir de
cette méprife par la périphrafe, v o tr e c h e v a l n'y eft
vas. C’eft comme fi on difoit aux élèves , les répartitions
font exaâement calculées , mais leur total
ne quadre pas avec le plan que vous tracez,
parce qu’à lafortie de chaque coin , vos chevaux,
en équilibre fur la feule jambe de derrière du dedans
, courent nique de fe coucher de ce côté,
comme feroit une planche fubitement abandonnée.
Qunl s’en faut que l’équitation garde autant de
ménagement avec le galop vicieux par fa combinaifon
intrinsèque î L’épithète, f a u x , qui l’accompagne
crûment, n’annonce que trop combien il eft
périlleux de s’y livrer, quelle que foit la pifte qu’on
ait intention de fuivre.
Après avoir analyfé te galop ; après avoir difïe-
què le cheval galopant; apres avoir indiqué.le
G A L
point qui fèpare le galop vrai d’avec le galop faux ; I
enfin, après avoir juftifié l’importante préférence
que l’équitation accorde à la jambe de derrière du I
dehors, il devient tout aufli facile d’expliquer, I
qu’aifé d’entendre la méthode particulière à cette I
allure , fur-tout quand le zèle donne ce coup-d’eeil I
avide qui dévore jufqu’aux moindres attitudes du I
cheval dont les mouvements font le réfultat d’une I
volonté librement déterminée. Par exemple , quel I
eft l’élève imbu des ferions précédentes , pour qui I
l’afpeél du cheval ardent, impatienté de refter dans I
l’inaélion , ne foit un précis animé du paragraphe I
où on décrit comment un cheval peut galoper, &
par conféqiient un acheminement à l’art de l’embar* I
quer au galop ? On ne fauroit effectivement ren-
contrer deux combinaifons plus femblables , quoi. I
que dirigées par une intention différente. Comme I
notre éleve a déjà parcouru la pofition du cheval I
prêt à s’élancer au galop , nous allons nous con-
tenter de rapporter ici la façon dont fe campe ce* I
lui qui, pour exprimer fon dépit, grate , avec un I
de fes pieds de devant, la place fur laquelle on le
contraint de refter. La première opération du cheval
eft de ramener la colonne des vertèbres de
derrière au centre, ainfi qu’on en peut juger, &
par le pofte avancé qu’occupent les jambes 3 & 4 I
abfolument coulées fous fon ventre, & par l’arc
que forment les jarrets ployés, & par la tournure
cambrée que prennent les hanches. Dans cet état,
le cheval exactement raffemblé, puifque la puif-
fance qui le retient néceffite le reflux de la colonne
de devant fur le centre , regarde la jambe de devant
qu’il a deffein de mettre en mouvement. Ce I
port de tête , ainfi qu’on le fait , produit confiant- I
ment l’effet d’alléger la jambe regardée. Aufli, à I
peine le cheval eft-il ployé , que le bomber de I
l’épaule contraire an pli annonce affez l’effort qu’elle
fait pour fupporter les 1 2 de l’avant-main *qui fui*
vent la pente du bipède de devant. Mais, pendant
qu’ôn s’occupe de la nouvelle combinaifon de ce
bipède, il faut bien prendre garde de laiffer échap- I
per le changement qui arrive dans la répartition I
des 12 de celui de derrière , afin de s’affûter que le I
chevalen bombant une de fes épaules, porte
réellement la croupe de l’autre côté. Car, fi la vérification
répond à l’attente , on a droit d’en inférer
qu’au même inftant où l’épaule bombe, parce
qu’elle fe charge des 1 2 de la colonne de devant,
ceux de la colonne de derrière paflfent réellement
fur la hanche oppofée , puifqu’en rangeant fa crou- |
pe, le cheval fait également bomber la hanche fur
laquelle il penche 'ion bipède de derrière. L’élève
doit trouver ce dilemme d’autant plus conféquent,
qu’il voit diftinétement, au moyen de la pente eon*
traftée de l’avant & de l’arrière-main , le centre du
cheval diagonalement traverfé par la ligne de force
qui ferpente entre deux éminences obliques d’une
épaule & d’une hanche tranfverfale. C’eft alors que
le cheval , dans la ftriâe préparation de celui qui
veut prendre le galopdétache la jambe qu’il
C A L
garde, pour en frapper précipitamment la terre
mgÊBnm eine des mouvements du chaeUvfal?l , ftér"oueUvefe ?b"ie nPtôlt,
daPns leur comparait , cette chaîne non mterrom-
• ia nremière allure avec la dermere, &
P“ tant d'avamages de ce parallèle viflorieux pour
creel arbitrairement les diverfes évolutions qm en
émanent, que le cheval, loin de tenter la moindre
rSftance .«oit les exécuter de fa propre volonté.
Ainfi, nulle ambiguité narrête un éleve parvenu
à ce degré de raifonnement, & qui, d ailleurs ,
confirmé dans les leçons du tourner , d.ftinguela
rêne du dedans d’avec celle du dehors, fait apprécier
leurs puiffances féparées , ou reunies ; calculer
leurs effets; enfin les employer avec con-
noiffance de caufe. Ses juges veulent ils d abord
éprouver fa théorie du galop ; il fimsfait a leurs
méfiions, en leur répondant , qu apres avoir rai-
fèmblé le cheval qu’on deftine a cette allure, il faut
employer les temps de main préparatoires au tourner
afin de commencer à lui donner le pli ; en-
fuite qu’en opérant, comme pour entrer dans les
coins , les épaules balancées d’un cote font necef-
fairement faillir la croupe de l’autre | finalement
ai,e , du concours de la main retenue & de la prêt-
fion des jambes égales, réfultent & 1 enlever du bi-
bède de devant, & le chaffer de celui de derrières I
chaffer que le cheval efl forcé de réitérer,dorique
le cavalier a l’attention de -rendre la main , fans
altérer la valeur de fes jambes , qu’il doit au contraire
entretenir au même degré de preffion. Les
examinateurs defirent-ils enfuiteêtre les témoins de
fon exécution ; voici quelle eft la fuite dé fes operations
relatives au canevas d’une leçon de manege.
Pendant que notre élève va trouver le cheval qui
l’atiend à la porte de la levée, on croit devoir pro-
fiter de cet intervalle pour lui rappeller que chaque
reprife , qui s’ouvre de gauche à droite, demande
que cette dernière leçon s’entame par te galop a
droite-: en conféquence, qu’il ne peut efpérer de
déterminer fon cheval à partir de la jambe 1 plutôt
que de la jambe 2 , s’il n’a la précaution de faire au
moins une longueur de manège au pas. Premièrement
, afin de pouvoir fuffifamment raffembler fon
cheval, & lui donner le pli fur le dedans; en fécond
lieu pour avoir la facilité d’écouter attentivement
les pieds qui fe pofent à terre, & tes diftin-
guer d’avec ceux qui font en l’air, no'n pas dans
l’intention de faifir, prefqu’à la volée, le port à
terre de la jambe de devant du dedans , & confe-
quemment d’enlever furtivement le cheval fur celle
de derrière du dehors , mais bien avec le deffein
formé de fentir fi le cheval, en reftant plus longtemps
fur les jambes de devant du dehors & de
derrière du dedans que fur les deux antres tranf-
verfales, fuit ponctuellement les temps de main
créateurs de la préparation du galop ; enlorte que
la juftefle de cette allure foit moins l’effet d’un dé-
C A T.
cul exaft. L’élève , arrêté par cette nouvauté , ne
conçoit pas trop comment, biffe deffùs le cheval,
il eft poffible d’app.eller jufte , tes jambes fur lef-
quelles il porte , ou celles qu’il enlève. Mais il faut
fe hâter de le tirer d’inquiétude, en lui donnant
une recette infaillible qui l’empêche de confondre
l’enlever des pieds du cheval avec leur placement a
terre. Sans voir le cano-n de la jambe, cependant,
au léger balancement que fait éprouver la rotation
de chaque épaule mife en mouvement, on jugé
aifément quelle eft la jambe de devant qui fe détache
de terre, où celle qui revient fur la pifte.
Or, chaque fois que le cheval s’appuie fur la jambe
de devant du, dedans , le cavalier doit compter intérieurement
une & deux, lorfque c’eft le tour de
celle du dehors. A l’égard des jambes de derrière,
on les paffe fous filence , attendu que, la combinaifon
de l’avant-main emportant de droit'celle de
l’amère-main, il eft confiant que la jambe 4 fuit
l’a&ion de la jambe 1 , comme la jambe 3 fuccède
toujours à la jambe 2 . Ainfi , règle générale , la répartition
des maffes de l’avant-main mérite feule de
fixer l’attention du cavalier, puifqu il a la Certitude
que la puiffance de fes jambes égales fuffit , & pour
ramener au centre l’ondulation rétrogradée de la
colonne de derrière, & pour faire jouer les bafes
de l'arrière-main, qui lui font fubordonnées, conformément
à la combinaifon de la colonne de
devant.
P o f i t io n à prendre a u g alop *
Après avoir indiqué tous les écueils qui peuvent
faire échouer le cheval au galop, il ne refte plus
qu’à donner la .pofition convenable a la rapidité
de cette allure. Le galop , quoique beaucoup plus
vite que le trot, caufis cependant une fecouffe
moins dure à fupporter. D’un autre coté, Iorfqu’on
fait attention au jeu des deux bipèdes, on apperçoif,
dans la fucceflion des enlevers & des chaffefs du
galopeur, unjair de refiemblance avec la vibration
du fauteur entre les piliers. En rapprochant ces
deux idées, ne peut-on pas en induire que la pôfi-
tion à prendre au galop*doit tenir le milieu entre
celle analogue au trot,- & celle récemment prife
fur le fauteur ? En conléquence, l’élève doit fe
placer avec autant de foin que îorfqu’il êtudioir
cette dernière leçon ; mais il peut, en même-
temps , profiter de la foupleffe du galop pour mettre
, dans Tenfemble de fia pofition, le liant & la
grâce dont elle eft fufceptible. De-Ià , le haut du
corps en arriére devient libre & aifé : loin' d’employer
la moindre contra&ion, afin de fixer fur la
felle le milieu du corps, les trois points d’appuï
triangulaires du haut des deux cuiffes & du Croupion
doivent leur immobilité plutôt à l’aplomb du
haut qu’à fextention du bas du corps. C’eft alors
que les prefîfons (avamment réitérées des jambes
du cavalier, compagnes infeparables de l’arrière-
main du cheval, entretiennent, fans effort, les