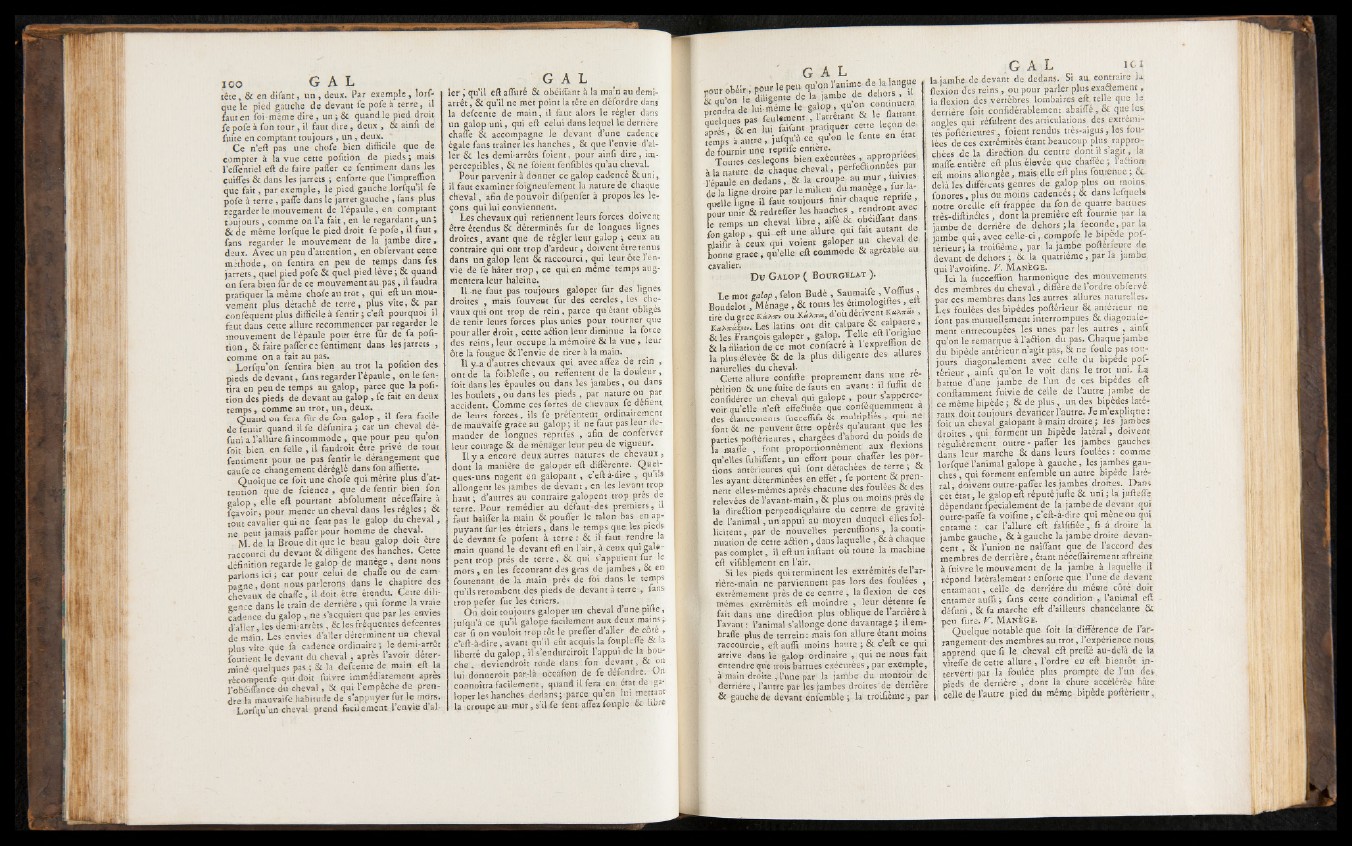
tête, & en difant, u n , deux. Par exemple, lorsque
le pied gauche de devant fe pofeà terre, il
faut en foi-même dire, un ; & quand le pied droit
fe pofe à fon tour, il faut dire, deux , & ainfi de
fuite en comptant toujours , u n , deux.
Ce n’eft pas une chofe bien difficile que de
compter à la vue cette pofition de pieds ; mais
l ’effentiel eft de faire pafler ce fentiment dans les
cuifles & dans les jarrets ; enforte que l’impreflion
que fa it, par exemple, le pied gauchelorfqu’il fe
pofe à terre , pafle dans le jarret gauche , fans plus
regarder le mouvement de l’épaule, en comptant
toujours , comme on l’a fait, en le regardant, un 5
& de même lorfque le pied droit fe pofe, il faut,
fans regarder le mouvement de la jambe dire,
deux. Avec un peu d’attention, en oblervant cette
méthode, on fentira en peu de temps dans fes
jarrets, quel pied pofe & quel pied leve ; & quand
on fera bien lûr de ce mouvement au pas, il faudra
pratiquer Ta même chofe au tro t, qui eft un mouvement
plus détaché de terre, plus v î t e ,& par
confisquent-plus difficile à fentir ; c’eft pourquoi il
faut dans cette allure recommencer par regarder le
mouvement de l'épaule pour être fur de fa pofition
, & faire pafler ce fentiment dans les jarrets ,
comme on a fait au pas.
Lorfqu’on fentira bien au trot la pofition des
pieds de devant, fans regarder l’épaule, on le fentira
en peu de temps au galop, parce que la pofition
des pieds de devant au galop, fe fait en deux
temps, comme au trot, un, deux.
Quand on fera fur de fon galop , il fera facile
de fentir quand il fe défunira ; car un cheval dé-
funi a l’allure fi incommode , que pour peu qu on
foit bien en felle , il faudroit être privé de tout
fentiment pour ne pas fentir le dérangement que
câufe ce changement déréglé dans fon affiette.
Quoique ce foit une chofe qui mérite plus d'attention
que de fcience , que de fentir bien fon
galop , elle eft pourtant abfolument néceflàire à
fçavoir, pour mener un cheval dans les règles ; &
tout cavalier qui ne fent pas le galop du cheval,
ne peut jamais pafler pour homme de cheval.
M. de la Broue dit que le beau galop doit être
raccourci du devant & diligent des hanches. Cette
définition regarde le galop de manège , dont nous
parlons ic i; car pour celui de chafle ou de cam
pa«ne, dont nous parlerons dans le chapitre des
chevaux de chafle, il doit être étendu. Cette dili-
jrence dans lé train de derrière , qui forme la vraie
cadence du galop „ne s’acquiert que par les envies
d’aller, les demi-arrêts , & les fréquentes defcentes
de main. Les envies d aller déterminent un cheval
pins vite que fa cadence ordinaire ; le demi-arrêt
foutient le devant du cheval , après l’avoir déterminé
quelques pas ; & la defcente de main eft la
récompenfe qui doit fuivre immédiatement apres
l’obéiflance du cheval, & qui t’empêche de prendre
la mauvaife habitude de s’appuyer fur le mors.
Lorfqu’un cheval prend facilement 1 envie d al-
1er ] qu’il eft afluré & obéiflant à la mafn au demi-
arrêt , & qu’il ne met point la tête en défordre dans
la defcente de main, il faut alors le régler dans
un galop uni, qui eft celui dans lequel le derrière
chafle & accompagne le devant d’une cadence
égale fans traîner les hanches, & que l’envie d’aller
& les demi-arrêts foient, pour ainfi dire , imperceptibles
, & ne foient fenfibles qu’au cheval.
Pour parvenir à donner ce galop cadencé & uni,
; il faut examiner foigneufement la nature de chaque
| cheval, afin de pouvoir difpenfer à propos tes le-
? çons qui lui conviennent.
Les chevaux qui retiennent leurs forces doivent
être étendus & déterminés fur de longues lignes
droites, avant que de régler leur galop ; ceux au
contraire qui ont trop d’ardeur, doivent être tenus
dans un galop lent & raccourci, qui leur ôte 1 envie
de fe hâter trop, ce qui en même temps augmentera
leur haleine.
Il-ne faut pas toujours galoper fur des lignes
droites , mais fouvent fur des cercles, les chevaux
qui ont trop de rein , parce qu étant obliges
de tenir leurs forces plus unies pour tourner que
pour aller droit, cette aélion leur diminue la force
des reins, leur occupe la mémoire & la vue , leur
ôte la fougue & l’envie de tirer à la main.
Il y-a d autres chevaux qui avec aflez de rein ,
ont de la foibleffe , ou reflentent de la douleur ,,
foit dans les épaules ou dans les jambes , ou dans
les boulets , ou dans les pieds , par nature ou par
accident. Comme ces fortes de chevaux fe défient
de leurs forces, ils fe préfentent ordinairement
de mauvaifè grâce au galop ; il ne faut pas leur demander
de longues reprifës , afin de conferver
leur courage & de ménager leur peu de vigueur.
Il y a encore deux autres natures de chevaux »
dont la manière de galoper eft différente. Quelques
uns nagent en galopant , c’eft à-dire , qu’ils
allongent les jambes de devant, en les levant trop
haut ; d’autres au contraire galopent trop près de
terre. Pour remédier au défaut >des premiers, il
faut baifler la main & pouffer le talon bas en appuyant
fur les étriers, dans le temps que les pieds
de devant fe pofent à terre : & il faut rendre la
main quand le devant eft en l’air, à ceux qui galopent
trop près de terre, & qui s’appuient fur le
mors , en les fecourant des gras de jambes , & en
foutenant de la main près de foi dans le temps
qu’ils retombent .des pieds de devant à terre , fans
trop pefer fur les étriers. f
On doit toujours galoper un cheval d une pifle,
jufqn’à ce qu’il galope facilement aux deux mains;
car fi on vouloit trop tôt le prefler d’aller de côté ,
c’eft-à-dire, avant qu’ il eût acquis la fotiplefle & la
liberté du galop, il s’endurciroit l’appui de la bouche
, deviendroit roide dans fon devant, & on
lui donnerôit par-là- occafion de fe défendre. On
con-noîtra facilement, quand il fera en état de )galoper
les hanches dedans; parce qu’en lui mettant
la croupie au mur, s’ilife fent aflez fo.uple & libre
la jambe.de devant de dedans. Si au, contraire la
flexion des reins , ou pour parler plus exactement,
la flexion des vertèbres lombaires eft. telle que le
derrière foit confidérablement abaiflé, & que les
angles qui réfultent des articulations des extrémitéspoftérieures,
saSfgBjfeâ.fe* r t e i apr<s, & Pen lui faifant pratiquer cette leçon. de- :
temps à autre, jufqu'à ce quon le fente en état .
Ap fournir une reprife entière. . ,
Tomes ces leçons bien exécutées apptoprtees.
à la nature de chaque cheval, perfeâtonDées par
l ’épaule en dedans, & la croupe au mur, fmvtes
de la ligne droite par le milieu du manege, fur la
quelle ligne il faut toujours finir chaque reprife ,
pour unir & redreffer les hanches , rendront avec
fe temps un cheval libre, atfe & obe,fiant dans
fon galop , qui-eft une allure qm fait autant de
plaifir à ceux qui voient galoper un cbeygl d •
bonne grâce, qu’elle’ eft commode & agréable au
cavalier.
D » G alop ( Bourgelat >.
Le mot galop,félon Budê , Saumaife .V o ffiu s ,
Boudelot, Ménage , & touts les etitnologtftes , elt
tiré du grec K«Aîtv ou d ou dérivent K«A7r<*v,
k*a m !<... Les latins ont dit calpare & !
& les François galoper , galop. .Telle eft 1 ortgt
& la filiation de ce mot confacre a 1 expreffion de
la plus-élevée & de la plus diligente des allures
naturelles du cheval.
Cette allure confifte proprement dans répétition
& une fuite de fauts en avant: îHumt de
confidérer un cheval qui galope , pour s apperce-
voir quelle n’eft effeâuèe que confequemment a
des élancements fucceflifs & multipliés , qui ne
font & ne peuvent être opérés qu’autant que les
parties poftérieures , chargées d’abord du poids de
la mafle , font proportionnément aux flexions
qu’elles fubiffent, un effort pour chafler les portions
antérieures qui font détachées de terre ; &
les ayant déterminées en effet, fe portent & prennent
elles-mêmes après chacune des foulees & des
relevées de l’avant-main, & plus ou moins près de
la direélion perpendiculaire du centre de gravité
de l’animal, un appui au moyen duquel elles fol-
licitent, par de nouvelles percuflions , la continuation
de cette a&ion , dans laquelle, & a chacjue
pas complet, il eft un inftant ou toute la machine
eft vifiblement en l’air. (
Si les pieds qui terminent les extrémités de 1 arrière
main ne parviennent pas lors des foulees ,
extrêmement près de ce centre, la flexion de ces
mêmes extrémités eft moindre , leur detente fe
fait dans une direâion plus oblique de 1 arrière à
l’avant : l’animal s’allonge donc davantage ; il em-
braffe plus de terrein: mais fon allure étant moins
raccourcie, eft auffi moins haute ; & c’eft ce qui
arrive dans le galop ordinaire , qui ne nous f^it
entendre que trois battues exécutées, par exemple,
à main droite , l’une par la jambe du montoir de
derrière, l’autfe par les jambes droites de derrière
& gauche de devant énfemble; la troifième, par
foient rendus très-aigus , les foulées
de ces extrémités étant beaucoup plus rapprochées
de la diredion du centre dont il s’agit , la
mafle. entière eft plus elevee que chafîee ; 1 aCtion-
eft moins allongée, mais elle eft plus fqmenue ; 8c
delà les différents genres de galop plus ou moins
fonores, plus ou moins cadencés ; oc dans Iefquels
; notre oreflle eft frappée du fon de quatre battues
très-diftinCies , dont la première eft fournie par la
, jambe de derrière de dehors;la fécondé, par la
; jambe qui, avec celle-ci, compofe le bipède pof-
! térieur; la troifième., par la jambe pofténeure de
: devant de dehors ; ôc la quatrième, par là jambe
qui l’avoifine. V. Manège.
, Ici la fucceffion harmonique des mouvements
des membres du cheval, différé de 1 ordre obferve
par ces membres dans les autres allures naturelles»
Les foulées des bipedes pofterieur & anterieur ne
foint pas mutuellement interrompues & diagonale-
ment entrecoupées les unes par les autres , ainfi
qu’on le remarque à l’aCtion du pas. Chaque jambe
du bipède antérieur n’agit pas, & ne foule pas toi£
jours diagonale ment avec celle du bipède pof-
térieur, ainfi qu’on le voit dans le trot uni. La
battue d’une jambe de l’un de ces bipedes eft
conftamment fuivie de celle de l’autre jambe de
' ce même bipède ; & de plus, un des bipèdes laté-
: raux doit toujours devancer l’autre. Je m’explique :
foit un cheval galopant à main droite ; les jambes
' droites , qui forment un bipède latéral, doivent
régulièrement outre - pafler les jambes gauches
dans leur marche & dans leurs foulées : comme
lorfque l’animal galope à gauche, les jambes gauches
, qui forment enfemble un autre bipède latéral,
doivent outre-paffer les jambes droites. Dans
cet état, le galop eft réputé jufte & uni ; la juftefle
dépendant fpécialement de la jambe de devant qui
outre-pafle fa voifine , c*eft-à-dire qui mène ou qui
entame : car l’allure eft falfifiée, fi à droite la
jambe gauche, & à gauche la jambe droite devancent
, & l’union ne naiffant que de l’accord des
membres de derrière, étant nécefiairement aftreint
à fuivre le mouvement de la jambe à laquelle il
ï répond latéralement : enforte que l’une de^ devant
entamant , celle de derrière du même côté doit
• entamer auffi ; fans cette condition , l’animal eft
défiini, & fa marche eft d’ailleurs chancelante &
peu fure. V. Manège.
Quelque notable que foit la différence de Tar-
rangement'des membres au trot, l’expérience nous
apprend que fi le cheval eft prefîe au-delà de la
vîtefle de cette allure , l’ordre en eft bientôt interverti
par la foulée plus prompte de l’un des
pieds de derrière , dont la chute accélérée hâte
i celle de l’autre pied du même bipède poftérienr,