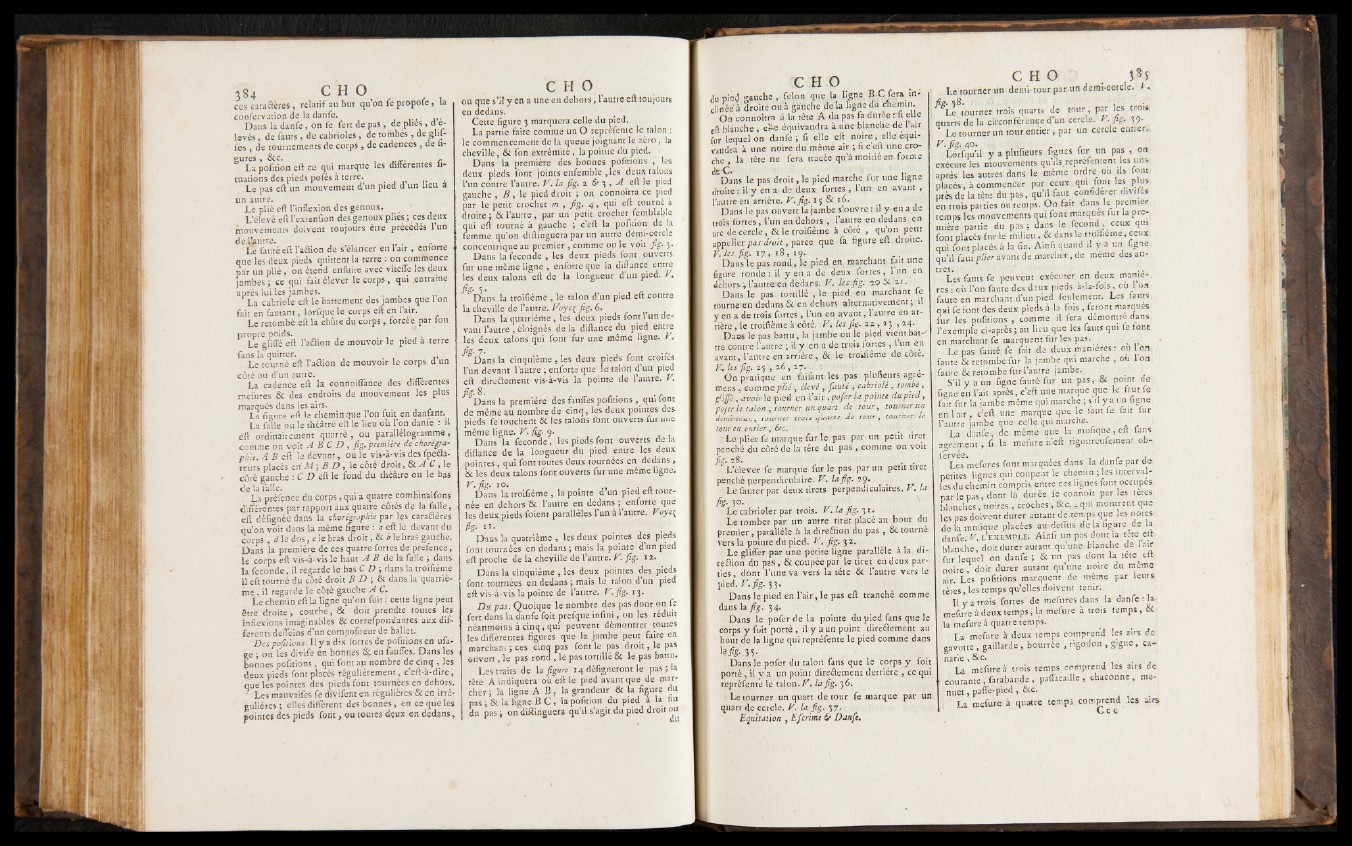
384 C H O
ces caraftères, relatif au but qu on le propofe, la
confervation de la danfe.
Dans la danfe, on fe fert de pas , de pues, d e-
le vés , de fauts, de cabrioles, de tombés, de ghf-
f é s , de tournements de corps, de cadences , de figures
, &c. _
La pofition eft ce qui marque les différentes lttuations
des pieds pôles à terre. . . . . ,
Le pas eft un mouvement d’un pied d un jteu a
un autre.
Le plié eft l’inflexion des genoux, < '
L’élevé eft l’extenfion des genoux pliés ; ces deux
mouvements doivent toujours être précédés l’un
deliiutre. .
Le fauté eft l’aélion de s elancer en 1 a ir , entorte
que les deux pieds quittent la terre : on commence
par un plié , on étend enfuite avec vîteffe lès deux
jambes ; ce qui fait élever le corps, qui .entraîne
après lui les jambes. k . -
La cabriole eft le battement des jambes que 1 on
fait en fautant, lorfque le corps eft en l’air.
Le retombé eft la chute du corps , forcée par fon
propre, poids. . . . .
Le gliffé eft l’aâion de mouvoir le pied a terre
fans la quitter.
Le tourné eft l’aâion de mouvoir le corps d un
côté ou d’un autre.
La cadence eft la connoifîance des differentes
mefures & des endroits de mouvement les plus
marqués dans les airs.
La fleure eft le chemin que l’on fuit en danfant.
La falle ou le théâtre eft le lieu ou l’on danfe : il
eft ordinairement quarré , ou parallélogramme ,
comme on voit A B C D , fig. première de chorégraphie.
A B eft le devant, ou le vis-à-vis des fpeéla-
teur's placés en’ JW; B D , le côtédroit, t k A C ,\ e
côté gauche i f f l e f t le fond du théâtre ou le bas
de la falle. . .
La préfçnce du corps, qui a quatre combinations
différentes par rapport aux quatre côtés de la falle,
eft défignée dans la chorégraphie par les caraélères
qu’on voit dans la même figure : a eft le devant du
corps , d le dos, e le bras droit, & h le bras gauche.
Dans la première de ces quatre fortes de préfence,
le corps eft vis-à-vis le haut A B de la falle ; dans
la fécondé, il regarde le bas C D ; dans la troifième
il eft tourné du côté droit B D ; & dans la quatrième
, il regarde lé côté gauche A Ç.
Le chemin eft la ligne qu’on- fuit : cette ligne peut
être droite, courbe, & doit prendte toutes les
inflexions imaginables & correspondantes aux differents
deffeins d’un compoftteur de ballet.
Des pofitions. Il y a dix fortes de pofirions en ufa-
ge ; on les divife en bonnes & en Fauffes, Dans les
tonnes pofitions, qui font au nombre de cinq , les
deux pieds font placés régulièrement, c’eft-à-dire,
que les pointes des pieds font tournées en dehors.
• Les mauvaises fe divifent en régulières & en irrégulières
; elles diffèrent des bonnes, en ce que les
pointes des pieds font, ou toutes deux en dedans,
C H O
ou que s’il y en a une en dehors, l’autre eft toujours
en dedans. ' . ‘
Cette figure 3 marquera celle du pied.
La partie faite comme un O repréfente le talon :
le commencement de la queue joignant le zéro, la
cheville, & fon extrémité, la pointe du pied.
Dans la première des bonnes pofitions , les
deux pieds font joints enfemble , les deux talons
l’un contre l’autre. V . la f ig . 2 & 3 , a4 eft le pied
j gauche , B , le pied droit ; on connoitra ce pi^ci
par le petit crochet m , f ig . 4, qui eft tourné à
droite ; & l’autre, par un petit crochet femblable
qui eft tourné à gauche ; c’eft la portion de la
femme qu’on diftinguera par un autre demi-cercle
concentrique au premier , comme on le voit fig» 3.
Dans la fécondé , les deux pieds font ouverts
fur une même ligne » enforteque la difiance entre
les deux talons eft de la longueur d’un pied. V»
fig , 5*
Dans ,1a troifième , le talon d’un pied eft contre
la cheville de l’autre. V o y e { f ig . 6 . ^
Dans la quatrième, les deux pieds font l’un devant
l’autre , éloignés de la diftance du pied entre
les deux talons qui font fur une même ligne. V .
^Dans la cinquième , les deux pieds font croifés
l’un devant l’autre ; enforte que le talon d’un pied
eft diredement vis-à-vis la pointe de l’autre. V
fié' 8. . '
Dans la première des fauffes pofitions , qui font
de même au nombre de cinq, les deux pointes des
pieds fe touchent & les talons font ouverts fur une
même ligne. V . fig . 9.
Dans la fécondé, les pieds font ouverts delà
diftance de la longueur du pied entre les deux
pointes, qui font toutes deux tournées en dedans,
& les deux talons font ouverts fur une même ligne.
V . f i g . 10. , • 1 /l
Dans la troifième , la pointe d un pied eit tournée
en dehors & l’autre en dedans ; enforte que
les deux pieds foient parallèles l’un à l’autre. V o y e {
H' ^ . H H
Dans la quatrième , les deux pointes des pieds
font tournées en dedans ; mais la pointe d un pied
eft proche de la cheville de l’autre. V . f ig . i a.
Dans la cinquième , les deux pointes des pieds
font tournées en dedans ; mais le talon d un pied
eft vis-à-vis la pointe de l’antre. K f ig . 13-
D u p a s . Quoique le nombre des pas dont on le
fert dans la danfe fqit prefque infini, on les réduit
néanmoins à cinq, qui peuvent démontrer toutes
les différentes figures que la jambe peut faire en
marchant; ces cinq pas font le ftas droit, le pas
ouvert, le pas rond , le pas tortillé & le pas battu.
Les traits’ de la f ig u r e 14 défigneront le pas ; la
tête A indiquera où eft le pied avant que de marcher
; la ligne A B, la grandeur & la figure du
pas ; & la ligne B C , la pofition du pied à la fin
du pas ; on diftinguera qu’il s’agit du pied droit ou
:c h o
du pied.gauche félon qqe la hgne }?.C fera in-
clinée’à droite ou‘à gauche de la ligne dit chemin.
On connoîtra à la tête A clu pas fa durée :‘u elle
eft blanche , eUe équivaudra à une blanche de 1 air
fur lequel on danfe; fi elle eft noire, elle', équivaudra
à une noire du même air *, fi c’eft tme croche
, la tête ne fera tracée qu’à moitié en forme
Dans le pas droit, le pied marche fur une ligne
droite : il y en a* de deux fortes ; l’im en avant,
l’autre en arrière, V .f ig . & 16 .
Dans le pas ouvert la jambe s’ouvre : il y en g de
trois fortes, l’un en dehors ; l’antre en dedans; en
arc de cercle, & le troifième à côté , qu’on peut
appeller pas droit, parce que fa figure eft droite.
V. les fig. 1 7 , 18, 19. I H H
Dans le pas rond,, le pied en marchant fait une
figure ronde : il y en a de deux fortes, 1 un en
dehors.; l’autre en dèdans. V . des fig . a© & 21 •
Dans le pas. tortillé , le pied en marchant fe
tourne en dedans & en dehors alternativement ; il
y en a de trois fortes, l ’un en avant, 1 autre en arrière
, le troifième à côté. V . Us fig. 22 , 13 , 24*
Dans le pas battu, la jambe ou le pied vient b-at--
tre contre l’autre; il y en a de trois fortes ,1 un^en
avant, l’a titre en arrière, & le troifième de coté.
V . les fig. 25., 26, 27.. ; ■
On pratique en faifànt. les pas pluneurs agre-
niens , comme p lié , élevé, fauté , cabriolé , tombé,
gliffe, -avoir \q pied en l’air , pofer la pointe du pied,
pojer le talon j, tourner un quart de tour, tourner un
demi-tour. , tourner trois quarts de tour, tourner-le
tour en entier^y &c. ■ . •
"Le plier fe marque fur le pas par un petit tiret
penché du côté de la tête du pas , comme on voit
! f e *8.
L’élever fe marque fur le pas par un petit tiret
penché perpendiculaire. V. lafië• 2 9;
Le fauter par deux tirets perpendiculaires, V , la
fig. 30. mm h 1
Le cabrioler par trois. V . la fig. 31.
Le tomber par un autre tiret placé au bout du
premier, parallèle à la direélion du pas , &. tourné
vers la pointe du pied. J7, fig. 3 2-
Le gliffer par une petite ligne parallèle à la di-
re&ion du pas , & coupée par le tiret en deux parties,
dont Pune. va vers la tête & l’autre vers le
pied. V. fig. 33.
Dans le pied en l’air, le pas eft tranché comme
dans la f ig . 34.
Dans le pofer de la pointe du pied fans que le
corps y fuit porté , il y a un point direélement au
bout de la ligne qui repréfente le pied comme dans
k f i g - .3 5 - . .
Dans le pofer du talon fans que le corps y foit
porté , il y a un point dire&ement derrière , ce qui
repréfepte le talon. V . la fig. 36.
Le tourner un quart de tour fe marque par un
quart de cercle. V. la fig. 37.
Equitation , Efcrirne & Danfe•
c h o . Î8Ï
Le tournernn demi-tour par un deraî-cerçle. A*
fig. .<18. ' .
Le tourner trois quarts de tour, par les trois,
quarts de la circonférenced’ un cercle. r -M - 39-
Le tourner un tour entier, par un cercle entier-,
*Lôrfqu’il y a plufteurs fignes fur un pas , on
exécute les mouvements qtt’ ils.reprefentent les uns,
après.' les autres dans le même ordre ou ils font
placés, à commencer par ceux fi111 / ° n[ *e*. P“ ls
près de la tête du pas, qu’il faut confiderer dtvtfes
en trois parties ou temps. On fait dans le premier
temps les mouvements qui font marques fur la première
partie du pas; dans le fécond, ceux qui
font placés fur le milieu, & dans le trotfieme, ceux
qui font placés à la fin. Ainft quand il y-a un ligne
qu’il faut plier avant de marcher, de meme des au-
"très;: -
Les fams fe peuvent exécuter en deux manie-
res : où.l’ on faute des deux pieds à-la-fois , ou 1 ou
faute en marchant d’un pied feulement. Les fauts
qui fe font des deux pieds à-la-fois , feront marques
fur les pofitions , comme il fera démontre dans
l’exemple ci-après; au lieu que les fauts qui fe font
en marchant fe marquent fur les pas. ^
Le pas fauté fe fait de deux maniérés : ou Ion
faute & retombe fur la jambe qui marche , ou Ion
faine & retombe fur l’autre jambe.
S’il y a un figne fauté fur un pas, & point de
fiene en l’aii après, c’eft une marque que le faut fe
fan fur la jambe même qui marche ; s’ il y a un figne
en l’a ir, c’ eft une marque que le faut fe fait fur
l’autre jambe que celle qui marche.
La danfe, de même que la mufique,eft fans
agrément, fi la mefure n eft riguureufemenf obfervée.
. , f ,
Les mefures font marquées dans la danfe par de
petites lignes qui coupent le chemin ; les intervalles
du chemin compris entre ces lignes font occupes
par le pas, dont la durée fe connoît parles teres
blanches, noires , croches , &c.,i.qui montrent que
les pas doivent durer autant de-temps que les «votes
de Ih mufique placées au-deffus de la hgure. de la
danfe: K. l’exemple. Ainfi un pas dont la tete eft
blanche, doit durer autant qu’une blanche de 1 air
fur lequel on danfe ; & un pas dont la tete^ eft
noire, doit durer autant qu’une noire du meme
air. Les pofitions marquent de même par leurs
têtes, les temps qu’elles doivent tenir.
Il y a trois fortes de mefures dans la danfe : 1a-
mefure à deux temps j la mefure à trois temps, cC
la mefure à quatre temp's.
La mefure à deux temps comprend les airs de
gavotte, gaillarde , bourrée , rigodon , gigue, ça-
narie, &c.
La mefure à trois temps comprend, les airs de
courante , farabande , paffacaille , chacônne , menuet
, paffe-pied, &c.
La mefure à quatre temps comprend les airs
G c c