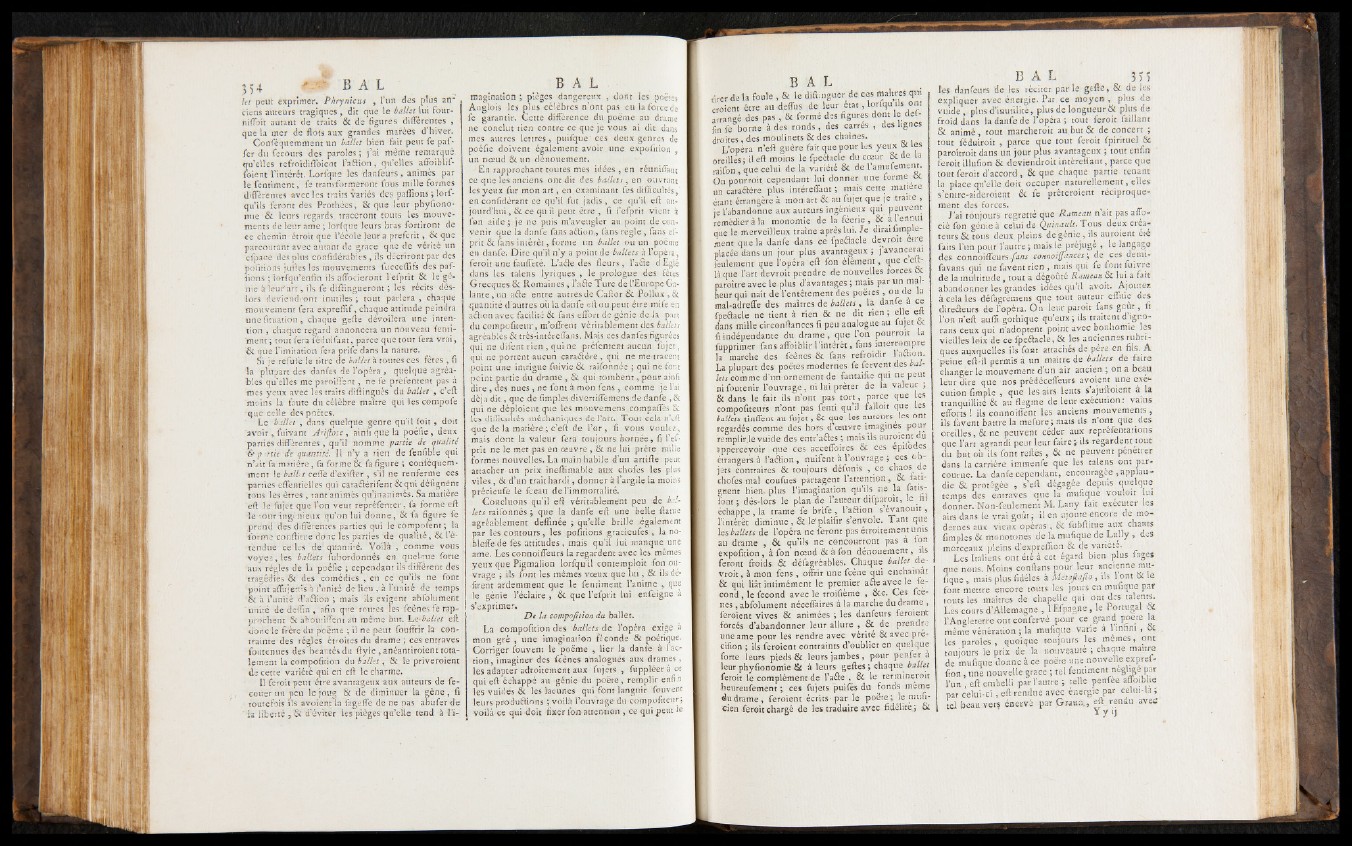
3 5 4 B A L
Ut peut exprimer. Phrynicus , l’un des plus an*
ciens auteurs tragiques, dit que le ballst lui four-
nifioit autant de traits & de figures différentes ,
que la mer de flots aux grandes marées d’hiver.
Confequemment un ballet bien fait peut fe paf-
fer du fecours des paroles ; j’ai même remarqué,
qu’elles refroidiffoient l’a â io n , qu’elles affoiblif-
foient l’intérêt. Lorfque les danfeurs, animés par
le fentiment, fe transformeront fous mille formes
différentes avec les traits variés des pallions ; lorf- ;
qu’ils feront des Prothées, & que leur phyfiono- ;
nue Sc leurs regards traceront touts les mouvements
de leur a me ; lorfque leurs bras fortiront de
ee chemin étroit que l’école leur a prefcrit, 8c que
parcourant avec autant de grâce que de vérité un
efpac-e des plus confidérablts , ils décriront par des
polirions juftes les mouvements tucceflîfs des paf- ,
lions ; lorfqu’énfin ils affocieront l’efprit & le génie
à leur'art, ils fe diftingueront ; les récits dès-
lors deviendront inutiles ; tout parlera , chaque ,
mouvement fera expreflif, chaque attitude peindra
une fituation chaque gelle dévoilera une intention
, chaque regard annoncera un nouveau (ennuient;
tout fera féduifant, parce que tout fera vrai,
8c que l’imitation fera prife dans la nature.
Si je refufe le titre de ballet a toutes ces fêtes , fi
la plupart des danfes de l’opéra , quelque agréables
qu’elles me paroiftent, ne fe prélentent pas à
mes yeux avec les traits diftingués du ballet , c’eft
moins la faute du célèbre maître qui les compofe
que celle des poètes.
Le ballet , dans quelque genre qu’il fo it , doit
"avoir , fuivant Anjlote , aïnfi que la poéfie , deux
parties différentes , qu’il nomme punie de qualité
'& partie de quantité. Il n’y a rien de fenfible qui
n’ait la matière, fa forme oc fa figure ; conféqiiem*
ment le balht ceffë d’exifter , s’il ne renferme ces
parties effentièiles qui caraélèrifent 8c qui défignént
tous les êtres , tant animés qu’inanimés. Sa matière
eft le fujet que l’on veut repréfenter, fa forme eft
le tour ingénieux qu’on lui donne, & fa figure fe
prend des différentes parties qui le compofent; la
forme conffitue donc les parties de qualité, 8c l’étendue
celles de1 quantité. Voilà , comme vous
v o y e z ,' les ballets Subordonnés en quelque forte
aux règles de la poéfie ; cependant ils diffèrent des
tragédies & des comédies , en ce qu’ils ne font
point affujettis à i’unité de lieu , à l'unité de temps
& à l’ unité d’a&ion ; mais ils exigent abfolument
unité de deffin , afin que toutes les fcènes fe rapprochent
& abOuriffenr su même but. Le-balte t eft
donc le frère du poëme ; il ne peut fouffrir la contrainte
des régies étroites du drame ; ces entraves
foutenués des beautés du ftyle , anéantiroient totalement
la compofition du ballet, & le priveroient
de cette variété qui en eft le charme.
Il feroit peut être avantageux-aux auteurs de fe-
couer un peu le joug & de diminuer la g êne, fi
toutefois ils avoient la fageffe de ne pas abufer de
la liberté , 8c d'éviter les pièges qu’elle tend à l ’i-
B A L
magînatîon ; pièges dangereux , dont les poètes
Anglois les plus célèbres n’ont pas eu la force de
fe garantir. Cette différence du poëme au drame
n.e conclut rien contre ce que je vous ai dit dans
mes autres lettres, puifque' ces deux genres de
poéfie doivent également avoir une expofition ,
un noeud 8c un dénouement.
En rapprochant toutes mes idées , en réunifiant
ce que les anciens ont dit des ballets, en ouvrant
les yeux fur mon art , en examinant fes difficultés,
en confidérant ce qu’il fut jadis, ce qu’il eft aujourd’hui,
8c ce qu ii peut être , fi i’efprit vient à
f®n aide ; je ne puis m’aveugler au point de convenir
que la danfe fans aélion/, fans règle , fans ef-
prit 8c fans intérêt, forme un ballet ou un poëme
en danfe. Dire qu’il n’y a point de ballets à l’opéra,
feroit une fauffeté. L’aéle des fleurs, l’a&e d Eglé
dans les talens lyriques , le prologue des fêtes
Grecques 8c Romaines, l’aéle Turc de l’Europe Galante
, un aéle entre autres de Caftor 8c Poilux , 8t
quantité d’autres où la danfe elt ou peut être mife en
a&ion avec facilité 8c fans effort de génie-de la part
du compofiteur, m’offrent véritablement des ballets
agréables 8c très-intéreffans. Mais ces danfes figurées
qui ne difent rien , qui ne préfentent aucuin fujet,
qui ne portent aucun caraélère , qui ne me tracent
point une intrigue fuivie 8c raifonnée ; qui ne font
peint partie du drame , 8c qui tombent, pour ainfi
dire , des nues, ne font à mon fens , comme je l’ai
déjà d it, que de (impies divertiffemens de danfe , &
qui ne déploient que les mouvemens compaffés &
les difficultés méchaniques de l’art. Tout cela n’eft
que de la matière ; c’eft de l’o r , fi vous voulez,
mais dont la valeur fera toujours bornée, fi l’ef-
prit ne le met pas en oeuvre , 8c ne lui prête mille
formes nouvelles. La main habile d’un artifte peut
attacher un prix ineftiniable aux choies les plus
viles, 8c d’un trait hardi, donner à l’argile la moins
précieufe le fceau de l’immortalité.
Concluons qu’il eft véritablement peu de bel-
lets raifonnés ; que la danfe eft une belle ftatue
agréablement deffinée ; qu’elle brille également
par les contours, les polirions gracieufes , la no-
bleffe de fes attitudes , mais qu’il lui manque une
ame. Les connoiffeurs la regardent avec les mêmes
yeux que Pigmalion lorfqu'il contemploit fon ouvrage
; ils font les mêmes voeux que lu i, 8c ils de*
firent ardemment que le fentiment l’anime , que
le génie l’éclaire , 8c que l’efprit lui enfeigne a
s’exprimer.
De la compofition du ballet.
La compofition des ballets àe l’opéra exige à
mon gré , une imagination féconde 8c poétique.
Corriger fouvent le poëme , lier la danfe à l’action,
imaginer des fcènes analogues aux drames,
les adapter adroitement aux fiijets , fuppléer à ce
qui eft échappé au génie du poëte, remplir enfin
les vuirlés & les lacunes qui font languir fouvent
leurs produirions ; voilà l’ouvrage du compofiteur;
voilà ce qui doit fixer fon attention, ce qui peut le
B A L
rirer de la foule , & le diftinguer de ces maîtres qm
croient être au deffus de l e u r état ,.lorfqu ils ont
arrangé des pas, & formé des figures dont l e deffin
fe borne à des ronds , des carres , des lignes
droites, des moulinets 8c des chaînes.
L’opéra n’eft guère fait que pour les yeux oc Les
oreilles; il eft moins le fpe&acle du coeur 8c de la
raifon , que celui de la variété 8c de l’amufement.
On pourroit cependant lui donner une forme oc
un caraâëre plus intéreffant ; mais cette matière
étant étrangère à mon art 8c au fujet que je traite ,
je l’abandonne aux auteurs ingénieux qui peuvent
remédier à la monomie de la féerie, & à 1 ennui
que le merveilleux traîne après lui. Je dirai fnnple-
fnent que la danfe dans ce fpe&acle devroit e-tre
placée dans un jour plus avantageux ; j’avancerai
feulement que l’opéra eft fon élément, que c effila
que l’art devroit prendre de nouvelles forces oc
paroîtreavec le plus d’avantages ; mais par un malheur
qui naît de l’entêtement des poètes , ou de la
mal-adreffe des maîtres de ballets, là danfe a ce
fpeôacle ne tient à rien 8c ne dit rien ; elle eft
dans mille circonftances fi peu analogue au fujet oc
fi indépendante du drame, que l’on pourroit la
fupprimer fans affaiblir l ’intérêt, fans interrompre
la marche des fcènes 8c fans refroidir 1 action.
La plupart des poëtes modernes fe fervent des bal-
lets comme d’un ornement de fantaifie qui ne peut
ni foutenir l’ouvrage, ni lui prêter de la valeur ;
& dans le fait ils n’ont pas tort , parce que les
compofiteurs n’ont pas fenti qu’il falloit que les
ballets tinffent au fujet, 8c que. les auteurs^ les ont
regardés comme des hors d’oeuvre imagines pour
remplir je vuide des entr’aéles ; mais ils auroient du
Apercevoir que ces acceffoires 8c ces epifodes
étrangers à l’aétion , nuifent à l’ouvrage ; ces objets
contraires 8c toujours défunis , ce chaos de
choies mal coufues partagent l’attention, 8c fati-
gaent bien, plus l’imagination qu’ils ne la fatis-
font; dès-lors le plan de l’auteur difparoît, le fil
échappe , la trame fe brife , l’aftion s’évanouit,
l’intérêt diminue, 8c le'plaifir s’envole. Tant que
les ballets de l’opéra ne feront pas étroitement unis
au drame , 8c qu’ils ne concourront pas à fon
expofition , à fon noeud 8c à fon dénouement, ils
feront froids. 8c défagréables. Chaque ballet devroit,
à mon fens , offrir une fcène qui enchainat
8c qui liât intimément le premier a&e avec le fécond
, le fécond avec le troifième , 8cc. Ces fee-
nes, abfolument néceffaires à la marche du drame ,
feroient vives 8c animées ; les danfeurs feroiertt
forcés d’abandonner leur allure , 8c de prendre
une ame pour les rendre avec vérité 8c avec pre-
cifion ; ils feroient contraints d’oublier en quelque
forte leurs pieds 8c leurs jambes , pour penfer a
leur phyfionomie & à leurs geftes ; chaque ballet
feroit le complément de l’aéle , 8c le termineroit
heureufement ; ces fujets puifés du fonds meme
du drame, feroient écrits-par le poète; le mufi-
cien feroit chargé de les traduire avec fidélité j 8c
B A L 3)5
les danfeurs de les réciter par le gefte, 8c de les
expliquer avec énergie. Par ce moyen , plus de
vuide, plus d’inutilité, plus de longueur 8c plus de
froid dans la danfe de l’opéra ; tout feroit faillant
8c animé, tout marcheroit au.but8c de concert ;
tout féduiroit , parce que tout feroit fpirituel 8c
paroîtroit dans un jour plus avantageux ; tout enfin
feroit illufion 8c deviendroit intéreffant, parce que
tout feroit d’accord , 8c que chaque partie tenant
la place qu’elle doit occuper naturellement, elles
s’entre-aideroient 8c fe prêteroient réciproquement
des forces.
J’ai toujours regretté que Rameau n ait pas affo-
cié fon génie à celui de Quinau.lt. Tous deux créateurs
8c tous deux pleins de génie, ils auroient été
faits l'un pour l’autre; mais le préjuge , le langage
, des connoiffeurs ./ans connoiffdnces ; de ces demi-
favans qui ne favent rien , mais qui fe font fui vie
i de la multitude , tout a dégoûte Rameau 8c lui a fait
abandonner les grandes idées qu’il avoir. Ajoutez
à cela les défagrémens que tout auteur effuie des
directeurs de l'opéra. On leur paroîr fans g cu t, fi
l’on n’eft auffi gothique qu’eux; ils traitent d igno-
rans ceux qui n’adoptent point avec bonhomie les
vieilles loix de ce fpeélacle, 8c les anciennes rubriques
auxquelles ils font attachés de père en fils. A
"peine cft-il permis à un maître de ballets de faire
changer le mouvement d un air ancien ; on a beau
leur dire que nos prédéceffeurs avoient une exe**
cution fimple , que les airs lents sajuftoient à la
tranquillité 8c au flegme de leur exécution: vains
efforts ! ils connoiffent les anciens mouvements ,
ils favent battre la mefure; mais ils n ont que des
oreilles, 8c ne peuvent céder aux reprefentations
que l’art agrandi peur leur faire; ils regardent tout
du but où ils font reftés , 8c ne peuvent pénétrer
dans la carrière immenfe que les talens ont parcourue.
La danfe cependant, encouragée , applaudie
8c protégée , s’eft dégagée depuis quelque
temps des entraves que la mufique vouioit lui
donner. Non-feulement M. Lan y fait executer les
airs dans le vrai goût; il en ajoute encore de modernes
aux vieux opéras , 8c fubftitue aux chants
(impies 8c monotones de la mufique de Lully , des
morceaux pleins dlexpreffion 8c de variété.
Les Italiens ont été à cet égard bien plus lages
que nous. Moins conftans pour leur ancienne mu*
fique , mais plus fidèles à Mèufiafio , ils l’ont 8c le
font mettre encore touts les jours en mufique par
touts les maîtres de chapelle qui Ont des talents.
Les cours d’Allemagne , 1 Efpagne, le Portugal oc
l’Angleterre ont confervé pour ce grand poete la
même vénération ; la mufique varie à 1 infini , Sc
les paroles , quoique toujours les memes, ont
toujours le prix de la nouveauté ; chaque maure
de mufique donne à ce poète une nouvelle exprel-
fion , une nouvelle grâce ; tel fentiment négligé par
l’un , eft embelli par l’autre ; telle penfee affoiblie
par celui-ci, eft rendue avec énergie par celui-la ;
tel beau vers énervé par Gr-aun0 e(l rendu avec
Y y ij