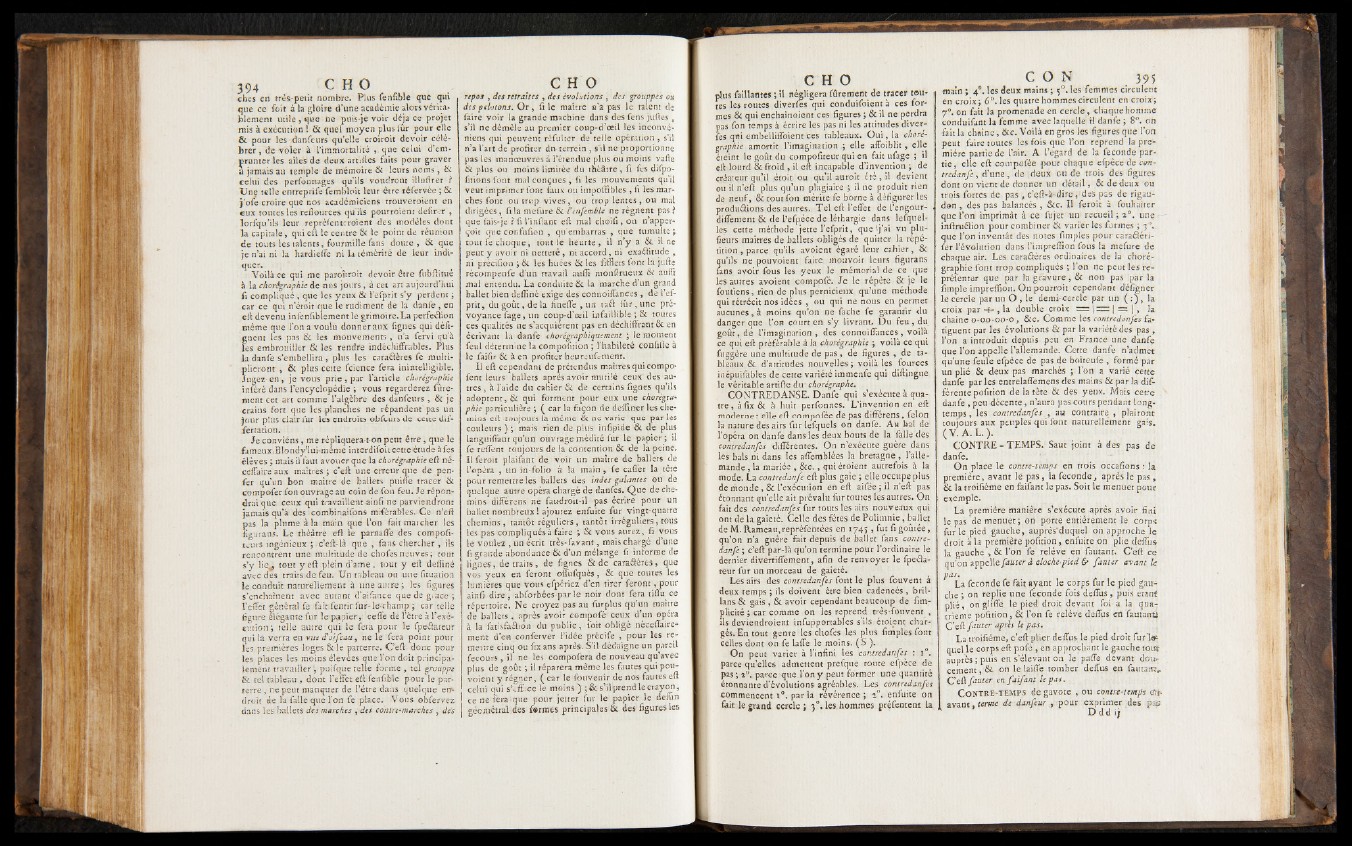
394 C H O
ches en très-petit nombre. Plus fenfible que qui
que ce foit à la gloire d’une académie alors vérita-
blement utile, que ne puis-je voir déjà ce projet
mis à exécution ! & quel moyen plus lûr pour elle
& pour les danfeurs qu’elle croiroit devoir célébrer
, de^ voler à l’immortalité que celui d’emprunter
les ailes de deux articles faits pour graver
a jamais au temple de mémoire & leurs noms , 8c
celui des perfonnages qu’ils voudront illuflrer ?
XJne telle entreprife fembloit leur être réfervée ; &
j ’ofe croire que nos académiciens trouveroient en
eux toutes les reflources qu'ils pourroient defirer ,
lorfqu’ils leur repréfenteroient des modèles dont
la capitale, quieft le centre & le point de réunion
de touts les talents, fourmille fans doute , 8c que
je n’ai ni la hardieffe ni la témérité de leur indiquer.
‘ _ ' - • '
Voilà ce qui me paroîtroit devoir être fubftitué
à la chorégraphie de nos jours, à cet art aujourd’hui
fi compliqué , que les yeux 8c l’efprit s’y perdent ;
car ce qui n’étoit que le rudiment de la daniè , en
eft devenu infenfiblementle grimoire. La perfection
même que l’on a voulu donner aux fignes qui défi-
gnent les pas & les mouvements , n’a fervi qu'à
les embrouiller 8c les rendre indéchiffrables. Plus
la danfe s’embellira, plus les caractères fe multiplieront
, 8c plus cette fcience fera inintelligible.
Jugez-en, je vous p rie, par l’article chorégraphie
inféré dans l’encyclopédie ; vous regarderez fûre-
ment cet art comme l’algèbre des danfeurs , 8c je
crains fort que les planches ne répandent’ pas un
jour plus clair fur les endroits obfcurs de cette dif-
fertation.
Je conviéns, me répliquera-t-on peut être, que le
fameuxjBlondy’lui-même interdifoit cette étudeàfes
élèves ; mais il faut avouer que la chorégraphie eft né-
ceffaireaux maîtres; c’eft une erreur que de pen-
fer qu’un bon maître de ballets puiffe tracer 8c
compofer ion ouvrage ail coin de fon feu. Je répondrai
que ceux qui travaillent ainfi ne parviendront
jamais qu’à des combinaifons miférables. Ce n'eil
pas la plume à la main que l’on fait marcher les
figurans. Le théâtre efl le parnaffe des composteurs
ingénieux ; c’eft-là que , fans chercher , ils
rencontrent une multitude de chofesneuves; tout
s’y lierf tout y eft plein d’ame , tout y efl deftîné
avec des traits de feu. Un tableau ou une fituation
le conduit naturellement à une autre ; les figures
s’enchaînent avec autant d’aifance que de giace;
l ’effet général fe fait.fentir fur-le-champ ; car telle
ligure élégante fur le papier, ceffe de l’être à l’exécution
; telle autre qui le fera pour le fpe&àteur
qui la verra en vus cPoifeau, ne le fera point pour
les premières loges & le parterre. C ’eft. donc pour
les places les moins élevées que l’on doit principalement
travaillerpuifque telle forme , tel grouppe
& tel tableau , dont l’effet eft'fenfible pour le parterre
, ne peut manquer de l’être dans quelque endroit
de la faîle que Ton fe place. Vous obfervez
dans les ballets des marches , des contre-marches , des
C H O
repos , des retraites , des évolutions , des grouppes on
des pelotons. O r , fi le maître n’a pas le talent de
faire voir la grande machine dans des fens jufles ,
s’il ne démêle au premier coup-d’oeil les inconvé-
niens qui peuvent rèfulter de telle opération , s’il
n’a l’art de profiter du terrein , s’il ne proportionne
pas les manoeuvres à l’étendue plus ôu moins yafte
& plus ou moins limitée du théâtre , fi les difpo-
fitions font mal conçues , fi les mouvements qu’ri
veut imprimer font faux ou impoffibles , fi les marches
font ou trop vive s, ou trop lentes, ou mal
dirigées, fila mefure 8c Vensemble ne régnent pas î
que fais-je ? fi l’inflant efl mal choifi, on n’apper-
1 çoit que confufion , qu embarras , que tumulte ;
tout fe choque, tout le heurte , il n’y a 8c il ne
peut y avoir ni netteté, ni accord, ni exa&itude ,
ni précifion ;8c lés huées & les fifHets font là juftc
récompense d'un travail anfîi monflrueux & aufli
mal entendu. La conduite 8c la marche d’un grand
ballet bien defîiné exige des connoiffances , de l’ef-
prit, d u g o û tjd e la fineffe , un tacl fur , une prévoyance
Sage, un coup-d’oeil infaillible ; 8c toutes
ces qualités ne s’acquièrent pas en déchiffrant 8c en
écrivant la danfe chorégraphiquement ; le moment
feul détermine la compofition ; l'habileté conûfte à
le faifir & à en profiter heureufcment.
Il efl cependant de prétendus maîtres qui compo*
fent leurs ballets après avoir mutilé ceux des autres
, à l'aide du cahier 8c de certains fignes qu’ils
adoptent, & qui forment pour eux une chorégra•
phie particulière ; ( car la façon de defîiner les chemins
efl toujours la même & ne varie que par les
couleurs ) ; mais rien de plus infipide & de plus
languiffanr qu’un ouvrage médité fur lé papier; il
fe reffent toujours de la contention & de la peine.
Il feroit plaifant de voir un maître de ballets de
l’opéra , un in-folio à la main , fe caffer la tête
pour remettre les ballets des indes galantes ou de
quelque autre opéra chargé de danfes. Que de chemins
différens ne faudroitil pas écrire pour un
ballet nombreux ! ajourez enfuite fur vingt-quatre
chemins, tantôt réguliers, tantôt irréguliers, tous
les pas compliqués à faire ; & vous aurez, fi vous
le voulez , un écrit trés-favant, mais chargé d’une
fi grande abondance & d’un mélange fi informe de
lignes, dé trait-s, de fignes & de caradères, que
; vos yeux en feront onufqués, 8c que toutes les
lumières que vous efpériez d’en tirer feront, pour
ainfi dire , abforbées par le noir dont fera tiffu ce
répertoire. Ne croyez pas au furplus qu’un maître
de ballets, après avoir compofé ceux d’un opéra
à la fatisfa&ion du public, loit obligé néceffaire-
ment d’en conferver l’idée précife , pour les remettre
cinq ou fix ans après. S’il dédaigne un pareil
fecours , il ne les compofera de nouveau qu’avec
plus de goût ; il réparera même les fautes qui pou-
voient y régner, ( car le fouvenir de nos fautes eft
celui qui s’Æ .ce le moins ) ; & s’il prend le crayon,
I ce ne fera que pour jetter fur le papier le deffin
| gécmétral des formes principales ôc des figures les
C H O
plus faillantes ; il négligera fûremem de tracer toutes
les routes diverfes qui conduifoient à ces formes
8c qui ençhaînoient ces figures ; & il ne perdra
pas fon temps à écrire les pas ni les attitudes diverfes
qni embelliffoient ces tableaux. Oui, la chorégraphie
amortit l’imagination ; elle affoiblit, elle
éteint le goût du compofiteur qui en fait ufage ; il
eft-lourd & froid , il eft incapable d’invention ; de
< & ^ § b S l étoit ou qu’il auroit été, il devient
ou il n’eft plus qu’un plagiaire ; il ne produit rien
de neuf, 8c tout fon mérite fe borne à défigurer les
produdions des autres. Tel eft l’effet de l’engour- .
diffement 8c de l’efpèce de léthargie dans lesquelles
cette méthode jette l’efprit, que-j’ai vu plu-
fieurs maîtres de ballets obligés de quitter la répétition
, parce qu’ils avoient égaré leur cahier, 8c
qu’ils ne pouvoient faire mouvoir leurs figurans
lans avoir fous les yeux le mémorial de ce que
les autres avoient compofé. Je le répète 8c je le
foutiens, rien de plus pernicieux qu’une méthode
qui rétrécit nos idées , ou qui ne nous en permet
aucunes, à moins qu’on ne fâche fe garantir du
danger que l’on court.en s’y livrant. Ou feu , du
goût, de l'imagination , des connoiffances , voilà
ce qui eft préférable à la chorégraphie ; voilà ce qui
fuggère une multitude de pas , de figures , de tableaux
8c d’attitudes nouvelles ; voilà les fources
inépuisables de cette variété immenfe qui diftingue
le véritable artîfte du- chorégraphe.
CONTREDANSE. Danfe qui s’exécute à quatre,
à fix 8c à huit perfonnes. L’invention en eft
moderne : elle eft compofée de pas diftérens, félon
la nature des airs fur lefquels on danfe. Au bal de
l’opéra on danfe dans les deux bouts de la falle des
contredanfes différentes. On n’exécute guère dans
les bals ni dans les affemblées la bretagne , l’allemande
, la mariée , &c., qui étoient autrefois à la
mode. La contredanfe eft plus gaie ; elle occupe plus
de monde, 8c l’exécution eh eft aifée ; il n’eft pas
étonnant qu’elle ait prévalu fur toutes les autres. On
fait des contredanfes fur touts les airs nouveaux qui
ont de la gaieté. Celle des fêtes de Polimnie, ballet
de M. Rameau,repréfentées en 1745 , fut fi goûtée,
qu’on n’a guère fait depuis de ballet fans contredanfe
; c’eft par-là qu’on termine pour l’ordinaire le
dernier divertiffement, afin de renvoyer le fpeâa-
teur fur un morceau de gaieté.
Les airs des contredanfes font le plus fouvent à
deux temps ; ils doivent être bien cadencés , bril-
lans 8c gais , 8c avoir cependant beaucoup de fim-
plicité ; car comme on les reprend très-fouvent ,
ils devïendroient infupportables s'ils étoient chargés.
En tout genre les chofes les plus fimples font
celles dont on fe laffe le moins. (S ).
On peut varier à l’infini les contredanfes : i°.
parce qu’elles admettent prefque toute efpèce de
pas ; 20. parce que l’on y peut former une quantité
étonnante d évolutions agréables. Les contredanfes
commencent i°. par la revérence ; 20. enfuite on
fait le grand cercle; 3 °. les. hommes préfentent la
C O N 395
main ; 40. les deux mains ; 50. les femmes circulent
en croix; 6 °. les quatre hommes circulent en croix;
70. on fait la promenade en cercle, chaque homme
conduifant la femme avec laquelle H danfe ; 8°. on
fait la chaîne, &c. Voilà en gros les figures que l’on
peut faire toutes les fois que l’on reprend la première
partie de l’air. A l’egard de la fécondé partie,
elle eft compofée pour chaque efpèce de contredanfe,
d’une, de .deux oti de trois des figures
dont 011 vient de donner un détail, 8t de deux ou
trois fortes de pas ,, c’eft-à-direy des pas de rigaudon
, des pas balancés, 8cc. Il feroit à fouhaiter
que l’on imprimât à ce fujet uu recueil; 20. une —
inftruâion pour combiner & varier les formes ; 3 V
que l’on inventât des notes fimples pour caraéléri-
fer l’évolution dans l’impreffion fous la mefure de
chaque air. Les. caraâères ordinaires d elà chorégraphie
font trop compliqués ; l’on ne peut les représenter
que par la gravure, 8c non pas par la
Simple impreflion. On pourroit cependant défigner
le cercle par un O , le demi-cercle par un ( :) , la
croix par -f- , la double croix = | = | == | , la
chaîne 0-00-00-0, 8tc. Comme les contredanfes fatiguent
par les évolutions 8c par la variété des pas ,
l’on a introduit depuis peu en France une danfe
que l’on appelle l’allemande. Cette danfe n’admet
qu’une feule efpèce de pas de boîteufe , formé par
un plié 8c deux pas marchés ; l’on a varié cette
danfe par les entrelaffemens des mains 8c par la différente
pofition de la tête 8c des yeux. Mais cetre
danfe, peu décente, n’aura pas cours pendant longtemps,
les contredanfes , au contraire, plairont
toujours aux peuples qui font naturellement gais.
( V .A . L .) .
CONTRE - TEMPS. Saut joint à des pas de
danfe.
On place le contre-temps en trois occafions : la
première, avant lé pas , la fécondés après le pas ,
& la troifième en faifant le pas. Soit le menuet pour
exemple.
La première manière s’exécute après avoir fini
le pas de menuet; on porte entièrement le corps
furie pied gauche, auprès'duquel on approche le
droit à la première pofition, enfuite on plie deffus
la gauche , 8c l’on fe relève en fautant. C ’eft ce
qu’on appelle fauter à cloche-pied &> fauter avant le
■ V^s%
La fécondé fe fait ayant le corps fur le pied gauche
; on replie une fécondé fors deffus , puis étant
j plié, on gliffe le pied droit devant foi a la quatrième
pofition, 8c l’on fe relève deffus en famanti
i Ç ’eft fauter apres le pas.
La troifième, c’ eft pliet deffus le pied droit furie6
quel le corps eft pofé , en approchant le gauche tout
auprès ; puis en s’élevant on le paffe devant dou*
cernent, 8c on le laiffe tomber deffus en fautam*.
C ’eft fauter en faifant le pas.
C ontre-temps de gavote , ou contre-temps eft*
avant, terme de danfeur J pour exprimer des pap
D d'd i|