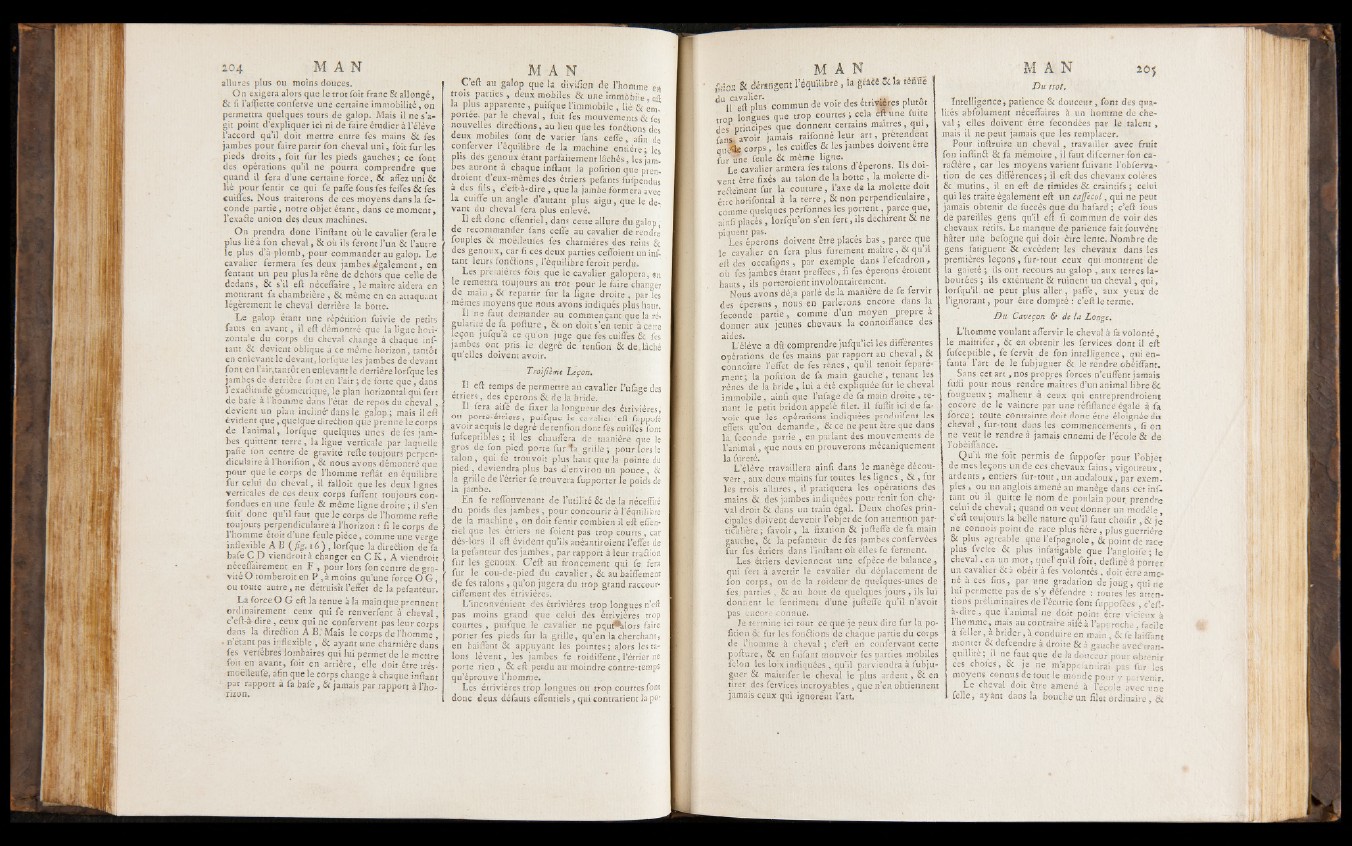
allures plus ou moins douces.
On exigera alors que le trot Toit franc 8c allongé,
& fi l’affiette conferve une certaine immobilité, on
permettra quelques tours de galop. Mais il ne s’agit
point d’expliquer ici ni de faire étudier à l’élève
l’accord qu’il doit mettre enrre fes mains 8c fes
jambes pour faire partir fon cheval uni, foit fur les
pieds droits , foit fur les pieds gauches ; ce font
des opérations qu’il ne pourra comprendre que
quand il fera d’une certaine force, 8c affez uni &
lié pour fentir ce qui fe paffe fous fes feffes & fes
cuiffes. Nous traiterons de ces moyens dans la fécondé
partie, notre objet étant, dans ce moment,
l’exa&e union des deux machines.
On prendra donc l’inftant oii'le cavalier fera le
plus lié à fon cheval, & où ils feront l’un 8c l’autre
le plus d’à-plomb, pour commander augalop. Le
cavalier fermera fes deux jambes également, en
fentant un peu plus la rêne de dehors que celle de
dedans, 8c s’il eft néceffaire , le maître aidera en
montrant fa chambrière , & même en en attaquant
légèrement le cheval derrière la botte.
Le galop étant une répétition fuivie de petits
fauts en avant, il eft démontré que la ligne horizontale
du corps du cheval change à chaque inf-
tant & devient oblique à ce même horizon, tantôt
en enlevant le devant, lorfque les jambes de-devant
font en l’air,tantôt en enlevant le derrière lorfque les
jambes de derrière font en l’air ; de forte que, dans
l’exaélitudè géométrique, le plan horizontal qui fert
de baie a 1 homme dans l’état de repos du cheval,
devient un plan incliné* dans le galop-; mais il eft
évident que, quelque direétion que prenne le corps
de l’animal, lorfque quelques unes de fes jambes
quittent terre, la ligue verticale par laquelle
pafie fon centre de gravité refte toujours perpendiculaire
a 1 horifion , 8c nous avons démontré que
pour que le corps de l’homme reftât en équilibre
fur celui du cheval, il falloit que les deux lignes
verticales de ces deux corps fuffent toujours confondues
en une feule & même ligne droire ; il s’en
fuit donc qu’il faut que le corps de l’homme refte
toujours perpendiculaire à l’horizon : fi le corps de
l ’homme étoit d’une feule pièce, comme une verge
inflexible A B (fig. 16 ) , lorfque la dire&ion de la
bafe C D viendroir à changer en C K , A viendroit
néceftairement en F , pour lors fon centre de gravité
O tomberoit en P , à moins qu’une force O G ,
ou toute autre, ne détruisît l’effet de la pefanteur.
La force O G eft la tenue à la main que prennent
ordinairement ceux qui fe renverfenc à cheval,
c’eft-à-dire , ceux qui ne confervent pas leur corps
dans la direâion A B. Mais le corps de l’homme,
• n’étant ças inflexible , 8c ayant une charnière dans
fes vertebres lombaires qui lui pérmet de le mettre
foit em avant, foit en arrière, elle doit être très-
moëlleufe, afin que le corps change à chaque inftant
par rapport à fa bafe, 8i jamais par rapport à l’horizon.
C eft au galop que la oivîfion de l’homme ea
trois parties, deux mobiles & une immôbiiè. eft
la plus apparente , puifque l’immobile , lié 8c emportée,
par le cheval, fuit fes mouvements & fes
nouvelles directions, au lieu que les fondions des
deux mobiles font de varier fans ceffe, afin de
conferver 1 équilibré de la machine entière; les
plis dés genoux étant parfaitement lâchés, les jambes
auront à chaque inftant la pofition que prenn
e n t d’eux-mêmes des étriers pefants fufpendus
a des fils, c’eft-à-dire , que la jambe formera avec
la cuiffe un angle d’autant plus aigu, que le devant
du cheval fera plus enlevé.
Il eft donc eftentiel, dans cette allure du galop
de recommander fans ceffe au cavalier de rendre
fouples 8c moëileufes fes charnières des reins 8c
des genoux, car fi ces deux parties ceffoient un inftant
leurs fon&ions , l’equilibre feroit perdu.
Les pre-nieres fois que le cavalier galopera, ©n
le remettra toujours au trot pour le faire changer
ds main, 5c repartir fur la ligne droite , par les
mêmes moyens que nous avons indiqués plus haut.
Il ne faut demander au commençant que la ré*
gularùe de fa pofture, 8c on doit s’en tenir à cette
leçon jufqu’à ce qu'on juge que fes cuiffes 8c fes
jambes ont pris le degré de tenfion & de,lâché
qu’elles doivent avoir.
Troificme Leçon.
Il eft temps de permettre au cavalier I’ufage des
étriers, des éperons & de la bride.
Il fera aifé de fixer la longueur des étrivières,
ou porte-étriers, puifque le cavalier eft fuppofé.
avoir acquis le degré de tenfion dont fes cuiffes font
fufceptibles ; il les chauffera de manière que le
gros de fon pied porte fur la grille ; pour lors le
talon, qui fe trouvoit plus haut que la pointe du
pied , deviendra plus bas d’environ un pouce, &
la grille de l’étrier fe trouvera fupporter le poids de
la jambe.
En fe reffou venant de l’utilité & de la néceflité
du poids des jambes , pour concourir à l ’équilibre
de la machine | on doit fentir combien il eft effen-
tiel que les etriers ne foient pas trop courts, car
dès-lors il eft évident qu’ils anéantir oient-l’èffet de
la pefanteur des jambes , par rapport à leur traftion
fur les genoux. C ’eft au froncement qui fe fera
fur le cou-de-pied du cavalier, 8c au baiffement
de fes talons , qu’on jugera du trop grand raccour-
ciffement des étrivières.
L’inconvénient des étrivières trop longues n’eft
pas moins grand que celui des étrivières trop
courtes , puifque le cavalier ne pe.uÂlors faire
porter fes pieds fur la grille, qu’en la cherchant,
en baiffant 8c appuyant les pointes; ajors les talons
lèvent, les jambes fe roidiffent, l’étrier ne
porte rien , & eft pendu au moindre contre-temps
qu’éprouve l’homme.
Les étrivières trop longues ou trop courtes font
donc deux défauts effentiels, qui contrarient la po*
frios & dérangent i’équUibre , ïa gfâJê & la téffHë
dU[lCaJft plus commun de voir des étrivières plutôt
trop longues que trop courtes; cela eîfune fuite
!tes principes que donnent certains maures, qui,
fans* avoir jamais raifonné leur a r t, prétendent
quelle corps, les cuiffes 8c les jambes doivent.etre
fur une feule & même ligne. _ .
Le cavalier armera fes talons d éperons. Ils doivent
être fixés au- talon de la botte , la molette di-
re&ement fur la couture, l’axe de la molette doit
être horifontal à la terre , & non perpendiculaire,
comme quelques perfonnes les portent, parce que,
ai n fi placés , lorfqu’on s’en fe r t, ils déchirent 8c ne
piquent pas. , ,
Les éperons doivent être places bas , parce que
le cavalier en fera plus furement maître, & qu il
eft des occafipns , par exemple dans l’efcadron,
où fes jambes étant preffées, fi fes éper.ons etoient
hauts , ils porteraient involontairement.
Nous avons dè;a parlé de la maniéré de fe fervir
des éperons, nous en parlerons encore dans la
fécondé partie, comme d’un moyen propre à
donner aux jeunes chevaux la connoiffance des
aides. . .
L’élève a dû comprendre jufqu’ ici les differentes
opérations de fes mains par rapport au cheval, &
connoître l’effet de fes rênes, qu’il tenoit féparé*
mçnt; la pofition de fa main gauche , tenant les
rênes de la bride , lui a été expliquée fur le cheval
immobile , ainfi que l’ufage de fa main droite , tenant
le petit bridon appelé filet. .11 fuftit ici de fa-
voir que les opérations indiquées produifent les
effets qu’on demande , & ce ne peut être que dans
la. fécondé partie , en parlant des mouvements de
l ’animal, que nous en prouverons mécaniquement
la fureté.
L’élève travaillera ainfi dans le manège découvert
, aux deux- mains fur toutes les lignes , & , fur
les trois allures , il pratiquera les opérations des
mains & des jambes indiquées pour tenir fon cheval
droit & dans un train égal. Deux chofes principales
doivent devenir l’objet de fon attention particulière
; favoir , la fixation 8c jufteffe de fa main
gauche, 8c la pefanteur de fes jambes confervées
fur fes étriers dans l’inftant où elles fe ferment.
Les étriers deviennent une efpèce de balance,
qui fert à avertir le cavalier du déplacement de
fon corps, ou de la raideur de quelques-unes de
fes: parties , & au bout de quelques jours ils lui
donnent le fentiment d’une jufteffe qu’il n’avoit
pas encore connue.
Je termine ici tout ce que je peux dire fur la pofition
& fur les fondions de chaque partie du corps
de l’homme à cheval ; c’eft en confervant cette
pofture, 8c en faifant mouvoir lès parties mobiles
félon les loix indiquées , qu'il parviendra à fubjliguer
8c maîtrifer le cheval le plus ardent, 8c en
tirer des fervices incroyables , que n’en obtiennent
jamais ceux qui ignorent l’art.
Du trot.
Intelligence, patience 8c douceur, font des qualités
ab foin ment néceffaires à un homme de cheval
; elles doivent être fécondées par le talent ,
mais il ne peut jamais que les remplacer.
Pour inftruire un cheval, travailler avec fruit
fon inftind 8c fa mémoire , il faut difcerner fon caractère
, car les moyens varient fuivant l ’obferva-
tion de ces différences ; il eft des chevaux colères
8c mutins, il en eft de timides 8c craintifs; celui
qui les traite également eft un cajfecol, qui ne peut
jamais obtenir de fuccès que du hafard ; c’eft: fous
de pareilles gens qu’il eft fi commun de voir des
chevaux rétifs. Le manque de patience fait fouvènt
hâter une befogne qui doit être lente. Nombre de
gens fatiguent 8c excèdent les chevaux dans les
premières leçons, fur-tout ceux qui montrent de
la gaieté; ils ont recours au galop , aux terres labourées
; ils exténuent 8c ruinent un cheval, qui,
i lorfqu’il ne peut plus aller, paffe, aux yeux de
l’ignorant, pour être dompté : c’eft le terme.
Du Caveçon &• de la Longe.
L’homme voulant affervir le cheval à fa volonté,
le maîtrifer, 8c en obtenir les fervices dont il eft
fufceptible, fe fervit de fon intelligence, qui enfanta
l’art de le fubjuguer 8c le rendre obéiffant.
Sans cet a r t, nos propres forces n’eiiffent jamais
fufli pour nous rendre maîtres d’un animal libre 8c
fougueux ; malheur -à ceux qui entreprendraient
encore de le vaincre par une réfiftance égale à fa
force ; toute contrainte doit donc être éloignée du
cheval, fur-tout dans les commencements , fi on
ne veut le rendre à jamais ennemi de l’école 8c de
l’obéiffance. ....
Q u’il me foit permis de fuppofer pour l’objet
de mes leçons un de ces chevaux fains, vigoureux,
ardents , entiers fur-tout, un andaloux, par exem’
pies, ou un anglois amené au manège dans cet inftant
où il quitte le nom de poulain pour prendre
celui de cheval ; quand on veut donner un modèle
c’eft toujours la belle nature qu’il faut choifir , 8c je
ne connois point de race plus fiere , plus guerrière
8c plus agréable que l’efpagnole, & point de race
plus fvelte 8c plus infatigable que l’angloife ; le
cheval, en un mot , queî1 qu’il foit, deftine à porter
un cavalier 8c à obéir à fes volontés , doit être amené
à ces fins, par une gradation de jou g, qui ne
lui permette pas de s’y défendre : toutes les attentions
préliminaires de l’écurie font fuppoféës , c’eft-
à-dire , que l’animal ne doit point être vicieux à
l’homme, mais au contraire aifé à l’approche, facile
à feller, à brider, à conduire en main , 8c fe laiffant
monter 8c defcendre a droite 8c à gauche avec'tran-
quillité ; il ne faut que de la douceur pour obtenir
ces chofes, 8c je ne m’appefanùrâi pas fur les
moyens connus de tout le monde pour y parvenir.
Le cheval doit être amené à l’école avec une
felle, ayânt dans la bouche- un filet ordinaire 8c