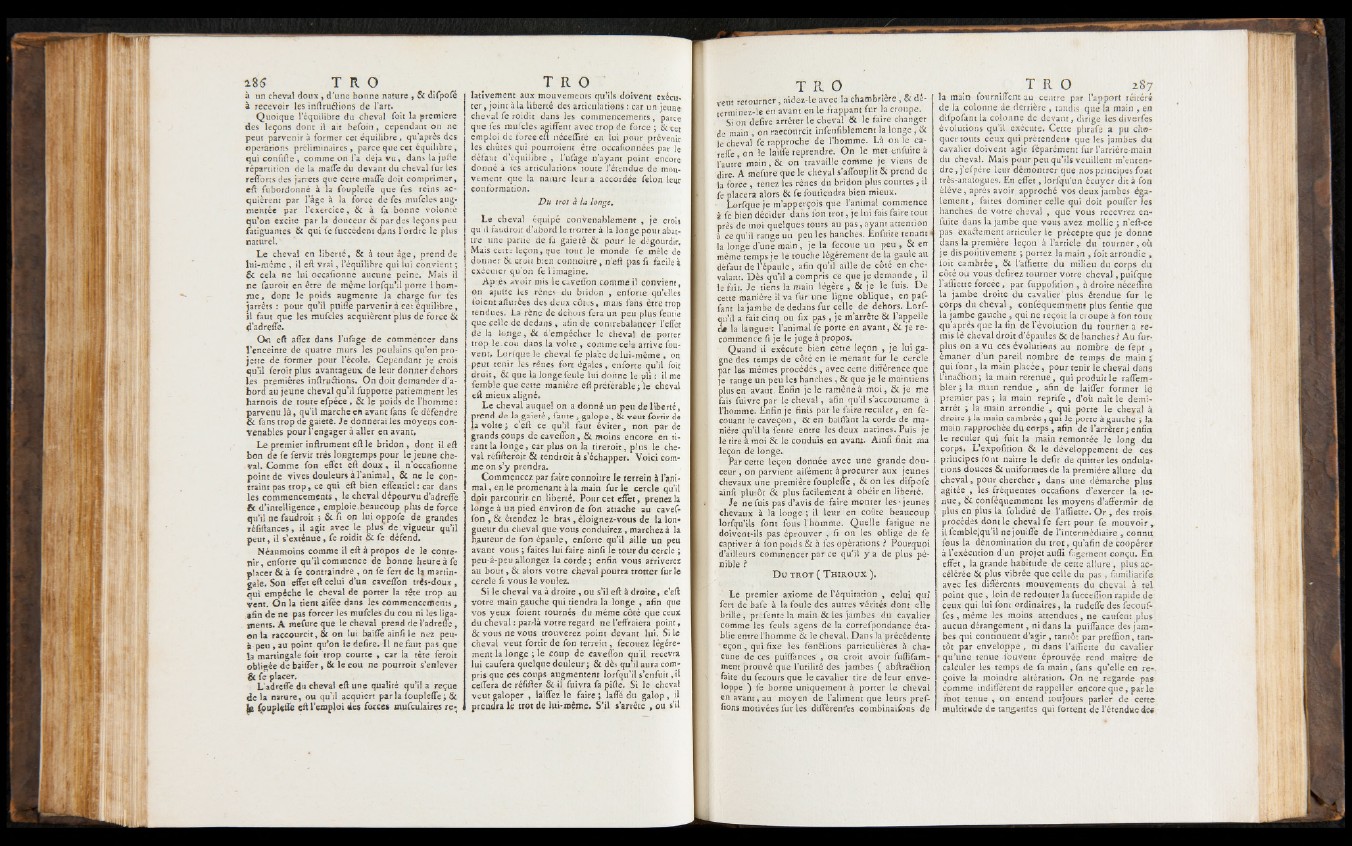
* 8 6 T R O
à un cheval doux , d’une bonne nature , & difpofé
à recevoir les inftruflions de l’art.
Quoique l’équilibre du cheval foit la première
des leçons dont il ait befoin, cependant on ne
peut parvenir à former cet équilibre, quaprès des
opérations préliminaires , parce que cet équilibre,
qui confifte , comme on l’a déjà v u , dans la jufte
répartition de la maffe du devant du cheval fur les
refforts des jarrets que cette maffe doit comprimer,
eft fubordonné à la foupleffe que fes reins acquièrent
par l’âge à la foree de fes mufcles augmentée
par l’exercice, & à & bonne volonté
qu’on excite par la douceur 8c par des leçons peu
fatiguantes & qui fe fuccèdent dans l'ordre le plus
naturel. '
Le cheval en liberté, & à tout âge, prend de
lui-même , il eft v ra i, l’équilibre qui lui convient ;
8c cela ne lui occasionne aucune peine. Mais il
ne fauroit en être de même lorfqu’il porte 1 homme,
dopr le poids augmente la charge fur fes
jarrêts : pour qu’il puiile parvenir à cet équilibre,
il faut que les mufcles acquièrent plus de force 8c
d’adrçffe.
Oo eft affez dans l’ufage de commencer dans
l ’enceinte de quatre murs les poulains qu’on projette
de former pour l’école. Cependant je crois
qu’il ferait plus avantageux de leur donner dehors
les premières inftruêHons. On doit demander d’abord
au jeune cheval qu’il fupporte patiemment les
barnois de toute efpéce, & le poids de l’homme :
parvenu là , qu’il marche en avant fans fe défendre
& fans trop de gaieté. Je donnerai les moyens convenables
pour l’engager à aller en avant,
Le premier infiniment efi le bridon , donf il eft
bon de fe fervir très longtemps pour le jeune cheval.
Comme fou effet eft doux, il n’occafionne
point de vives douleurs à l’animal, & ne le contraint
pas trop, ce qui eft bien effentiel : car dans
les commencements , le cheyal dépourvu d’adreffe
& d’intelligence , emploie ^beaucoup plus de force
qu’il ne faudrait > 8c fi on lui oçpofe de grandes
réfiftançes, il agit avec le plus de . vigueur qu’il
peut, il s’exténue, fe raidit & fe défend.
Néanmoins comme il eft à propos de le contenir
, enfprte qu’il commence de bonne heure à fe
placer & à fe contraindre , on fe fert de la martingale.
Son effet eft celui d’ua caveffon très-doux ,
qui empêche le cheval de porter la tête trop au
vent. On la tient aifée dans les commencements ,
afin de ne pas forcer les mufcles du cou ni les ligaments.
A mefure que le cheval prend de l’adrefTe ,
on la raccourcit, & on lui baiffe ainfi le nez peu-
à peu , au point qu’on le defire^Il ne faut pas que
la martingale Toit trop courte , car la tête ferait
obligée de baiffer, & le cou ne pourrait s’enlever
Si fe placer,
L ’adrçffe du cheval eft une qualité qu’il a reçue
de la nature, ou qu’il acquiert parla foupleffe; 8c
jg (oupUiïe eft l’emploi des forces mufculaires re»
T R O
lativement aux mouvements qu’ils doivent exécuter,
joint à la liberté des articulations : car un jeune
cheval fe raidit dans les commencements, parce
que fes mufcles agiffent avec trop de force ; &tet
emploi de fore® eft néceffité en lui pour prévenir
les chûtes qui pourraient être occafionnées par le
défaut d’équilibre , l ’ufage n’ayant point encore
donné à fes articulations toute l’étendue de mouvement
que la naujre leur a accordée félon leur
conformation.
P u trot a la longe,
Le cheval équipé convenablement , je crois
qu'il faudrait d’abord le trotter à la longe pour abattre
une partie de fa gaieté & pouf le dégourdir.
Mais cettr leçon, que tout le monde fe mêle de
donner & croit bien connoître, neft pas fi facile à
exécuter qu'on fe 1 imagine.
Apr,ès avoir mis le caveffon comme il convient,
On ajufte les rênes du bridon , enforte qu’elles
foient afturées des deux cotes, mais fans être trop
tendues. La rêne de dehors fera un peu plus fentie
que celle de dedans , afin de contrebalancer l’effet
de la longe, & d’empêcher le cheval de porter
trop le.cou dans la voire , comme cela arrive fou-
vent, Lorfque le cheval fe place de lui-même , on
peut tenir les rênes fort égales, enforte qu’il foit
droit, & que la longe feule lui donne le pli : il me
femble que cette manière eft préférable ; le cheval
eft mieux aligné.
Le cheval auquel on a donné un peu de liberté,
prend de la gaieté, faute , galope, & veut fortir de
Javolte; c’eft ce qu’il faut éviter, non par de
grands coups de eaveffon, & moins encore en tirant
la longe, car plus on la tirerait, plus le cheval
rèfifterojr 8l tendroit à s’échapper. Voici comme
on s’y prendra.
Commencez par faire connoître le terrein à ranimai
, en le promenant à la main fur le cercle qu’il
d^it parcourir en liberté. Pour cet effet, prenez h
longe à un pied environ de fon attache au caveffon
, & étendez le bras, éloignez-vous de la longueur
du cheval que vous conduirez, marchez à la
hauteur de fon épaule, enforte qu’il aille un peu
avant vous ; faites lui faire ainfi Je tour du cercle ;
peu-à-peu allongez la cordwe ; enfin vous arriverez
au bout, & alors votre cheval pourra trotter furie
cercle fi vous le voulez.
Si le cheval va à droite, ou s’il eft à droite, c’eft
votre main gauche qui tiendra la longe , afin que
vos yeux foient tournés du même côté que ceux
du cheval : panlà votre regard ne l’effraiera point»
8c vous ne vous trouverez point devant lui. Si le
cheval veuf fortir de fon terrein , fecouez légèrement
la longe ; le coup de caveffon qu’il recevra
lui caufera quelque douleur; & dès qu’il aura compris
que çes coups augmentent lorfqu’il s’enfuit, il
ceffera de réfifter & il fuivra fa pifte. Si le cheval
veut galoper , laiffez le faire; laffé du galop, il
prendra le trot de lui-même. S’il s’arrête , ou s'il
T R O
veut retourner, aidez-le avec la chambrière, 8c dé- ■
terminez-le en avant en le frappant fur la erpupe. \
Si on defire arrêter le cheval & le faire changer
de main , on raccourcit infenfiblement la longe ; 8c
le cheval fe rapproche de l’homme. Là on le ca-
reffe, on le laiffe reprendre. On le met enfuite à
l’autre main, & on travaille comme je viens de
dire. A mefure que le chëval s affouplit 8c prend de
la force , tenez les rênes du bridon plus courtes, il
fe placera alors & fe foutiendra bien mieux.
Lorfque je m’apperçois que l’animal commence
à fe bien décider dans fon trot, je lui fais faire tout
près de moi quelques tours au pas, ayant attention
à ce qu’il range un peu les hanches. Énfuite tenant i
la longe d’une main, je la fecoue un peu , 8c en
même temps je lé touche légèrement de la gaule au
défaut de l’épaule, afin qu’il aille de coté en che-
valant. Dès qu’il a compris ce que je demande, il
le fait. Je tiens la main légère , & je le luis. De
cette manière il va fur une ligne oblique, en paf-
fant la jambe de dedans fur celle de dehors. Lorfqu’il
a fait cinq ou fix pas , je m’arrête & l’appelle
d# la langue*: l’animal fe porte en avant, & je recommence
fi je le juge à propos.
Quand il exécute bien cette leçon , je lui gagne
des temps de côté en le menant fur le cercle
par las mêmes procédés , avec cette différence que
je range un peu les hanches , 8c que je le maintiens
plus en avant. Enfin je le ramène à moi, & je me
fais fuivre par le cheval, afin qu’il s'accoutume à
l’homme. Enfin je finis par le faire reculer, en fe-
couant le caveçon , & en baiffant la corde de manière
qu’il la fente entre les deux narines. Puis je
le tire à moi & le conduis en avanj. Ainfi finit ma
leçon de longe.
Par cette leçon donnée avec une grande douceur
, on parvient aifément à procurer aux jeunes
chevaux une première foupleffe , 8c on les difpofe
ainfi plutôt 8c plus facilement à obéir en liberté.
Je ne fuis pas d’avis de faire monter les* jeunes
chevaux à la longe ; il leur en coûte beaucoup
lorfqu’ils font foiis I homme. Quelle fatigue ne
doivent-ils pas éprouver , fi on les oblige de fe
captiver à fon poids & à fes opérations ? Pourquoi
d’ailleurs commencer par ce qu’il y a de plus pénible
?
DU TROT ( THIROUX ).
Le premier axiome de l’équitation , celui qui
fert de bafe à la foule des autres vérités dont elle
brille, préfente la main 8c les jambes du cavalier
comme les feuls agens de la correfpondance établie
entre l’homme 8c le cheval. Dans la précédente
' eçon, qui fixe les fondions particulières à chacune
de ces puiflances', on croit avoir fiiffifam-
ment prouvé que futilité des jambes ( abftraélion
faite du fecours que le cavalier tire de leur enve-
loppe ) fe borne uniquement à porter le cheval
en avant, au moyen de l’aliment que leurs pref-
fions motivées fur les différentes combinaifoos de
T R O 287
la main fourniffent au centre par l’apport réitéré
de la colonne de derrière , tandis que la main , en
difpofant la colonne de devant, dirige les diverfes
évolutions qu’il exécute. Cette phrafe a pu choquer
touts ceux qui prétendent que les jambes du
cavalier doivent agir féparément fur l’arrière-main
du cheval. Mais pour peu qu’ils veuillent m’entendre
, j’efpère leur démontrer que nos principes fo«c
très-analogues. En effet, lorfqu’un écuyer dit à fon
élève, après avoir approché vos deux jambes également
, faites dominer celle qui doit pouffer ies
hanches de votre cheval , que vous recevrez en-
fuite dans la jambe que vous avez mollie ; n’eft-ce
pas èxaélement articuler le précepte que je donne
dans la première leçon à l’article du tourner, où
je dispontivement ; portez la main , foit arrondie ,
foit cambrée, & l'alfiette du milieu du corps du
côté où vous defirez tourner votre cheval, puifque
l'affiette forcée, par fuppofition , à droite néceflite
la jambe droite du cavalier plus étendue fur le
corps du cheval, conféquemment plus fentie que
la jambe gauche, qui ne reçoit la croupe à fon tour
qu’après que la fin de l’évolution du tourner a remis
lè cheval droit d’épaules 8c de hanches ? Au fur-
plus on a vu ces évolutions au nombre de fept ,
émaner d’un pareil nombre de temps de main %
qui font, la main placée, pour tenir le cheval dans
l’inaéHon; la main retenue, qui produit le raffem-
bler ; la main rendue , afin de laiffer former le
premier pas ; la main reprife , d’où naît le demi-
arrêt ; la main arrondie , qui porte le cheyal à
droite ; la main cambrée, qui le porte à gauche ; la
main rapprochée du corps , afin de l’arrêter ; enfin
.le reculer qui fuit la main remontée le long du
corps. L’expofition & le développement de ces
principes font naître le defir de quitter les ondulations
douces & uniformes de la première allure du
cheval, pour chercher, dans une démarche plus
agitée, les fréquentes occafions d’exercer la tenue
, & conféquemment les moyens d’affermir de
plus en plus la folidité de l’affiette. Or , des trois
procédés dont le cheval fe fert pour fe mouvoir,
; il femblejqu’il nejouiffe de l’intermédiaire , connu
fous la dénomination du trot, qu’afin de coopérer
à l’exécution d'un projet auffi fagsment conçu. Eu
effet, la grande habitude de cette allure, plus accélérée
& plus vibrée que celle du pas , familiarife
ayec les différents mouvements du cheval à tel
point que , loin de redouter la fucceffion rapide de
ceux qui lui font ordinaires, la rudeffe des fecoufi*
fe s , même les moins attendues , ne caufent plus
aucun dérangement, ni dans la puiffance des jambes
qui continuent d’agir, tantôt par preffion, tantôt
par enveloppe , ni dans l’affiette du cavalier
* qu’une tenue fouvent éprouvée rend maître de
calculer les temps de fa main, fans qu’elle en re-.
çoive la moindre altération. On ne regarde pas
comme indifférent de rappeller encore que, par le
mot tenue , on entend toujours parler de cette
multitude de tangentes qui fortent de l'étendue des