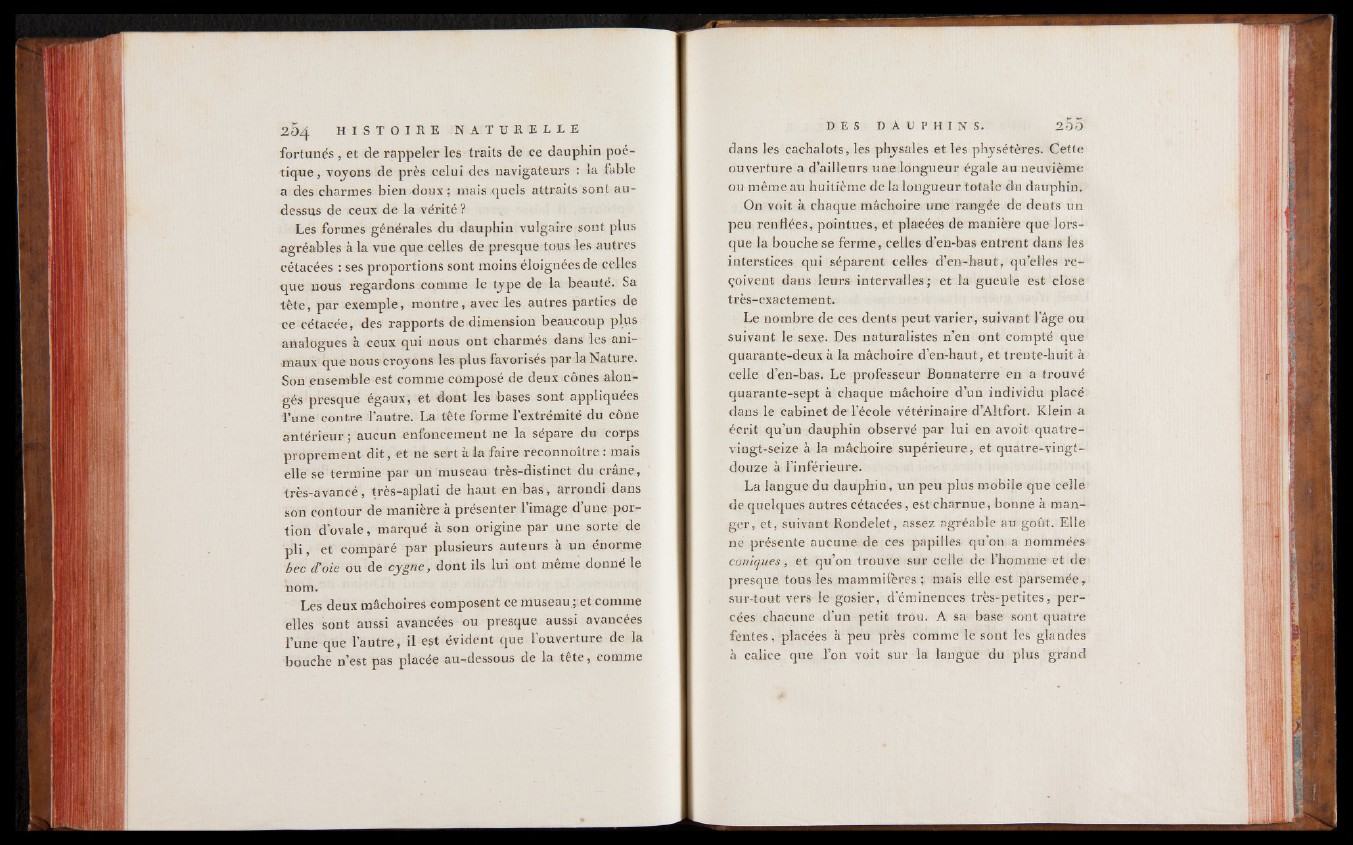
2Ô 4 H I S T O I R E N A T U R E L L E
fortunés , et de rappeler les traits de ce dauphin poétique
, voyons de près celui des navigateurs : la fable
a des charmes bien doux ; mais quels attraits sont au-
dessus de ceux de la vérité?
Les formes générales du dauphin vulgaire sont plus
agréables à la vue que celles de presque tous les autres
cétacées : ses proportions sont moins éloignées de celles
que nous regardons comme le type de la beauté. Sa
tête, par exemple, montre, avec les autres parties de
ce cétacée, des rapports de dimension beaucoup plus
analogues à ceux qui nous ont charmés dans les animaux
que nous crojons les plus favorisés par la Nature.
Son ensemble est comme composé de deux cônes alon-
gés presque égaux, et dont les bases sont appliquées
l’une contre l’autre. La tête forme l’extrémité du cône
antérieur ; aucun enfoncement ne la sépare du corps
proprement dit, et ne sert à la faire reconnoître : mais
elle se termine par un museau tres-distinct du crâne,
très-avancé, très-aplati de haut en bas, arrondi dans
son contour de manière à présenter l’image d’une portion
d’ovale, marqué à son origine par une sorte de
p li, et comparé par plusieurs auteurs a un énorme
bec ctoie ou de cygne, dont ils lui ont même donné le
nom.
Les deux mâchoires composent ce museau et comme
elles sont aussi avancées ou presque aussi avancées
l’une que l’autre, il est évident que l’ouverture de la
bouche n’est pas placée au-dessous de la tete, comme
dans les cachalots, les phjsales et les physétères. Cette
ouverture a d’ailleurs une longueur égale au neuvième
ou même au huitième de la longueur totale du dauphin.
On voit à chaque mâchoire une rangée de dents .un
peu renflées, pointues, et placées de manière que lorsque
la bouche se ferme, celles d’en-bas entrent dans les
interstices qui séparent celles d’en-haut, quelles reçoivent
dans leurs intervalles; et la gueule est close
très-exactement.
Le nombre de ces dents peut varier, suivant l’âge ou
suivant le sexe. Des naturalistes n’en ont compté que
quarante-deux à la mâchoire d’en-haut, et trente-huit à
celle d’en-bas. Le professeur Bonnaterre en a trouvé
quarante-sept à chaque mâchoire d’un individu placé
dans le cabinet de l’école vétérinaire d’Altfort. Klein a
écrit qu’un dauphin observé par lui en avoit quatre-
vingt-seize à la mâchoire supérieure, et quatre-vingt-
douze à l’inférieure.
La langue du dauphin, un peu plus mobile que celle
de quelques autres cétacées, est charnue, bonne à manger,
et, suivant Rondelet, assez agréable au goût. Elle
ne présente aucune de ces papilles qu’on a nommées
coniques, et qu’on trouve sur celle de l’homme et de
presque tous les mammifères ; mais elle est parsemée,
sur-tout vers le gosier, d’éminences très-petites, percées
chacune d’un petit trou. A sa base sont quatre
fentes, placées à peu près comme le sont les glandes
à calice que l’on voit sur la langue du plus grand