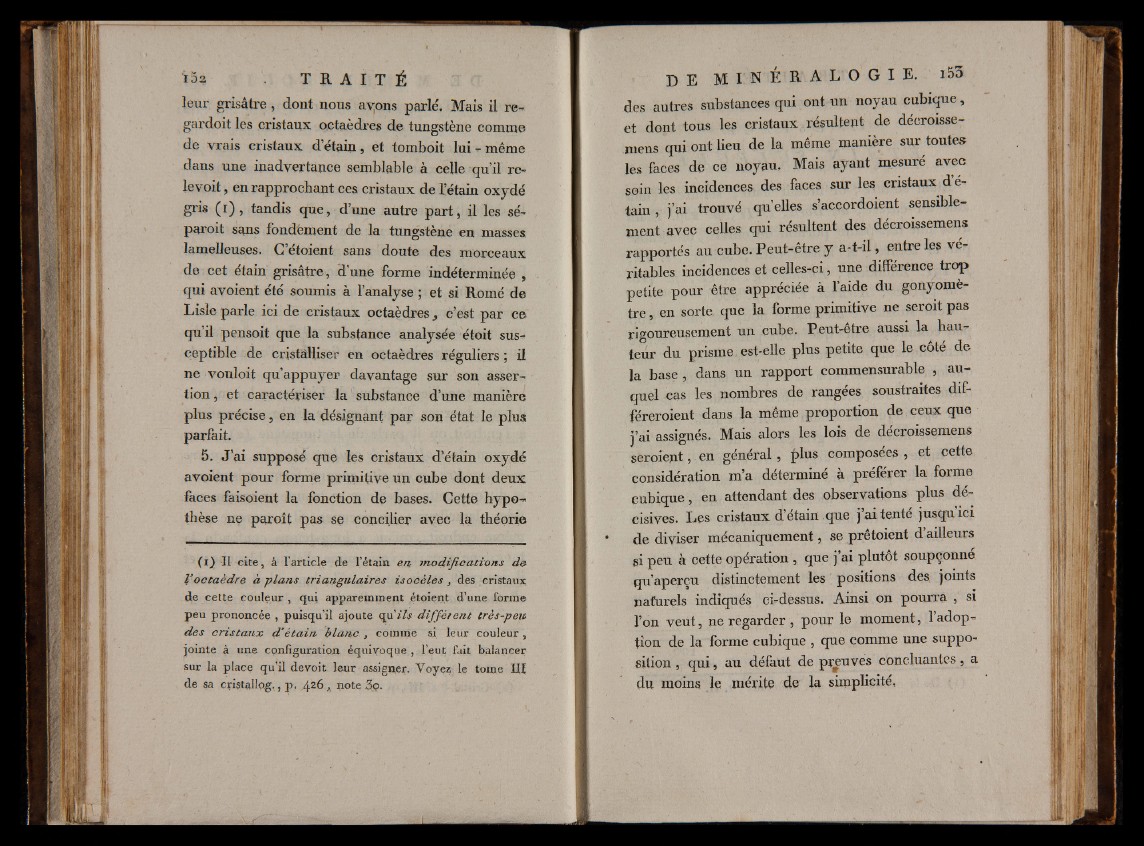
leur grisâtre, dont nous ayons parle'. Mais il re-
gardoit les cristaux octaèdres de tungstène comme
de vrais cristaux d’étain, et tomboit lui - même
dans une inadvertance semblable à celle qu’il re-
levoit, en rapprochant ces cristaux de l’étain oxydé
gris ( i ) , tandis que, d’une autre part, il les sé-
paroit sans fondèment de la tungstène en masses
lamelleuses. C’étoient sans doute des morceaux
de cet étain grisâtre, d’une forme indéterminée ,
qui avoient été soumis à l’analyse ; et si Romé de
Lisle parle ici de cristaux octaèdres, c’est par ce
qu’il pensoit que la substance analysée était susceptible
de cristalliser en octaèdres réguliers ; il
ne vouloit qu’appuyer davantage sur son assertion
, et caractériser la substance d’une manière
plus précise, en la désignant par son état le plus
pariait.
5. J’ai supposé que les cristaux d’étain oxydé
avoient pour forme primitive un cube dont deux
faces faisaient la fonction de bases. Cette hypothèse
ne paroît pas se concilier avec la théorie
(1 } II cite , à l'article de l’étain en modifications de
Voctaèdre à plans triangulaires isocèles , des cristaux
de cette couleur , qui apparemment étoient d’une forme
peu prononcée , puisqu’il ajoute qu’ils diffèrent très-peu
des cristaux d’étain blanc , comme si leur couleur,
jointe à une configuration équivoque , l’eut fait balancer
sur la place qu’il devoit leur assigner. Voyez le tome III
de sa cristallag., p. 426 A note 3o.
des autres substances qui ont un noyau cubique,
et dont tous les cristaux résultent de décroisse-
mens qui ont lieu de la même manière sur toutes
les faces de ce noyau. Mais ayant mesuré avec
soin les incidences des faces sur les cristaux détain
, j’ai trouvé qu elles s’accordoient sensiblement
avec celles qui résultent des décroissemens
rapportés au cube. Peut-être y a-t-il, entre les véritables
incidences et celles-ci, une différence trop
petite pour être appréciée à l’aide du gonyomè-
tre, en sorte, que la forme primitive ne seroit pas
rigoureusement un cube. Peut-être aussi la hauteur
du prisme est-elle plus petite que le côté de
la base , dans un rapport commensurable , auquel
cas les nombres de rangées soustraites dif-
féreroient dans la même proportion de ceux que
j’ai assignés. Mais alors les lois de decroissemens
seroient, en général , plus composées, et cette
considération m’a déterminé à préférer la forme
cubique, en attendant des observations plus décisives.
Les cristaux d etain que j .ai tente jusquici
de diviser mécaniquement, se prêtoient d’ailleurs
gi peu à cette opération , que j’ai plutôt soupçonne
qu’aperçu distinctement les positions des joints
naturels indiqués ci-dessus. Ainsi on pourra , si
l’on veut, ne regarder, pour le moment, l’adoption
de la forme cubique , que comme une supposition
, qui, au défaut de preuves concluantes, a
du moins le mérite de la simplicité,