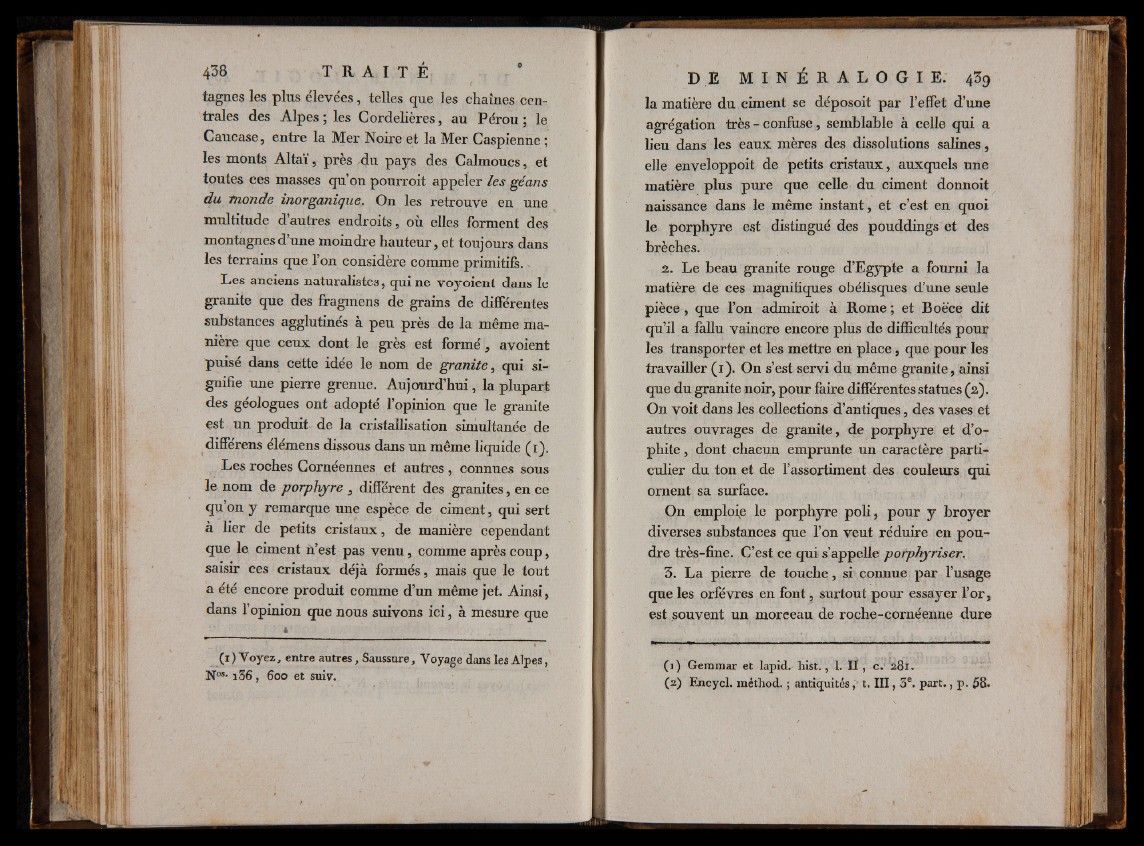
tagnes les plus élevées, telles que les chaînes centrales
des Alpes; les Cordelières, au Pérou; le
Caucase, entre la Mer Noire et la Mer Caspienne ;
les monts Altaï, près du pays des Calmoucs, et
toutes ces masses qu’on pourroit appeler les ge'ans
du tnonde inorganique. On les retrouve en une
multitude d autres endroits, où elles forment des
montagnes d’une moindre hauteur, et toujours dans
les terrains que l’on considère comme primitifs..
Les anciens naturalistes, qui ne voyoient dans le
granité que des fragmens de grains de différentes
substances agglutinés à peu près de la même manière
que ceux dont le grès est formé, avoient
puise dans cette idée le nom de granité, qui signifie
une pierre grenue. Aujourd’hui, la plupart
des géologues ont adopté l’opinion que le granité
est un produit de la cristallisation simultanée de
differens élémens dissous dans un même liquide (i}.
Les roches Cornéennes et autres , connues sous
le nom de porphyre , différent des granités, en ce
qu’on y remarque une espèce de ciment, qui sert
à lier de petits cristaux, de manière cependant
que le ciment n’est pas venu, comme après coup,
saisir ces cristaux déjà formés, mais que le tout
a été encore produit comme d’un même jet. Ainsi,
dans l’opinion que nous suivons ici, à mesure que
( i) V oyez , entre autres, Saussure, Voyage dans les Alpes,
N os- 136, 600 et suiy.
la matière du ciment se déposoit par l’effet d’une
agrégation très - confuse, semblable à celle qui a
lieu dans les eaux mères des dissolutions salines,
elle enveloppoit de petits cristaux, auxquels une
matière plus pure que celle du ciment donnoit
naissance dans le même instant, et c’est en quoi
le porphyre est distingué des pouddings et des
brèches.
2. Le beau granité rouge d’Egypte a fourni la
matière de ces magnifiques obélisques d’une seule
pièce, que l’on admiroit à Rome; et Boè'ce dit
qu’il a fallu vaincre encore plus de difficultés pour
les transporter et les mettre en place, que pour les
travailler (1). On s’est servi du même granité, ainsi
que du granité noir, pour faire différentes statues (2).
On voit dans les collections d’antiques, des vases et
autres ouvrages de granité, de porphyre et d’o-
phite, dont chacun emprunte un caractère particulier
du ton et de l’assortiment des couleurs qui
ornent sa surface.
On emploie le porphyre poli, pour y broyer
diverses substances que l’on veut réduire en poudre
très-fine. C’est ce qui s’appelle porphyriser.
3. La pierre de touche, si connue par l’usage
que les orfèvres en font, surtout pour essayer l’or,
est souvent un moreeau de roche-cornéenne dure
(1) Gemmar et lapida hist., 1. I l , c. 28r.
(2) Encycl. méthod. ; an tiqu ités t. I I I , 3e. part., p. 58.