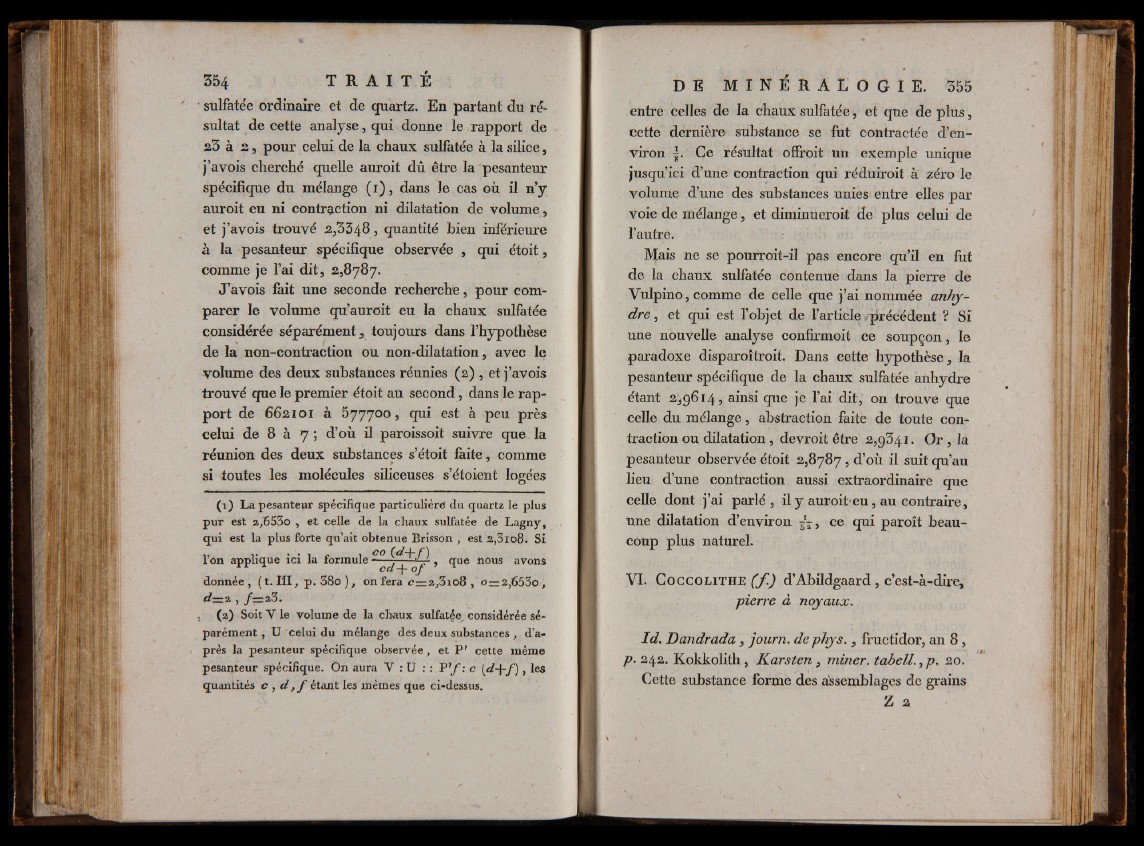
sulfatée ordinaire et de quartz. En partant du résultat
de cette analyse, qui donne le rapport de
23 à 2, pour celui de la chaux sulfatée à la silice,
j’avois cherché quelle auroit dû être la pesanteur
spécifique du mélange (i), dans le cas où il n’y
auroit eu ni contraction ni dilatation de volume,
et j’avois trouvé 2,3348, quantité bien inférieure
à la pesanteur spécifique observée , qui étoit,
comme je l’ai dit, 2,8787.
J’avois fait une seconde recherche, pour comparer
le volume qu’auroit eu la chaux sulfatée
considérée séparément, toujours dans l’hypothèse
de la non-contraction ou non-dilatation, avec le
volume des deux substances réunies (2) , et j’avois
trouvé que le premier étoit au second, dans le rapport
de 662101 à 577700, qui est à peu près
celui de 8 à 7 ; d’où il paroissoit suivre que la
réunion des deux substances s’étoit faite, comme
si toutes les molécules siliceuses s’étoient logées
(1) La pesanteur spécifique particulière du quartz le plus
pur est 2,653o , et celle de la chaux sulfatée de Lagny,
qui est la plus forte qu’ait obtenue Brisson , est 2,3 108. Si
l ’on applique ici la formule , que nous avons
ca-\-oj
donnée , ( t. I I I , p. 38o ) , on fera c= 2 ,3 io 8 , o—2,653o ,
d—7. , f — 23.
, (2) Soit Y le volume de la chaux sulfatée, considérée séparément,
U celui du mélange des deux substances , d’après
la pesanteur spécifique observée, et P' cette même
pesanteur spécifique. On aura V : U : : P yf : c , les
quantités c , d , f étant les mêmes que ci-dessus.
entre celles de la chaux sulfatée, et que de plus,
cette dernière substance se fut contractée d’environ
|. Ce résultat offroit un exemple unique
jusqu’ici d’une contraction qui réduiroit à zéro le
volume d’une des substances unies entre elles par
voie de mélange, et diminueroit de plus celui de
l’autre.
Mais ne se pourroit-il pas encore qu’il en fut
de la chaux sulfatée contenue dans la pierre de
Vulpino, comme de celle que j’ai nommée anhydre
, et qui est l’objet de l’article ^précédent ? Si
une nouvelle analyse confîrmoit ce soupçon, le
paradoxe disparoîtroit. Dans cette hypothèse, la
pesanteur spécifique de la chaux sulfatée anhydre
étant 2,9614, ainsi que je l’ai dit, on trouve que
celle du mélange, abstraction faite de toute contraction
ou dilatation , devroit être 2,9341. Or , la
pesanteur observée étoit 2,8787, d’où il suit qu’au
lieu d’une contraction aussi extraordinaire que
celle dont j’ai parlé, il y auroit-eu, au contraire,
une dilatation d’environ gj, ce qui paroît beaucoup
plus naturel.
VI. C o c c o l i t h e (f.) d ’A b i l d g a a r d , c ’e s t - à - d i r e ,
pierre à noyaux.
Id. Dandrada, journ. de phys. , fructidor, an 8,
p. 242. Kokkolith, Karsten, miner, tabell. , p. 20.
Cette substance forme des assemblages de grains
Z 2