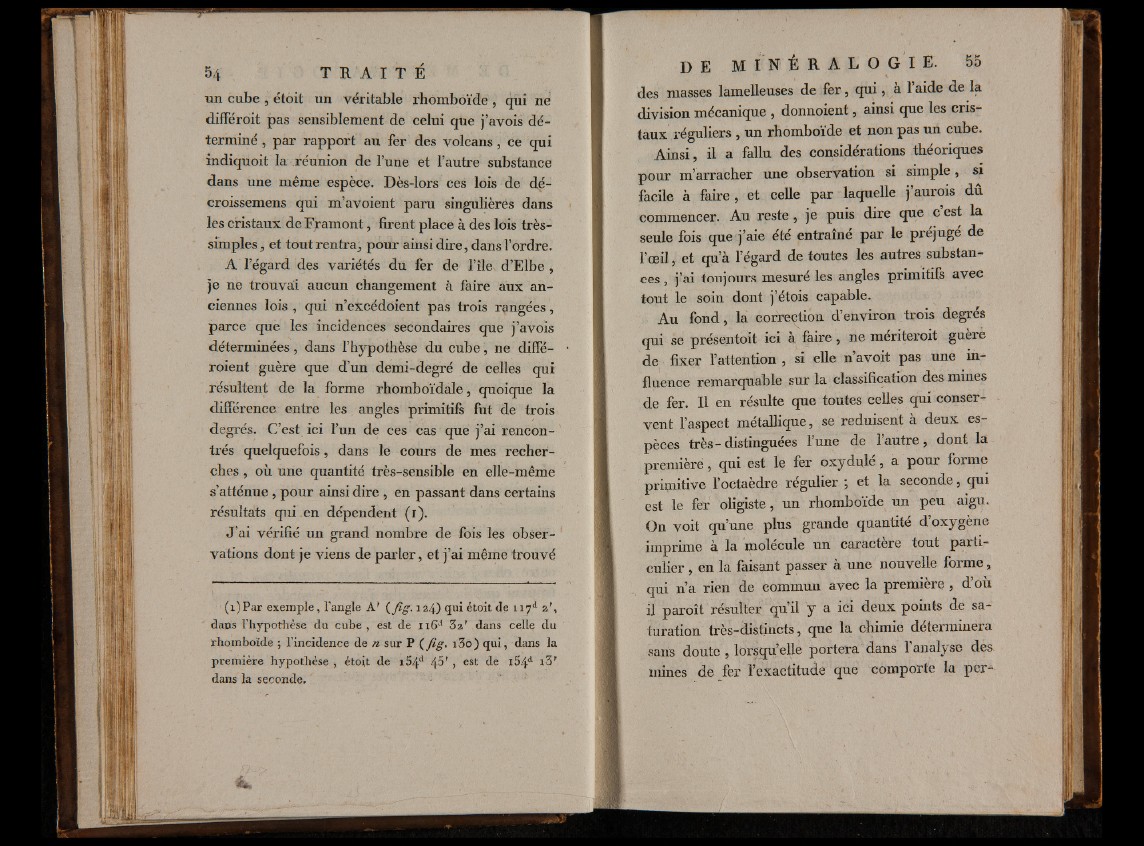
un cube , étoit un véritable rhomboïde , qui né
différoit pas sensiblement de celui que j’avois déterminé
, par rapport au fer des volcans, ce qui
indiquoit la réunion de l’une et l’autre substance
dans une même espèce. Dès-lors ces lois de dé-
croissemens qui m’avoient paru singulières dans
les cristaux de Framont, firent place à des lois très-
simples, et tout rentra, pour ainsi dire, dans l’ordre.
A l’égard des variétés du fer de l’île d’Elbe,
je ne trouvai aucun changement à faire aux anciennes
lois , qui n’eXcédoient pas trois rangées ,
parce que les incidences secondaires que j’avois
déterminées, dans l’hypothèse du cube, ne diffé-
roient guère que d’un demi-degré de celles qui
résultent de la forme rhomboïdale, quoique la
différence entre les angles primitifs fut de trois
degrés. C’est ici l’un de ces cas que j’ai rencontrés
quelquefois, dans le cours de mes recherches
, où une quantité très-sensible en elle-même
s’atténue, pour ainsi dire , en passant dans certains
résultats qui. en dépendent (i).
J’ai vérifié un grand nombre de fois les observations
dont je viens de parler, et j’ai même trouvé
(x)Par exemple, l’angle A ' (fîg. 124) qui étoit de H 7d 2f,
dans l’hypothèse du cube, est de 1 161 3 a' dans celle du
rhomboïde ; l ’incidence de n sur P Ç/lg. i 3o) qui, dans la
première hypothèse , étoit de i 54d 4^’ > est de l 54d
dans la seconde.
des masses lamelleuses de fer, qui, à l’aide de la
division mécanique , donnoient, ainsi que tes cristaux
réguliers , un rhomboïde et non pas un cube.
Ainsi, il a fallu des considérations théoriques
pour m’arracher une observation si simple, si
facile à faire, et celle par laquelle j’aurois dû
commencer. Au reste , je puis dire que c est la
seule fois que j’aie été entraîné par le préjugé de
l’oeil, et qu’à l’égard de toutes les autres substances
, j’ai toujours mesuré les angles primitifs avec
tout le soin dont j’étois capable.
Au fond, la correction d’environ trois degrés
qui se présentoit ici à faire, ne mériteroit guère
de fixer l’attention , si elle n’avoit pas une influence
remarquable sur la classification des mines
de fer. Il en résulte que toutes celles qui conservent
l’aspect métallique, se réduisent à deux espèces
très - distinguées l’une de l’autre, dont la
première, qui est le fer oxydule, a pour forme
pripiitive l’octaèdre régulier \ et la seconde, qui
est le fer oligiste, un rhomboïde un peu aigu.
On voit qu’une plus grande quantité d’oxygène
imprime à la molécule un caractère tout particulier
, en la faisant passer à une nouvelle forme,
qui n’a rien de commun avec la première, d ou
il paroît résulter qu’il y a ici deux points de saturation
très-distincts, que la. chimie déterminera
sans doute , lorsqu’elle portera dans 1 analy se des
mines de fer l’exactitude que comporte la père