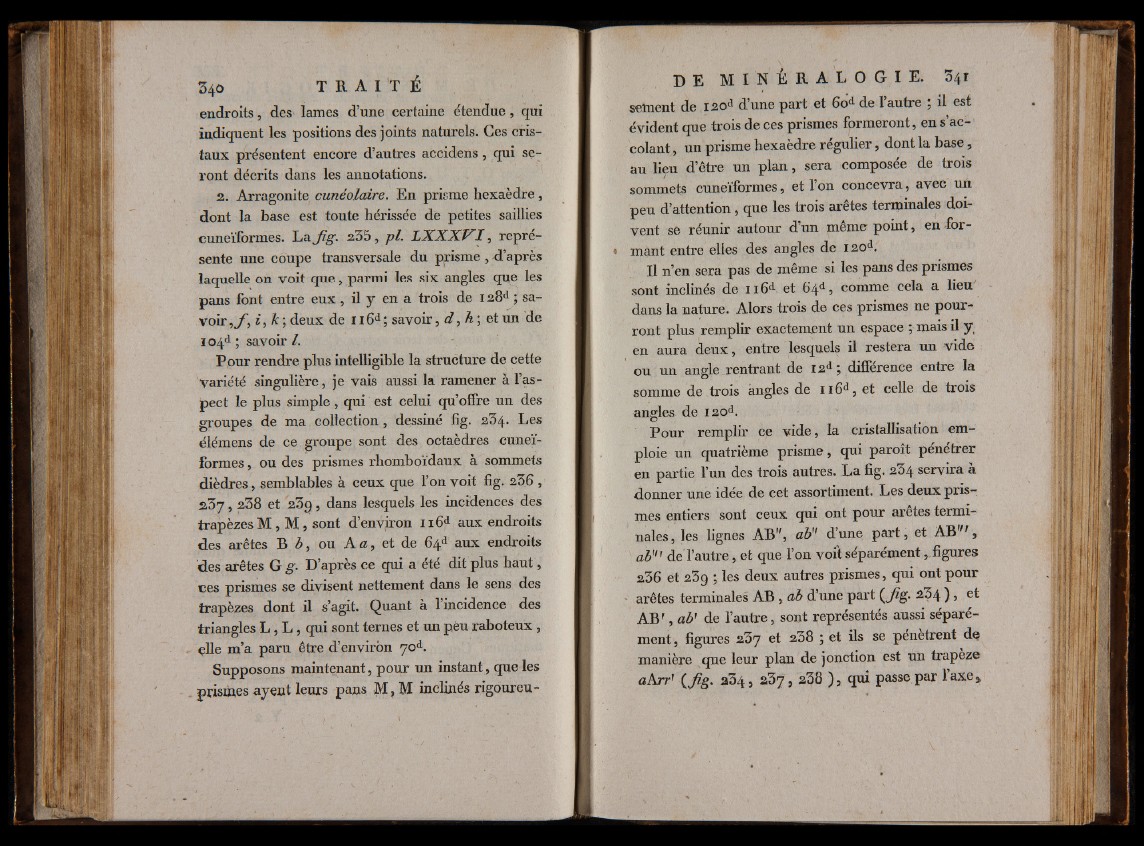
endroits, des lames d’une certaine étendue, qui
indiquent les positions des joints naturels. Ces cristaux
présentent encore d’autres accidens, qui seront
décrits dans les annotations.
2. Arragonite cunéolaire. En prisme hexaèdre,
dont la base est toute hérissée de petites saillies
cunéiformes. La fig- 235, pl. h X X X V l , représente
une coupe transversale du prisme , d’après
laquelle on voit que, parmi les six angles que les
pans font entre eux, il y en a trois de 128d ; savoir
,7 ", i, k ; deux de I i 6 d ; savoir, d, h; et un de
I04d ; savoir /.
Pour rendre plus intelligible la structure de cette
variété singulière, je vais aussi la ramener à l’aspect
le plus simple, qui est celui qu’offre un des
groupes de ma collection, dessiné fig. 234. Les
élémens de ce groupe sont des octaèdres cunéiformes
, ou des prismes rhombpïdaux à sommets
dièdres, semblables à ceux que l’on voit fig. 236 ,
s 3y , 238 et 23g, dans lesquels les incidences des
trapèzes M, M, sont d’environ n 6 d aux endroits
des arêtes B b, ou A a, et de 64d aux endroits
des arêtes G g. D’après ce qui a été dit plus haut,
ces prismes se divisent nettement dans le sens des
trapèzes dont il s’agit. Quant a 1 incidence des
triangles L , L , qui sont ternes et un peu raboteux,
plie m’a paru être d’environ 70d.
Supposons maintenant, pour un instant, que les
prismes ayent leurs pans M, M inclinés rigoureusetnent
de I 2 0 d dune part et 6od de 1 autre , il est
évident que trois de ces prismes formeront, en s’accolant
, un prisme hexaèdre régulier, dont la base,
au lieu d’être un plan, sera composée de trois
sommets cunéiformes, et l’on concevra, avec un
peu d’attention, que les trois arêtes terminales doivent
sê réunir autour d’un même point, en for-
* mànt entre elles des angles de I 2 0 d .
Il n’en sera pas de même si les pans des prismes
sont inclinés de n 6 d. et 64^5 comme cela a lieu
dans la nature. Alors trois de ces prismes ne pourront
plus remplir exactement un espace ; mais il y,
en aura deux, entre lesquels il restera un vide
ou un angle rentrant de I 2 d ; différence entre la
somme de trois angles de 116d, et celle de trois
angles de I20d.
Pour remplir ce vide, la cristallisation emploie
un quatrième prisme, qui paroît penetrer
en partie l’un des trois autres. La fig. 234 servira à
■donner une idée de cet assortiment. Les deux prismes
entiers sont ceux qui ont pour aretes terminales,
les lignes AB^, ab" d’une part, et AB,,r,
ab'n de l’autre, et que l’on voit séparément, figures
236 et 23g ; les deux autres prismes, qui ont pour
- arêtes terminales A B , ab d’une part {fig- ^34 ) ■>
ABr, ab' de l’autre, sont représentés aussi séparément
, figures 237 et 238 ; et ils se pénètrent de
manière que leur plan de jonction est un trapeze
aArd {fig. 234, 23y , 238 ) , qui passe par laxe*