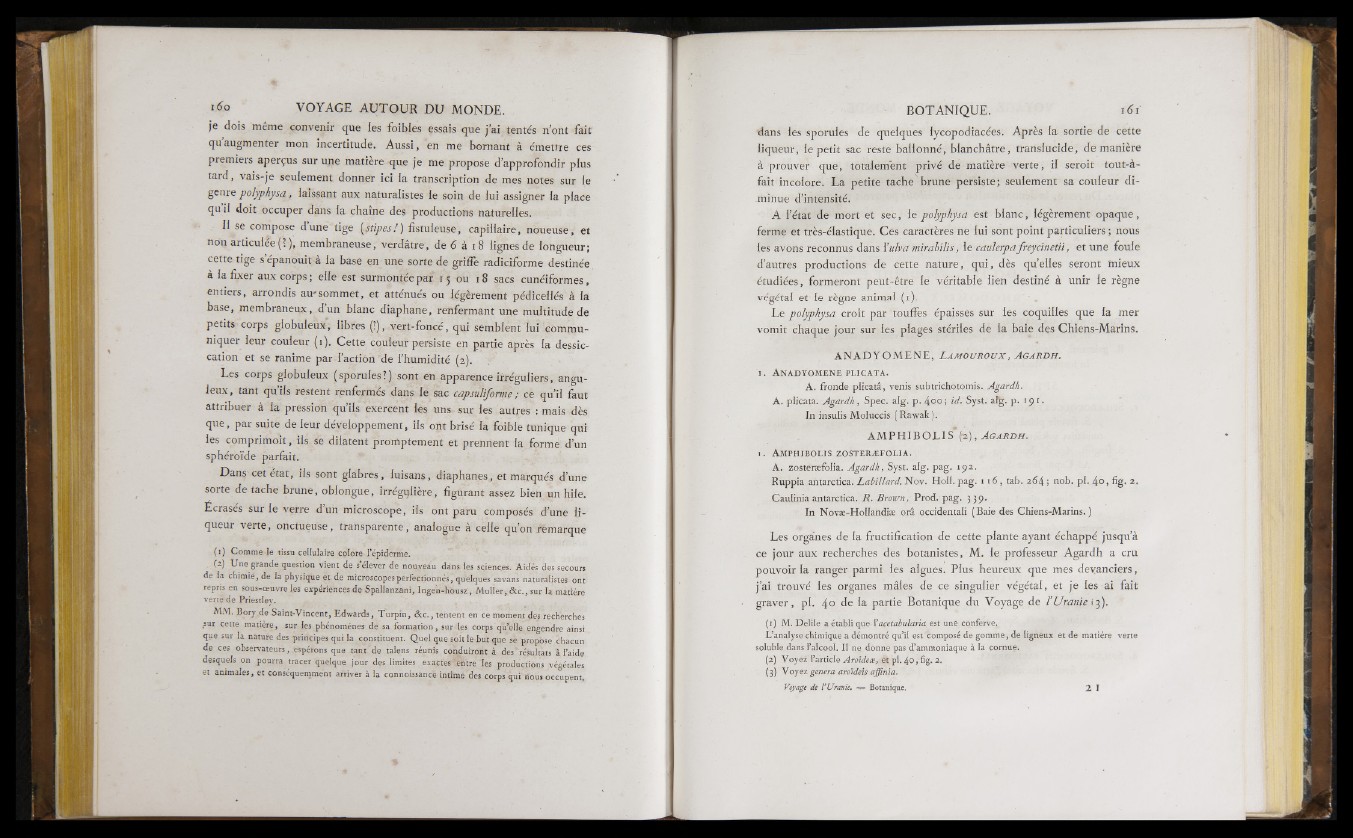
je dois même convenir que les foibles essais que j’ai tentés n’ont fait
qu’augmenter mon incertitude. Au s si, en me bornant à émettre ces
premiers aperçus sur une matière que je me propose d’approfondir plus
tard, vais-je seulement donner ici la transcription de mes notes sur le
gtnie polyphysa, laissant aux naturalistes le soin de lui assigner la place
q u il doit occuper dans la chaîne des productions naturelles.
Il se compose d’une tige [stipes!) fistuleuse, capillaire, noueuse, et
non articulée ( î) , membraneuse, verdâtre, de 6 à i 8 lignes de longueur;
cette tige s épanouit à ia base en une sorte de griffe radiciforme destinée
à la fixer aux corps ; elle est surmontée par i 5 ou 18 sacs cunéiformes,
entiers, arrondis a ir sommet, et atténués ou légèrement pédîcellés à la
base, membraneux, d’un blanc diaphane, renfermant une multitude de
petits corps globuleux, libres (î), vert-foncé, qui semblent lui communiquer
leur couleur (i). Cette couleur persiste en partie après la dessiccation
et se ranime par l’action de l’humidité (2).
Les corps globuleux (sporules!) sont en apparence irréguliers, anguleu
x , tant qu’ils restent renfermés dans le sac capsuliforme ; ce qu’il faut
attribuer à la pression qu’ils exercent les uns sur les autres ; mais dès
que, par suite de leur développement, ils ont brisé la foible tunique qui
les comprimoit, ils se dilatent promptement et prennent la forme d’un
sphéroïde parfait.
Dans cet état, ils sont glabres, luisans, diaphanes, et marqués d’une
sorte de tache brune, oblongue, irrégulière, figurant assez bien un bile.
Écrasés sur le verre dun microscope, ils ont paru composés d’une liqueur
verte, onctueuse, transparente, analogue à celle qu’on remarque
(1) Comme le tissu cellulaire colore l’épiderme.
(2) Une grande question vient de s’élever de nouveau dans les sciences. Aidés des secours
de ia chimie, de la physique et de microscopes perfectionnés, quelques savans naturalistes ont
repris en sous-oeuvre les expériences de Spallanzani, Ingen-housz, iVluIler, & c ., sur la matière
verte de Priestley.
M.M. Bory de Saint-Vincent, Edwards, Turpin, & c ., tentent en ce moment des recherches
sur cette matière, sur les phénomènes de sa formation, sur les corps qu’elle engendre ainsi
que sur la nature des principes qui la constituent. Quel que soit le but que se propose chacun
de ces obsereateurs, espérons que tant de talens réunis conduiront à des résultats à l’aide
desquels on pourra tracer quelque jour des limites exactes entre les productions végétales
et animales, et conséquemment arriver à la connoissance intime des corps qui nous occupent.
dans les sporules de quelques lycopodiacées. Après la sortie de cette
liqueur, le petit sac reste ballonné, blanchâtre, translucide, de manière
à prouver que, totalement privé de matière ve rte, il seroit tout-à-
fait incolore. La petite tache brune persiste; seulement sa couleur diminue
d’intensité.
A l’état de mort et sec, le polyphysa est blanc, légèrement opaque,
ferme et très-élastique. Ces caractères ne lui sont point particuliers ; nous
les avons reconnus dans Xuha mirahilis, le caulerpa freycinetii, et une foule
d’autres productions de cette nature, q u i, dès qu’elles seront mieux
étudiées, formeront peut-être le véritable lien destiné à unir le règne
végétal et le règne animal (i).
Le polyphysa croît par touffes épaisses sur les coquilles que la mer
vomit chaque jour sur les plages stériles de la baie des Chiens-Marins.
A N A D Y O M E N E , L am o u r o u x , A g a rd h .
I. An ADYOMENE PLICATA.
A . fronde plicatâ, venís subtrichotomis. Agardh.
A . plicata. Agardh, Spec. a lg. p. 4 o o ; id. Syst. aig. p. 191 .
Jn insulis Moiuc cis (R aw a k ) .
A M P H I B O L I S [2), A g a r d h .
1 . A mphi b ol i s z o s t e ræf o l ia .
A . zosteræfolia. Agardh, Syst. alg. p a g . 192 .
Ru pp ia antárctica. Labillard. N o v . HoII. p a g . 1 1 6 , tab. 2Ó4 ; nob . p l. 4 ° , % • 2.
Cau lin ia antárctica. R . Brown, Prod. pa g . 339.
In Novæ-Hollandiæ orâ occidental! (Baie des Ch ien s-Ma rins.)
Les organes de la fructification de cette plante ayant échappé jusqu’à
ce jour aux recherches des botanistes, M. le professeur Agardh a cru
pouvoir la ranger parmi les algues. Plus heureux que mes devanciers,
j’ai trouvé les organes mâles de ce singulier végétal, et je les ai fait
graver, pl. 4° ûe la partie Botanique du Voyage de l'Uranie i^).
(1) M. Delile a établi que Vacetabular'm est une conferve.
L’analyse chimique a démontré qu’il est composé de gomme, de ligneux et de matière verte
soluble dans falcool. II ne donne pas d’ammoniaque à la cornue.
(2) Voyez i’article Aroideoe, et pl. 4o , % . 2.
(3) Voyez genera ardideis affinia.
Voyage de l’Uranie, — Botanique. 2 I
i