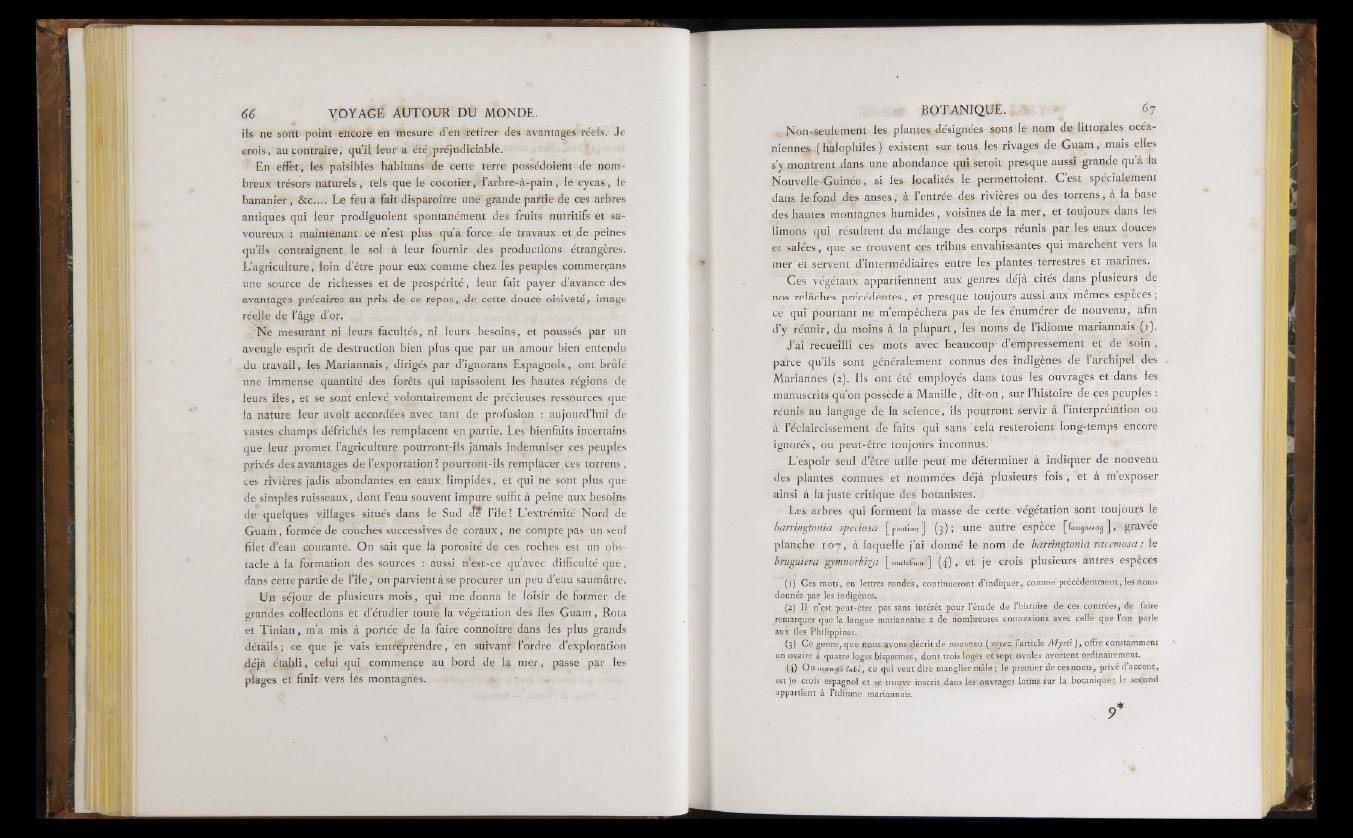
ils ne sont point encore en mesure d’en retirer des avantages réels. Je
crois, au contraire, c]u’il leur a été préjudiciable.
En effet, les paisibles habitans de cette terre possédoient de nombreux
trésors naturels, tels que ie cocotier, l’a rbre-à-pain, le cycas, le
bananier, & c .... Ee feu a fait disparoître une grande partie de ces arbres
antiques qui leur prodiguoient spontanément des fruits nutritifs et savoureux
: maintenant ce n’est plus qu’à force de travaux et de peines
qu’ils contraignent le sol à leur fournir des productions étrangères.
L ’agriculture, loin d’être pour eux comme chez les peuples commerçans
une source de richesses et de prospérité, leur fait payer d’avance des
avantages précaires au prix de ce repos, de cette douce oisiveté, image
réelle de l’âge d’or.
Ne mesurant ni leurs facultés, ni leurs besoins, et poussés par un
aveugle esprit de destruction bien plus que par un amour bien entendu
du trav ail, les Mariannais, dirigés par d’ignorans Espagnols , ont brûlé
une immense quantité des forêts qui tapissoient les hautes régions de
leurs île s , et se sont enlevé volontairement de précieuses ressources que
ia nature leur avoit accordées avec tant de profusion : aujourd’hui de
vastes champs défrichés les remplacent en partie. Les bienfaits incertains
que leur promet l’agriculture pourront-ils jamais indemniser ces peuples
privés des avantages de l’exportation! pourront-ils remplacer ces torrens ,
ces rivières jadis abondantes en eaux limpides, et qui ne sont plus que
de simples ruisseaux, dont l’eau souvent impure suffit à peine aux besoins
de quelques villages situés dans le Sud et* l’île ! L ’extrémité Nord de
Guam , formée de couches successives de coraux, ne compte pas un seul
filet d’eau courante. On sait que ia porosité de ces roches est un obstacle
à ia formation des sources : aussi n’est-ce qu’avec difficulté q u e ,
dans cette partie de l’î le , on parvientàse procurer un peu d’eau saumâtre.
Un séjour de plusieurs mois, qui me donna le loisir de former de
grandes collections et d’étiidier toute la végétation des îles Guam , Rota
et T in ia n , m’a mis à portée de la faire connoître dans les plus grands
détails ; ce que je vais entreprendre, en suivant l’ordre d’exploration
déjà é ta b li, celui qui commence au bord de ia m e r , passe par les
plages et finit vers les montagnes.
Non-seulement les plantes désignées sous le nom de littorales océaniennes
( halophiles ) existent sur tous les rivages de Guam , mais elles
s’y montrent dans une abondance qui seroit presque aussi grande qu’à la
Nouvelle-Guinée, si les localités le permettoient. C ’est spécialement
dans le fond des anses, à l’entrée des rivières ou des torrens, à la base
des hautes montagnes humides, voisines de la mer, et toujours dans les
limons qui résultent du mélange des corps reunis par les eaux douces
et salées, que se trouvent ces tribus envahissantes qui marchent vers la
mer et servent d’intermédiaires entre les plantes terrestres et marines.
Ces végétaux appartiennent aux genres déjà cites dans plusieurs de
nos relâches précédentes, et presque toujours aussi aux mêmes espèces;
ce qui pourtant ne m’empêchera pas de les énumérer de nouveau, afin
d’y réunir, du moins à la plupart, les noms de l’idiome mariannais (i).
J’ai recueilli ces mots avec beaucoup d’empressement et de soin ,
parce qu’ils sont généralement connus des indigènes de l’archipel des
Mariannes (2). Ils ont été employés dans tous les ouvrages et dans les
manuscrits qu’on possède à Manille , dit-on , sur l’histoire de ces peuples :
réunis au langage de la science, ils pourront servir à l’interprétation ou
à l’éclaircissement de faits qui sans cela resteroient long-temps encore
ignorés, ou peut-être toujours inconnus.
L ’espoir seul d’être utile peut me déterminer à indiquer de nouveau
des plantes connues et nommées déjà plusieurs fois , et à m’exposer
ainsi à la juste critique des botanistes.
Les arbres qui forment la masse de cette végétation sont toujours le
barringtonia speciosa [ i-ouitno ] (3); une autre espèce ] , gravée
jilanche 10 7 , à laquelle j’ai donné le nom de barringtonia raccmosa; le
hruguiera gymnorhiia [ matciw.i, ] (4), et je crois plusieurs autres espèces
(1) C e s mots, en lettres rondes, continueront d’indiquer, comme précédemment, les noms
donnés par les indigènes.
(2) II n’est peut-être pas sans intérêt pour l’étude de l’histoire de ces contrées, de faire
remarquer que la langue mariannaise a de nombreuses connexions avec celle que fo n parle
aux îles Philippines.
(3) que nous avons décrit de nouveau [voyez l’article Myrtï ) , offre constamment
un ovaire à quatre loges bispermes, dont trois loges et sept ovules avortent ordinairement.
(4 ) O u , 1 ,0 , 1 ,PoGG ce qui v eut dire manglier mâle; le prentier de ces noms, privé d’a c cen t,
est je crois espagnol et se trouve inscrit dans les ouvrages latins sur la botanique; ie second
appartient à fidiome mariannais.