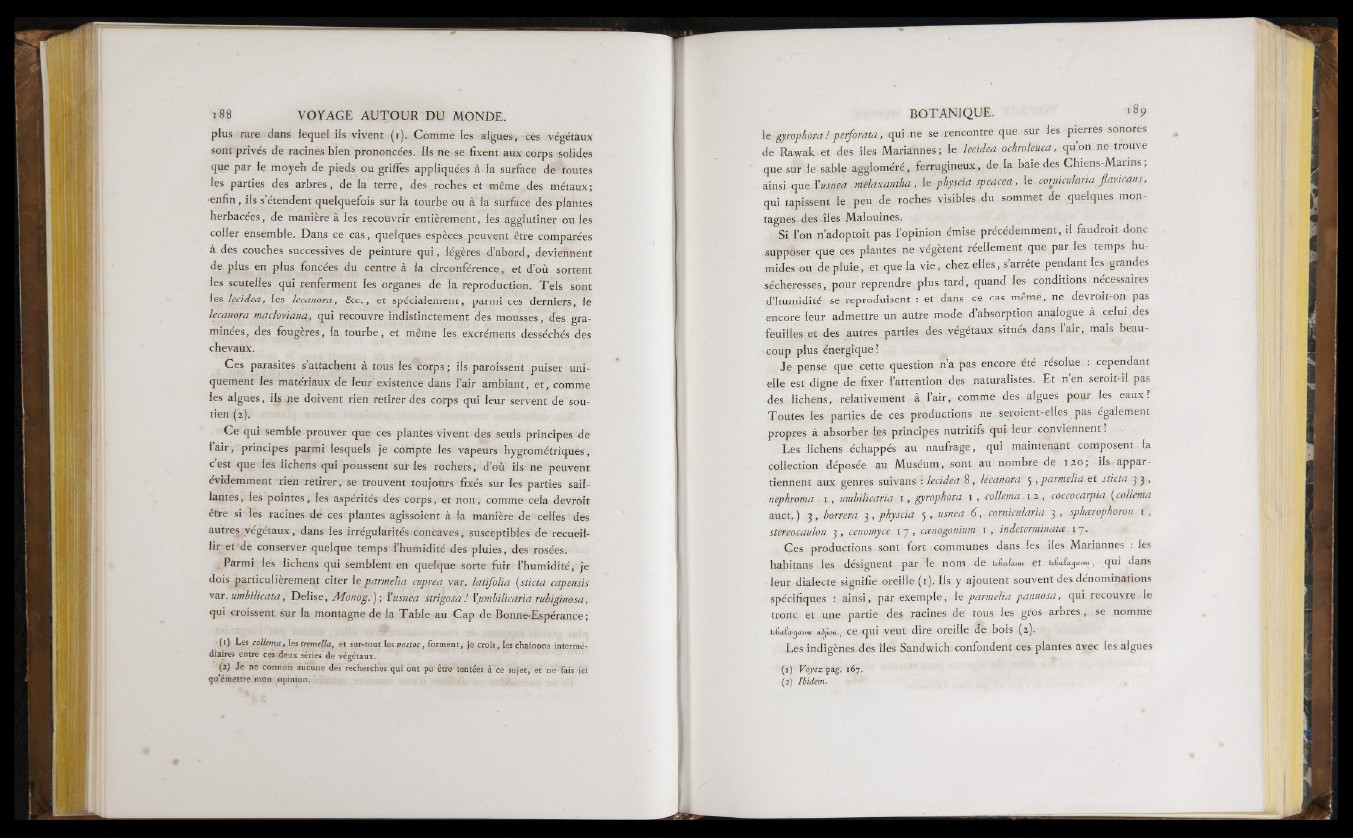
i88 V O Y A G E A U T O U R D U M O N D E ,
plus rare dans lequel iis vivent (i). Comme les algues, ces végétaux
sont privés de racines bien prononcées. Ils ne se fixent aux corps solides
que par ie moyen de pieds ou griffes appliquées à la surface de toutes
les parties des arbres, de la terre, des rocbes et même des métaux;
•enfin , ils s’étendent quelquefois sur la tourbe ou à la surface des plantes
herbacées, de manière à les recouvrir entièrement, les agglutiner ou les
coller ensemble. Dans ce c a s , quelques espèces peuvent être comparées
à des couches successives de peinture q u i, légères d’abord, deviennent
de plus en plus foncées du centre à la circonférence, et d’où sortent
les scutelles qui renferment les organes de la reproduction. T e ls sont
les lecidea, les lecanora, & c . , et spécialement, parmi ces derniers, le
lecanora macloviana, qui recouvre indistinctement des mousses, des graminées,
des fougères, ia tourbe, et même les excrémens desséchés des
chevaux.
Ces parasites s attachent à tous les coi'ps ; ils paroissent puiser uniquement
les matériaux de leur existence dans l’air ambiant, e t , comme
les algues, ils ne doivent rien retirer des corps qui leur servent de soutien
(2).
C e qui semble prouver que ces plantes vivent des seuls principes de
l ’a ir, principes parmi lesquels je compte les vapeurs hygrométriques,
c’est que les lichens qui poussent sur les rochers, d’où ils ne peuvent
évidemment rien retirer, se trouvent toujours fixés sur les parties saillantes,
les pointes, les aspérités des corps, et non, comme cela devroit
être si les racines de ces plantes agissoient à la manière de celles des
autres végétaux, dans les irrégularités concaves, susceptibles de recueillir
et de conserver quelque temps l’humidité des pluies, des rosées.
Parmi les lichens qui semblent en quelque sorte fuir l’humidité, je
dois particulièrement citer le parmelia cuprea var. latifolia [sticta capensis
Yar. iimhilicata, Deiise, Mono g.); X usnea strigosa ! Xumbilicaria rubiginosa,
qui croissent sur la montagne de la T ab le au Cap de Bonne-Espérance;
(1 ) Le s collema, \ss tremella, et sur-tout \esnostoc, fo rm e n t , je c r o is , les chaîn on s in te rm é diaires
entre ces d eu x séries de v é g é tau x .
(2) J e n e con n o is au cu n e des rech e rch e s q u i o n t pu être tentées à c e su je t , e t n e fais ic i
q u ’énie ttre mon o p inion.
le gyrophora ! perforata, qui ne se rencontre que sur les pierres sonores
de Rawak et des îles Mariannes; ie lecidea ochroieuca, qu’on ne trouve
que sur ie sable aggloméré, ferrugineux, de la baie des Chiens-Marins ;
ainsi que Xusnea melaxantha, le physcia speacea, le cornicularia flavicans,
qui tapissent ie peu de roches visibies du sommet de quelques montagnes
des îles Malouines.
Si l’on n’adoptoit pas l’opinion émise précédemment, ii faudroit donc
supposer que ces piantes ne végètent réeilement que par ies temps humides
ou d ep iu ie , et que la v ie , chez e lle s , s’arrête pendant les grandes
sécheresses, pour reprendre plus tard, quand les conditions nécessaires
d’humidité se reproduisent : et dans ce cas même, ne devroit-on pas
encore leur admettre un autre mode d’absorption analogue à celui des
feuiiies et des autres parties des végétaux situés dans i’air, mais beaucoup
pius énergique!
Je pense que cette question n’a pas encore été résolue : cependant
elle est digne de fixer i’attention des naturalistes. Et n en seroit-il pas
des lichens, relativement à l’a ir, comme des algues pour ies eaux!
Toutes les parties de ces productions ne seroient-eiles pas également
propres à absorber ies principes nutritifs qui leur conviennent !
Les lichens échappés au naufrage, qui maintenant composent la
collection déposée au Muséum, sont au nombre de 120; ils appartiennent
aux genres suivans : lecidea 8 , lecanora 5 , parmelia et sticta 3 3 ,
nephroma i , umbilicaria i , gyrophora i , collema 12 , coccocarpia [collema
auct.) 3, borrera , physcia 3, usnea 6 , cornicularia 3 , spharophoron r ,
stereocaulon 3 , cenomyce i 7 , cænogonium i , indeterminatæ i 7.
Ces productions sont fort communes dans les îles Mariannes : ies
habitans les désignent par le nom de et icÊaLgani,, qui dans
ieur dialecte signifie oreille (i). Ils y ajoutent souvent des dénominations
spécifiques ; ainsi, par exemple, le parmelia pannosa, qui recouvre le
tronc et une partie des racines de tous les gros arbres, se nomme
.ïc^ioJlcL'C^tX.X v, ce qui veut dire D J ' i. oreille de bois (2).
Les indigènes des îles Sandwich confondent ces plantes avec les algues
( 1 ) K o y e z p ag . 16 7.
(2) Ibidem.