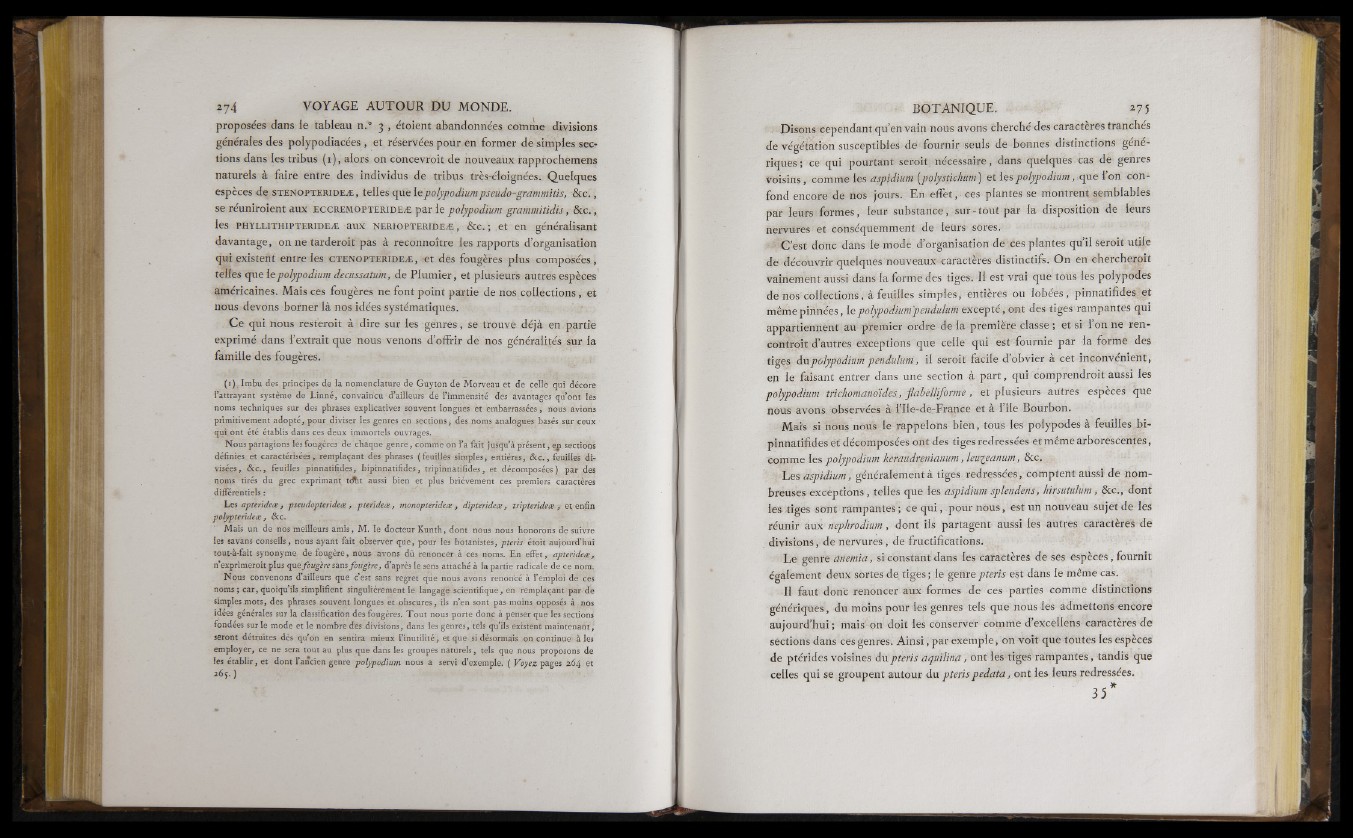
proposées dans le tableau n.° 3 , étoient abandonnées comme divisions
générales des polypodiacées , et réservées pour en former de simples sections
dans les tribus (i), alors on concevroit de nouveaux rapprochemens
naturels à faire entre des individus de tribus très-éloignées. Quelques
espèces de s t e n o p t e r i d e æ , telles que le polypodium pseudo-grammitis, & c . ,
se réuniroient aux e c c r e m o p t e r i d e æ par ie polypodium grammitidis, & c . ,
les p h y l l i t h i p t e r i d e æ aux n e r i o p t e r i d e æ , &c. ; et en généralisant
davantage, on ne tarderoit pas à reconnoître les rapports d’organisation
qui existent entre les c t e n o p t e r i d e æ , et des fougères plus composées,
telles que le polypodium decussatum, de Plumier, et plusieurs autres espèces
américaines. Mais ces fougères ne font point partie de nos collections , et
nous devons borner là nos idées systématiques.
C e qui nous resferoit à dire sur ies genres , se trouve déjà en partie
e.xprimé dans l’extrait que nous venons d’offrir de nos généralités sur la
famille des fougères.
( i) Imbu des principes de la nomenclature de Guyton de Alorveau et de celle qui décore
l’attrayant système de L in n é , convaincu d’ailleurs de l’immensité des avantages qu’ont les
noms techniques sur des phrases explicatives souvent longues et embarrassées , nous avions
primitivement adop té, pour diviser les genres en sections, des noms analogues basés sur ceux
qui ont été établis dans ces deux immortels ouvrages.
Nous partagions les fougères de chaque g en re , comme on l’a fait jusqu’ à présent, ep sections
définies et caractérisées, remplaçant des phrases (feuilles simples, entières, & c . , feuilles divisées,
& c . , feuilles pinnatifides, bipinnatifides, tripinnatifides, et décomposées) par des
noms tirés du grec exprimant tdiit aussi bien et plus brièvement ces premiers caractères
différentiels ;
aipterideæ , pseudopterideoe , pterideæ, monopterideæ , dipterideæ, tripterideæ , et enfin
polypterideæ, & c .
Mais un de nos meilleurs amis, M. le docteur Kunth, dont nous nous honorons de suivre
les savans conseils , nous ayant fait observer que , pour les botanistes, pteris étoit aujourd’hui
tout-à-fait synonyme de fougère, nous avons dû renoncer à ces noms. En e ffe t, apterideæ,
n’expriraeroit plus cpiefougere sans fougère, d’après le sens attaché à ia partie radicale de ce nom.
Nous convenons d’ailleurs que c’est sans regret que nous avons renoncé à l’ emploi de ces
noms ; ca r, quoiqu’ils simplifient singulièrement le langage scientifique, en remplaçant par de
simples mots, des phrases souvent longues et obscures, ils n’en sont pas moins opposés à nos
idées générales sur la classification des fougères. T o u t nous porte donc à penser que les sections
fondées sur le mode et le nombre des divisions, dans les genres, tels qu’ils existent maintenant,
seront détruites dès qu’on en sentira mieux l’inutilité, et que si désormais on continue à les
employer, ce ne sera tout au plus que dans les groupes naturels, tels que nous proposons de
les é ta b lir , et dont l’ancien genre polypodium nous a servi d’exemple. ( Voyez pages 264 et
265. )
Disons cependant qu’en vain nous avons cherche' des caractères tranches
de végétation susceptibles de fournir seuis de bonnes distinctions génériques
; ce qui pourtant seroit nécessaire, dans quelques cas de genres
voisins, comme ies aspidium [polystichum) et ies polypodium, que l’on confond
encore de nos joUrs. En e ffe t, ces plantes se montrent semblables
par leurs formes, leur substance, sur - tout par ia disposition de leurs
nervures et conséquemment de leurs sores.
C ’est donc dans le mode d’organisation de ces plantes qu’il seroit utile
de découvrir quelques nouveaux caractères distinctifs. On en chercheroit
vainement aussi dans la forme des tiges. II est vrai que tous ies polypodes
den os collections, à feuilles simples, entières ou lobées, pinnatifides et
même pinnées, le polypodium'pendulum excepté, ont des tiges rampantes qui
appartiennent au premier ordre de ia première classe ; et si l’on ne ren-
controit d’autres exceptions que celle qui est fournie par la forme des
tiges ánpúlypodium pendulum, il seroit facile d’obvier à cet inconvénient,
en le faisant entrer dans une section à p a r t, qui comprendroit aussi les
polypodium trichomanoides, fabelliforme , et plusieurs autres especes que
nous avons observées à l’IIe-de-France et à i’îie Bourbon.
Mais si nous nous le rappelons b ien , tous ies polypodes à feuilles bipinnatifides
et décomposées ont des tiges redresse'es et même arborescentes,
comme les polypodium keraudrenianum, leuieanum, &c.
Ees aspidium, généralement à tiges redressées, comptent aussi de nombreuses
exceptions, telles que ies aspidium splendens, hirsutulum, & c., dont
ies tiges sont rampantes ; ce q u i , pour nous, est un nouveau sujet de les
réunir aux nephrodium , dont ils partagent aussi les autres caractères de
divisions, de nervures , de fructifications.
Le genre anemia, si constant dans les caractères de ses espèces , fournit
également deux sortes de tiges; le genre pteris est dans ie même cas.
Ii faut donc renoncer aux formes de ces parties comme distinctions
génériques, du moins pour ies genres tels que nous ies admettons encore
aujourd’hui ; mais on doit les conserver comme d’excellens caractères de
sections dans ces genres. A in s i, par exemple, on voit que toutes les espèces
de piérides voisines du pteris aquilina , ont les tiges rampantes , tandis que
celles qui se groupent autour du pteris pedata, ont les leurs redressées.
C