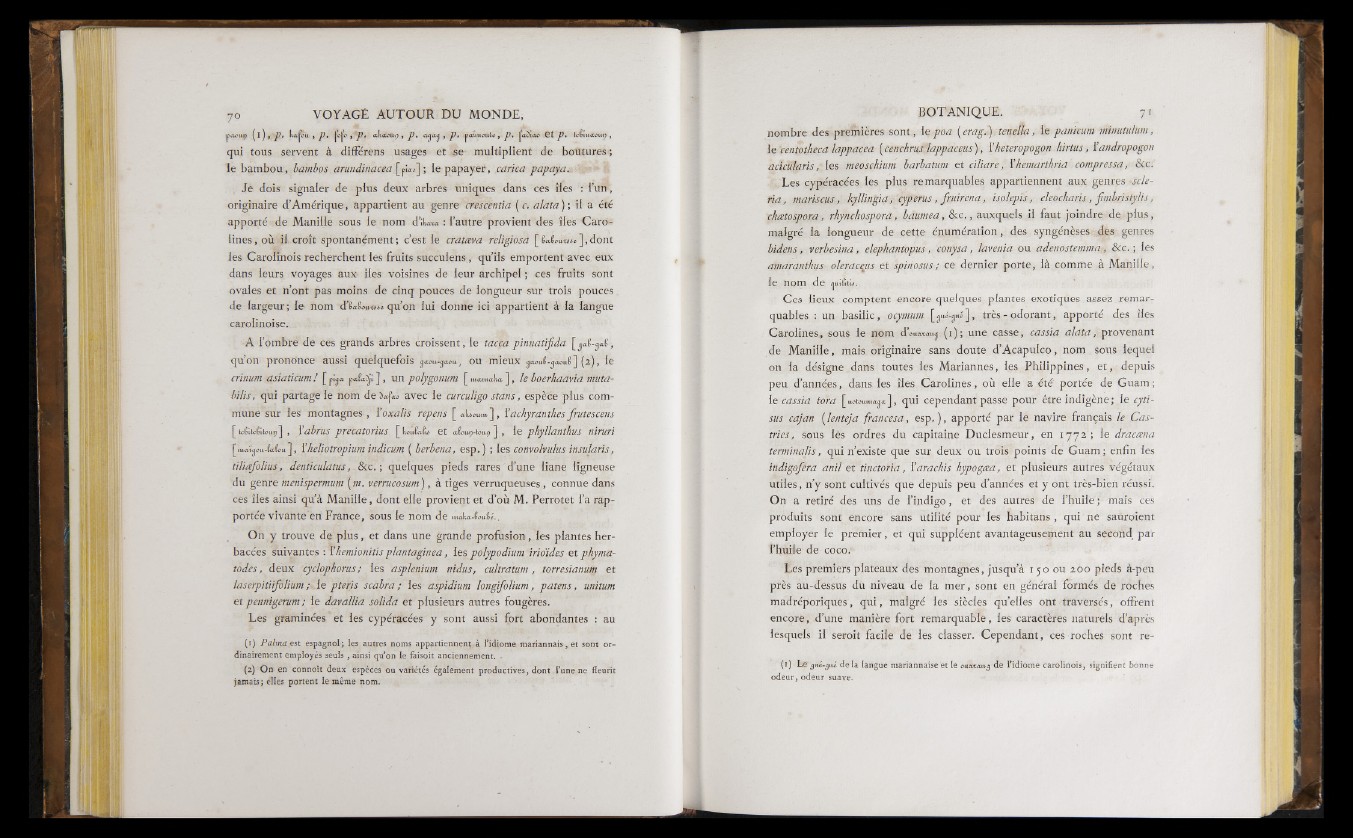
70 V O Y A G É A U T O U R D U M O N D E ,
poyiii; krt|hu , 7?. (0(0,7:, oe\\a.cu,; , p . cuyu^ , p, paunouto , p, (aànto Ct p. loliiiiaoiii; ,
qui tous servent à différens usages et se multiplient de boutures ;
le bambou, hamhos arundinacea\_^\aX\-, le papayer, carica papaya.
Je dois signaler de pius deux arbres uniques dans ces îles : l’u n ,
originaire d’Amérique, appartient au genre crescentia ( c. alata ) ; il a été
apporté de Manille sous le nom d’ikaM : l’autre provient des îles Caro-
lines, où il croît spontanément; c’est le cratceva religiosa [6« ],d on t
les Carolinois recherchent les fruits succulens , qu’ils emportent avec eux
dans leurs voyages aux îles voisines de leur archipel ; ces fruits sont
ovales et n’ont pas moins de cinq pouces de longueur sur trois pouces
de largeur; le nom d’EaSouttio qu’on lui donne ici appartient à la langue
carolinoise.
A l’ombre de ces grands arbres croissent, le tacca pinnatijlda ,
qu’on prononce aussi quelquefois gaon-gaou, ou mieux ¡]aouE-<|aou§] (2), le
crinum asiaticum ! [ pljj» pafaJj; ] , un polygonum [ mainalia ] , le boerhaavia muta-
Inlis, qui partage le nom de aq’cu avec le curcuïigo staris, espèce plus commune
sur les montagnes , Xoxalis repens [ akôouiit ] , Xachyranthes frutescens
[ tcfi'ikiluup] , Xahrus precatorius [ kouEL et a&jup-toup ] , le phyllanthus niruri
[u.aVjj.^ii-PaPoii], Xheliotropium indicum ( berhena, esp.) ; les convolvulus insularis,
tiliafolius, denticulatus, &c. ; quelques pieds rares d’une liane ligneuse
du genre menispermum ( m. verrucosum ) , à tiges verruqueuses , connue dans
ces îles ainsi qu’à Manille, dont elle provient et d’où M. Perrotet l’a rapportée
vivante en France, sous le nom de maU-îcuÎé.,
On y trouve de p lu s , et dans une grande profusion, les plantes herbacées
suivantes : Xhemionitis plantaginea, les polypodium irio'ides et phymatodes,
deux cyclophorus; les asplénium nidus, cultratum , torresianum et
laserpitiifolium ; le pteris scabra; les aspidium longifolium, patens, unitum
et pennigerum; le davallia solida et plusieurs autres fougères.
Les graminées et les cypéracées y sont aussi fort abondantes : au
(1) Palma est espagnol; les autres noms appartiennent à l’idiome mariannais, et sont ordinairement
employés seuls , ainsi qu’on le faisoit anciennement.
(2) O n en connoit deux espèces ou variétés également productives, dont l’une ne fleurit
jamais; elles portent le même nom.
nombre des premières sont, 16770« [erag.) t en ella, le panicum minutulum,
\e centotheca lappacea [cenchrus lappaceus), Xheteropogon hirtus, Xandropogon
acicularis, les meoschium harhatum et ciliare, Xhemarthria compressa, Sic.
Les cypéracées les plus remarquables appartiennent aux genres sc/e-
ria, mariscus, kyllingia, cyperus , fruircna, isolepis, eleocharis, fmhristylis,
chxtospora, rhynchospora, baumea, & c . , auxquels il faut joindre de plus,
malgré la longueur de cette énumération, des syngénèses des genres
hidens, verhesina, elephantopus, conysa, lavenia ou adenostemma, 8cc. ; les
amaranthiis oleraceus et spinosus; ce dernier porte, là comme à Manille,
le nom de guifiib.
Ces lieux comptent encore quelques plantes exotiques assez remar-
cjuables : un basilic, ocytiiuin é ] , très - odorant, apporté des îles
Carolines, sous le nom d’ouMang ( i) ; une casse, cassia alata, provenant
de M an ille , mais originaire sans doute d’A c a p u lco , nom sous lequel
on la désigne dans toutes les Mariannes, les Philippines, e t , depuis
peu d’années, dans les îles Caro line s , où elle a été portée de Guam;
le cassia tora [„otou.i.itja], qui cependant passe pour être indigène; le cytisus
cajan [lenteja francesa, e sp .) , apporté par le navire français le Cas-
trics, sous les ordres du capitaine Duclesmeur, en 1 7 7 2 ; le dracana
terminalis, qui n’existe que sur deux ou trois points de Guam; enfin les
indigofera anil et tinctoria, Xarachis hypogcea, et plusieurs autres végétaux
utile s , n’y sont cultivés que depuis peu d’années et y ont très-bien réussi.
On a retiré des uns de l’in d ig o , et des autres de l’huile ; mais ces
produits sont encore sans utilité pour les habitans , qui ne sauroient
employer le premier, et qui suppléent avantageusement au second par
l’huile de coco.
Les premiers plateaux des montagnes, jusqu’à i 50 ou 200 pieds à-peu
près au-dessus du niveau de la m e r , sont en général formés de roche.s
madréporiques, q u i , malgré les siècles qu’elles ont traversés, offrent
encore, d’une manière fort remarquable, les caractères naturels d’après
lesquels il seroit facile de les classer. Cependant, ces roches sont re-
(i) Le d e là langue mariannaise et le oumxtiÿ de l’idiome carolinois, signifient bonne
odeur, odeur suave.