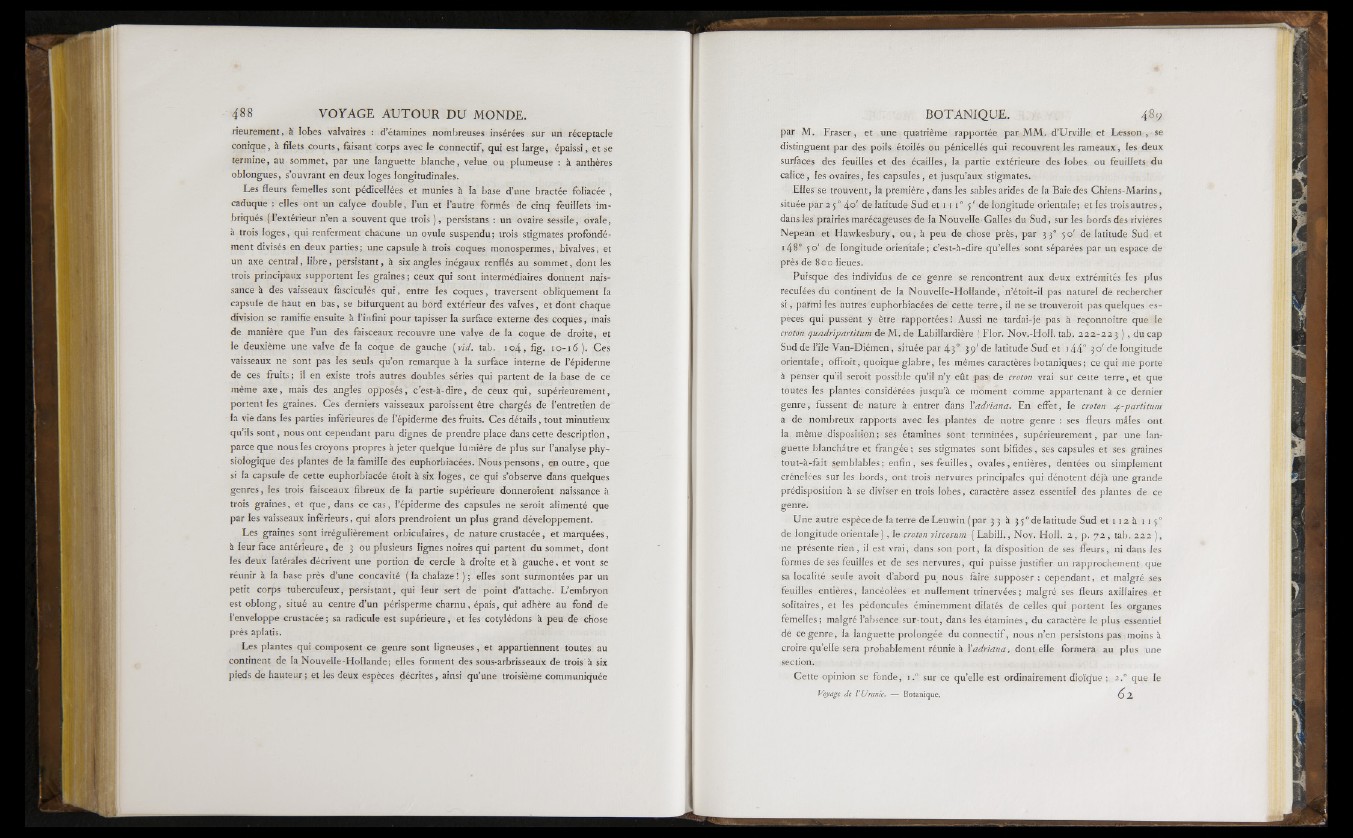
rieurement, à lobes valvaires ; d’étamines nombreuses insérées sur un réceptacle
con iq u e, k filets co u r ts , faisant corps avec le con n e c tif, qui est la rg e , épa issi, et se
termine, au sommet, par une languette b lanch e , velue ou plumeuse ; à anthères
ob ion gu e s, s’ouvrant en deux loges longitudinales.
Les fleurs femelles sont pédicellées et munies k ia base d’une bractée foliacée ,
caduque : elles ont un calyce d o u b le , i’un et i ’autre formés de cinq feuillets im briqués
( l’extérieur n’en a souvent que trois ) , persistans ; un ovaire sessile, o v a le ,
k trois lo g e s , qui renferment chacune un ovule suspendu; trois stigmates p rofon dé ment
divisés en deux parties; une capsule k trois coques monospermes, b iva lv es, et
un axe central, lib re , pers istant, à six angles inégaux renflés au sommet, dont les
trois principaux supportent les graines ; ceux qui sont intermédiaires donnent naissance
k des vaisseaux fasciculés q u i , entre ies c o q u e s , traversent obliquement la
capsule de haut en b as, se bifurquent au bord extérieur des v a lv e s, et dont chaque
division se ramifie ensuite k l ’infini pour tapisser la surface externe des coq u es , mais
de manière que l’un des faisceaux recouvre une v alve de ia coque de droite, et
le deuxième une valve de ia coque de gauche [y ii. tab. i o 4 , fig . 1 0 - 1 6 ) . C e s
vaisseaux ne sont pas les seuis qu’on remarque k ia surface interne de l’épiderme
de ces fruits ; il en existe trois autres doubles séries qui partent de ia base de ce
même a x e , mais des angles o p p o sé s , c ’e st-k-dire, de ceux q u i, supérieurement,
portent ies graines. C e s derniers vaisseaux paroissent être chargés de l’entretien de
la vie dans ies parties inférieures de l ’épiderme des fruits. C e s d é ta ils , tout minutieux
qu’ils s o n t , nous ont cependant paru dignes de prendre place dans cette d es cription,
parce que nous les croyons propres k jeter quelque lumière de plus sur l’analyse phy-
.siologique des plantes de la famille des euphorbiacées. Nous p ensons, en ou tre , que
S! la capsule de cette euphorbiacée éloit k six lo g e s , ce qui s’observe dans quelques
g en re s , les trois faisceaux fibreux de la partie supérieure donneroient naissance k
trois g ra ine s, et q u e , dans ce c a s , l’épiderme des capsules ne seroit aliinenté que
par les vaisseaux inférieurs, qui alors prendroient un plus grand développement.
Les graines sont irrégulièrement oririculaires, de nature c ru s ta c é e , et marquées,
k leur face antérieure, de 3 ou plusieurs lignes noires qui partent du sommet, dont
les deux latérales décrivent une portion de cercle k droite et k g a u c h e , et vont se
réunir k ia base près d’une concavité ( ia chalaze! ) ; elles sont surmontées par un
petit corps tu be rculeu x, persistant, qui leur sert de point d’attache. L ’embryon
est o b lo n g , situé au centre d’un ¡lérisperme charnu, épais, qui adhère au fond de
l’enveloppe crustacée; sa radicule est supérieure, et ies cotylédons k peu de chose
près aplatis.
Les plantes qui composent ce genre sont lign eu s e s , et appartiennent toutes au
continent de la N o u ve lle -H o llan de ; elles forment des sous-arbrisseaux de trois k six
pieds de hauteur; et les deux espèces déc rites, ainsi qu’une troisième communiquée
par M . F ra s e r , et une quatrième rapportée par M M . d’U rv ille et Lesson , se
distinguent par des poils étoilés ou pénicellés qui recouvrent les rameaux, les deux
surfaces des feuilles et des écailies, la partie extérieure des lobes ou feuillets du
c a lic e , les ovaires, ies cap su le s , et jusqu’aux stigmates.
Elles se trouvent, la première , dans les sables arides de la Baie des Ch ien s-M a r in s,
située par 2 5° 4o' de latitude Sud et i 1 1° 5' de longitude orientale; e t ie s troisautres,
dans les prairies marécageuses de la N ou v e lle Galles du S u d , sur les bords des rivières
Nepean et H aw k e sbu ry , o u , k p eu de chose près, par 33° 50' de latitude Sud et
i 48° S ° ' rie longitude orientale; c ’est-k-dire q u ’elles sont séparées par un espace de
près de 80c lieues.
Puisque des individus de ce g en re se rencontrent .aux deux extrémités les plus
reculées du continent de la N o u v e ile -H o lla n d e , n’étoit-il pas naturel de rechercher
s i , parmi les autres euphorbiacées de cette te rre , il ne se trouveroit pas quelques espèces
qui pussent y être rapportées î Aussi ne tardai-je pas k reconnoître que le
croton quadripartitum de M . de Labillardière [ Flor. N o v.-H o ll. tab. 2 2 2 -2 2 3 ) , du cap
Sud de i’île V a n -D iém en , située par 43° 39’ de latitude Sud et i 44" 3 ° ’ de longitude
orientale, o ffro it, quoique g la b re , ies mêmes caractères Ijotaniques; ce qui me porte
k penser qu'il seroit possible qu’il n’y eût pas de croton vrai sur cette te rre , et que
toutes les plantes considérées jusqu’k ce moment comme appartenant k ce dernier
g en r e , fussent de nature k entrer dans Vadriana. En e ffe t, le croton q.-partitum
a de nombreux rapports avec ies piantes de notre genre : ses fleurs mâies ont
ia même disposition; ses étamines sont terminées, supérieurement, par une languette
blanchâtre et fran g é e ; ses stigmates sont b ifid e s, ses capsules et ses graines
tout-à-fait semblables; en fin , ses fe u ille s , o v a le s , entières, dentées ou simplement
crénelée,« sur les bords, ont trois nervures principales qui dénotent déjà une grande
prédisposition k se diviser en trois lo b e s , caractère assez essentiel des plantes de ce
genre.
U n e autre e sp è ced e la terre de Leuwin (par 3 3 k 3 5° de latitude Sud et 1 i 2 k 115°
de longitude orientale ) , le croton viscosum ( L a b i ll., N o v . H o ll. 2 , p. 7 2 , tab. 2 22 ) ,
ne présente r ien , il est v rai, dans son p o r t, la disposition de ses fleu rs , ni dans les
formes de ses feuilles et de ses nervures, qui puisse justifier un rapprochement que
sa locaiité seule avoit d’abord p u nous faire supposer : cep endant, et malgré ses
feuilles entière s, lancéolées et nullement trinervées ; malgré ses fleurs axillaires et
solitaires, et les pédoncules éminemment dilatés de celles qui portent les organes
femelles; malgré l’absence su r-tou t, dans les étamines, du caractère le plus essentiel
de ce g en re , la languette prolongée du c o n n e c tif, nous n’en persistons pas moins k
croire qu’elle sera probablement réunie k l’ûâV/«na, dont eile formera au plus une
section.
C e tte opinion se fon d e , i." sur ce q u ’elle est ordinairement dioïque ; 2 .” que le
Voyage ie l'Uranie. — Botanique. X