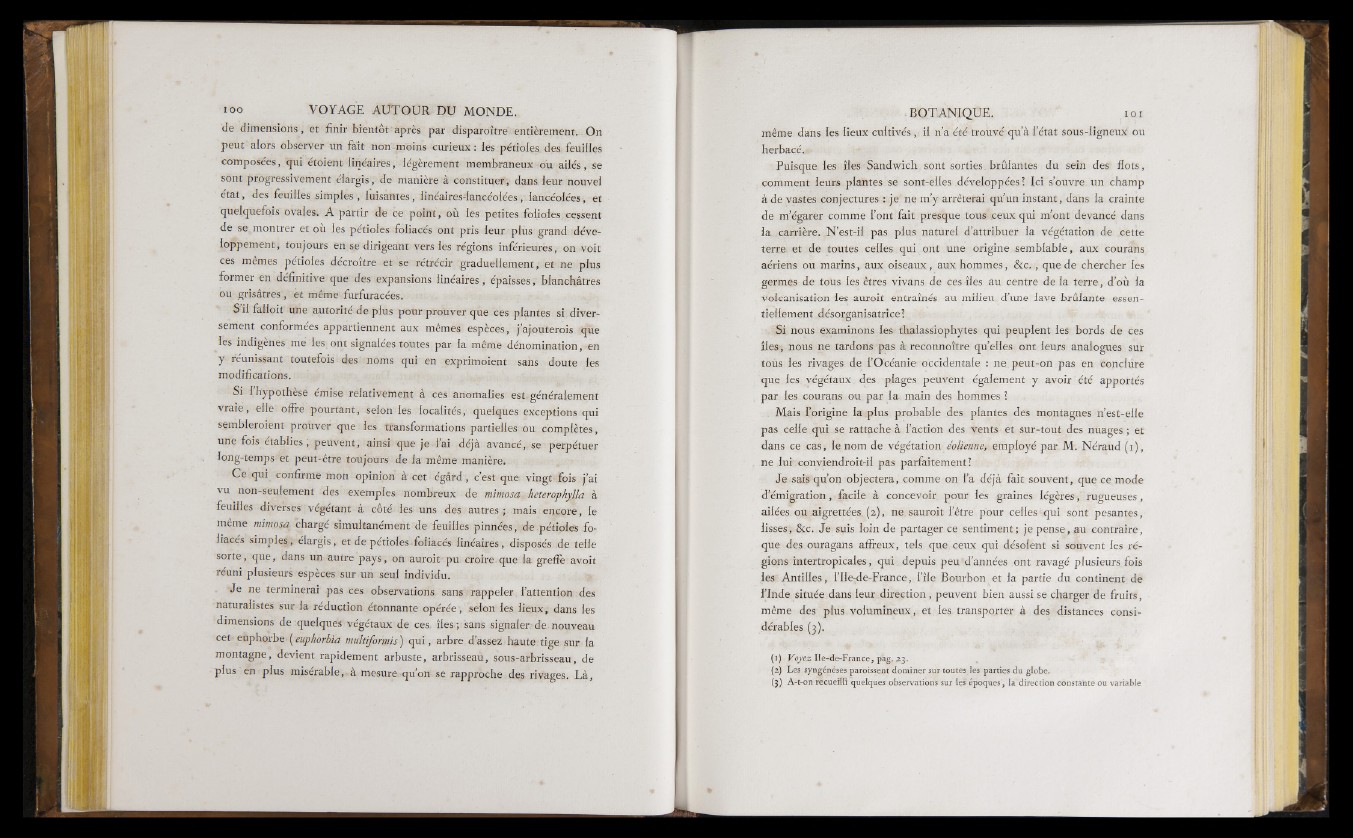
de dimensions, et finir bientôt après par disparoître entièrement. On
peut alors observer un fait non moins curieux : les pétioles des feuilles
composées, qui étoient linéaires, légèrement membraneux ou ailés, se
sont progressivement élargis, de manière à constituer, dans leur nouvel
état, des feuilles simples, luisantes, linéaires-lancéolées , lancéolées, et
quelquefois ovales. A partir de ce point, où les petites folioles cessent
de se montrer et où les pétioles foliacés ont pris leur plus grand développement,
toujours en se dirigeant vers les régions inférieures, on voit
ces mêmes pétioles décroître et se rétrécir graduellement, et ne plus
former en définitive que des expansions linéaires, épaisses, blanchâtres
ou grisâtres , et même furfuracées.
S il falfoit une autorité de plus pour prouver que ces plantes si diversement
conformées appartiennent aux mêmes espèces, j’ajouterois que
les indigènes me les ont signalées toutes par ia même dénomination, en
y réunissant toutefois des noms qui en exprimoient sans doute les
modifications.
Si l’hypothèse émise relativement à ces anomalies est généralement
vra ie, elle offre pourtant, selon les localités, quelques exceptions qui
sembleroient prouver que les transformations partielles ou complètes,
une fois établies, peuvent, ainsi que je l’ai déjà avancé, se perpétuer
long-temps et peut-être toujours de la même manière.
C e qui confirme mon opinion à cet égard , c’est que vingt fois j’ai
vu non-seulement des exemples nombreux de mimosa heterophylla à
feuilles diverses végétant à côté les uns des autres; mais encore, le
même mimosa chargé simultanément de feuilles pinnées, de pétioles foliacés
simples , élargis, et de pétioles foliacés linéaires , disposés de telle
sorte, que, dans un autre pays, on auroit pu croire que ia greffe avoit
réuni plusieurs espèces sur un seul individu.
Je ne terminerai pas ces observations sans rappeler l’attention des
naturalistes sur la réduction étonnante opérée, selon les lieux, dans les
dimensions de quelques végétaux de ces îles; sans signaler de nouveau
cet euphorbe ( euphorbia multiformis ) q u i , arbre d’assez haute tige sur la
montagne, devient rapidement arbuste, arbrisseau, sous-arbrisseau, de
plus en plus misérable, à mesure qu’on se rapproche des rivages. L à ,
même dans les lieux cultivés, il n’a été trouvé qu’à l’état sous-ligneux ou
herbacé.
Puisque les îles Sandwich sont sorties, brûlantes du sein des flots,
comment leurs plantes se sont-elles développées ! Ici s’ouvre un champ
à de vastes conjectures : je ne m’y arrêterai qu’un instant, dans la crainte
de m’égarer comme l’ont fait presque tous ceux qui m’ont devancé dans
la carrière. N ’est-ii pas plus naturel d’attribuer la végétation de cette
terre et de toutes celles qui ont une origine semblable, aux courans
aériens ou marins, aux oiseaux, aux hommes, &c. , que de chercher les
germes de tous ies êtres vivans de ces îles au centre de ia terre, d’où la
volcanisation les auroit entraînés au milieu d’une lave brûlante essentiellement
désorganisatrice!
Si nous examinons les tbalassiophytes qui peuplent les bords de ces
îles, nous ne tardons pas à reconnoître qu’elles ont leurs analogues sur
tous les rivages de l’Océanie occidentale : ne peut-on pas en conclure
que les végétaux des plages peuvent également y avoir été apportés
par les courans ou par la main des hommes ?
Mais l’origine la plus probable des plantes des montagnes n’est-elle
pas celle qui se rattache à l’action des vents et sur-tout des nuages ; et
dans ce cas, le nom de végétation e'olienne, employé par M. Néraud ( i ) ,
ne lui conviendroit-il pas parfaitement?
Je sais qu’on objectera, comme on l’a déjà fait souvent, que ce mode
d’émigration, facile à concevoir pour les graines légères, rugueuses,
ailées ou aigrettées (2), ne sauroit l’être pour celles qui sont pesantes,
lisses, &c. Je suis loin de partager ce sentiment; je pense, au contraire,
que des ouragans affieux, tels que ceux qui désolent si souvent les régions
intertropicales, qui depuis peu d’années ont ravagé plusieurs fois
ies Antilles, l’Ile-de-France, l’île Bourbon et la partie du continent de
l ’Inde située dans leur direction , peuvent bien aussi se charger de fruits,
même des plus volumineux, et ies transporter à des distances considérables
(3).
(1) Koyez I le-de-F ran c e, pag. 23.
(2) Les syngénèses paroissent dominer sur toutes les parties du globe.
(3) A-t-on recueilli quelques observations sur les époques, la direction constante ou variable
♦M