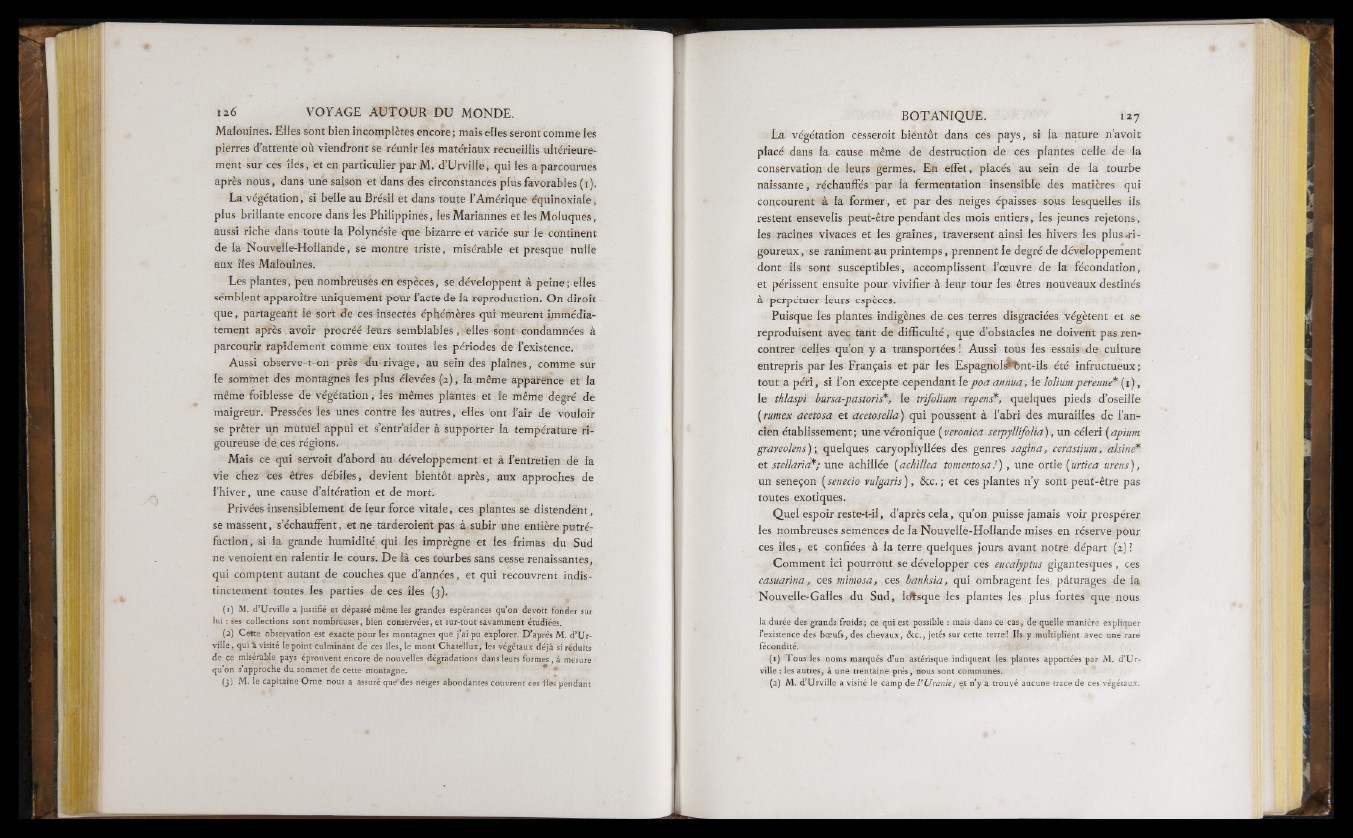
Malouines. Elles sont bien incomplètes encore; mais elles seront comme les
pierres d’attente où viendront se réunir les matériaux recueillis ultérieurement
sur ces îles, et en particulier par M. d’Urville, qui les a parcourues
après nous, dans une saison et dans des circonstances plus favorables (i).
Ea végétation, si belle au Brésil et dans toute l’Amérique équinoxiale,
plus brillante encore dans ies Philippines, les Mariannes et les Moluques,
aussi riche dans toute la Polynésie que bizarre et variée sur le continent
de la Nouvelle-Hollande, se montre triste, misérable et presque nulle
aux îles Malouines.
Les plantes, peu nombreuses en espèces, se développent à peine; elles
sémblent apparoître uniquement pour l’acte de la reproduction. On diroit
q u e , partageant le sort de ces insectes éphémères qui meurent immédiatement
après avoir procréé leurs semblables, elles sont condamnées à
parcourir rapidement comme eux toutes les périodes de l’existence.
Aussi observe-t-on près du rivage, au sein des plaines, comme sur
le sommet des montagnes les plus élevées (2), ia même apparence et la
même foiblesse de végétation, les mêmes plantes et le même degré de
maigreur. Pressées ies unes contre les autres, elles ont l’air de vouloir
se prêter un mutuel appui et s’entraider à supporter la température rigoureuse
de ces régions.
Mais ce qui servoit d’abord au développement et à l’entretien de la
vie chez ces êtres débiles, devient bientôt après, aux approches de
l’h iv e r , une cause d’altération et de mort.
Privées insensiblement de leur force vitale, ces plantes se distendent,
se massent, s’échauffent, et ne tarderoient pas à subir une entière putréfaction,
si la grande humidité qui les imprègne et les frimas du Sud
ne venoienten ralentir le cours. De là ces tourbes sans cesse renaissantes,
qui comptent autant de couches que d’années, et qui recouvrent indistinctement
toutes les parties de ces îles (3).
(1) M. d’UrvilIe a justifié et dépassé même les grandes espérances qu’on devoir fonder sur
lui ; ses collections sont nombreuses, bien conservées, et sur-tout savamment étudiées.
(2) Cette observation est exacte pour les montagnes que j’ ai pu explorer. D ’après M. d’U r v
ille , qui a visité le point culminant de ces îles, le mont C h a te llu x , les végétaux déjà si réduits
de ce misérable pays éprouvent encore de nouvelles dégradations dans leurs formes, à mesure
qu’on s’approche du sommet de cette montagne.
(3) M. le capitaine Orne nous a assuré que des neiges abondantes couvrent ces îles pendant
La végétation cesseroit bientôt dans ces pays, si la nature n’avoit
placé dans ia cause même de destruction de ces plantes celle de la
conservation de leurs germes. En effet, placés au sein de la tourbe
naissante, réchauffés par la fermentation insensible des matières qui
concourent à la former, et par des neiges épaisses sous lesquelles ils
restent ensevelis peut-être pendant des mois entiers, les jeunes rejetons,
les racines vivaces et les graines, traversent ainsi les hivers les plus-rigoureux,
se raniment au printemps, prennent le degré de développement
dont ils sont susceptibles, accomplissent l’oe uvre de la fécondation,
et périssent ensuite pour vivifier à leur tour les êtres nouveaux destinés
à perpétuer leurs espèces.
Puisque les plantes indigènes de ces terres disgraciées végètent et se
reproduisent avec tant de difficulté, que d’obstacles ne doivent pas rencontrer
celles qu’on y a transportées ¡ Aussi tous les essais de culture
entrepris par les Français et par les EspagnoIs*’6nt-iIs été infructueux ;
tout a péri, si l’on excepte cependant le poa annua, le lolium perenne* [ i ] ,
ie thlaspi bursa-pastoris*, le trifolium repens*, quelques pieds d’oseille
[rumex acetosa et acetosella) qui poussent à l’abri des murailles de l’ancien
établissement; une véronique [verónica serpyllifolia), un céleri [apium
graveolens)-, quelques caryophyllées des genres sagina, cerastium, alsine*
et stellariJ; une achillée [achillea tomentosa!) , une ortie [urtica urens),
un seneçon [senecio vulgaris), &c. ; et ces plantes n’y sont peut-être pas
toutes exotiques.
Q u el espoir reste-t-il, d’après c e la , qu’on puisse jamais voir prospérer
les nombreuses semences de la Nouvelle-Hollande mises en réserve pour
ces île s , et confiées à la terre quelques jours avant notre départ (2) ?
Comment ici pourront se développer ces eucalyptus gigantesques, ces
casuarina, ces mimosa, ces banksia, qui ombragent les pâturages de la
Nouvelle-Galles du Sud, lorsque les plantes les plus fortes que nous
la durée des grands froids; ce qui est possible : mais dans ce cas, de quelle manière expliquer
l’existence des boeufs, des chevaux , (Scc., jetés sur cette terre! Ils y multiplient avec une rare
fécondité.
(1) T o u s les noms marqués d’un astérisque indiquent ies plantes apportées par iM. d’Ur-
ville : les autres, à une trentaine près, nous sont communes.
{2) M. d’Urv ille a visité le camp de l'U ra n ie , et n’y a trouvé aucune trace de ces végétaux.