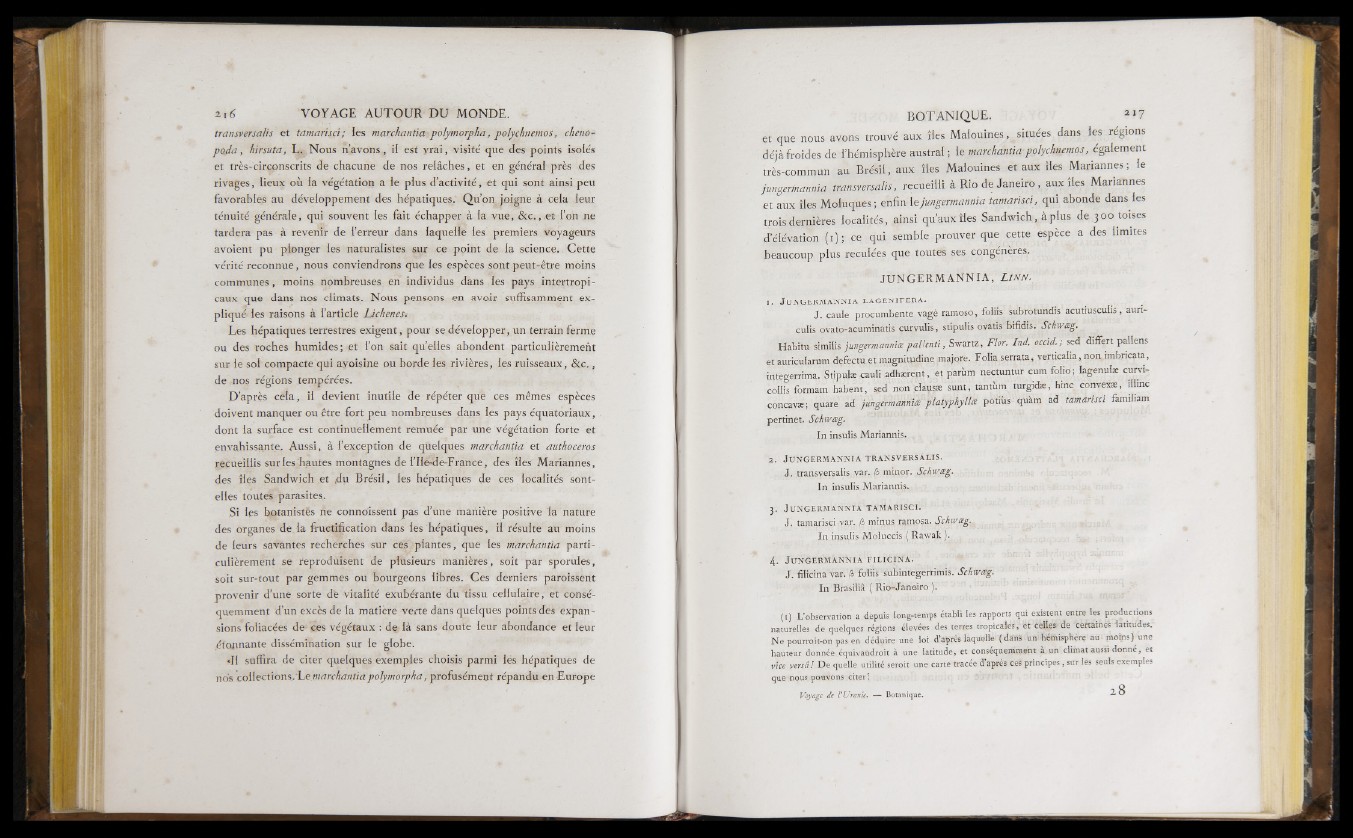
à
r
transversûlis et tamarisci; les marchantia polymorpha, polychnemos, cheno-
poda, hirsuta, L. Nous n’avons, il est vrai, visité qne des points isolés
et très-circonscrits de chacune de nos relâches, et en général près des
rivages, lieux où la végétation a le plus d’activité, et qui sont ainsi peu
favorables au développement des hépatiques. Q u ’on joigne à cela leur
ténuité générale, qui souvent les fait échapper à ia vue, & c ., ,et l’on ne
tardera pas à revenir de l’erreur dans laquelle les premiers voyageurs
avoient pu plonger ies naturalistes sur ce point de la science. Cette
vérité reconnue, nous conviendrons que les espèces sont peut-être moins
communes , moins nombreuses en individus dans les pays intertropicaux
que dans nos climats. Nous pensons en avoir suffisamment expliqué
les raisons à l’article Lichenes.
Les hépatiques terrestres exigent, pour se développer, un terrain ferme
ou des roches humides; et l’on sait qu’elles abondent particulièremeiit
sur le sol compacte qui avoisine ou borde les rivières, les ruisseaux, & c . ,
de nos régions tempérées.
D ’après cela, il devient inutile de répéter que ces mêmes espèces
doivent manquer ou être fort peu nombreuses dans les pays équatoriaux,
dont la surface est continuellement remuée par une végétation forte et
envahissante. Aussi, à l’exception de quelques marchantia et anthoceros
recueillis sur les hautes montagnes de rile-de-France, des îles Mariannes,
des îles Sandwich et dit Brésil, les hépatiques de ces localités sont-
eiles toutes parasites.
Si les botanistes ne connoissent pas d’une manière positive la nature
des organes de la fructification dans les hépatiques, il résulte au moins
de leurs savantes recherches sur ces plantes, que les marchantia particulièrement
se reproduisent de plusieurs manières, soit par sporules,
soit sur-tout par gemmes ou bourgeons libres. Ces derniers paroissent
provenir d’une sorte de vitalité exubérante du tissu cellulaire, et conséquemment
d’un excès de la matière verte dans quelques points des expansions
foliacées de ces végétaux : de là sans doute leur abondance et leur
étonnante dissémination sur le globe.
«Il suffira de citer quelques exemples choisis parmi les hépatiques de
nos collections. Le marchantia polymorpha, profusément répandu en Europe
et que nous avons trouvé aux îles Malouines, situées dans ies regions
déjà froides de l’hémisphère austral ; le marchantia polychnemos, également
très-commun au Brésil, aux îles Malouines et aux îles Mariannes; le
jungermannia transversalis, r e c u e i l l i à Rio de Janeiro , aux îles Mariannes
et aux îles Moluques; enfin \ejungermannia tamarisci, qui abonde dans les
trois dernières localités, ainsi qu’aux îles Sandwich, à plus de 300 toises
d’élévation (i); ce qui semble prouver que cette espèce a des limites
beaucoup plus reculées que toutes ses congénères,
J U N G E R M A N N I A , L i n n .
1. J u n g e rm a n n ia l a g e n i f e r a .
J. caule procumbente v ag è ramoso, foliis subrotundis a cutiu scu lis , auri-
culis ovato-acuminatis curvulis, stipulis ovatis bifidis. Schivoeg.
Habitu similis jungermannia p a llen t i, Sw ia a , Flor. Ind. occid. -, sed differt pallens
et auricuiarum defectu et magnitudine majore. Folia serrata, v er tica lia , non imbricata,
integerrima. Stipulæ cauli adhærent, et parùm nectuntur cum fo lio ; iagenulæ curvi-
coilis formam habent, sed non dausæ su n t, tantùm turgidæ, hinc con vexæ , filme
concavæ; quare ad jungermannia platyphylla potiùs quàm ad tamarisci familiam
pertinet. Schwoeg.
In insulis Mariannis.
2. J u n g e rm a n n ia tr a n sv e r sa l is .
J. transversalis var. 0 minor. Schwag.
In insulis Mariannis.
3. J u n g e rm a n n ia t am a r i s c i .
J. tamarisci var. 0 minus ramosa. Schwoeg.
In insulis Moiuc cis ( Rawak ).
4. J u n g e rm a n n ia f i l i c in a .
J. filicina var. 0 foiiis subintegerrimis. Schwag.
In Brasiliâ ( Rio-Janeiro ).
(I) L ’observation a depuis long-temps établi les rapports qui existent entre les productions
naturelles de quelques régions élevées des terres tropicales, et celles de certaines latitudes.
N e pourroit-on pas en déduire une loi d’après laquelle (dans un hémisphère au moins) une
hauteur donnée équivaudroit à une latitude, et conséquemment à un climat aussi d onn é , et
vice versa.' D e quelle utilité seroit une carte tracée d’après ces principes , sur les seuls exemples
que nous pouvons citer!
i
I
I
i