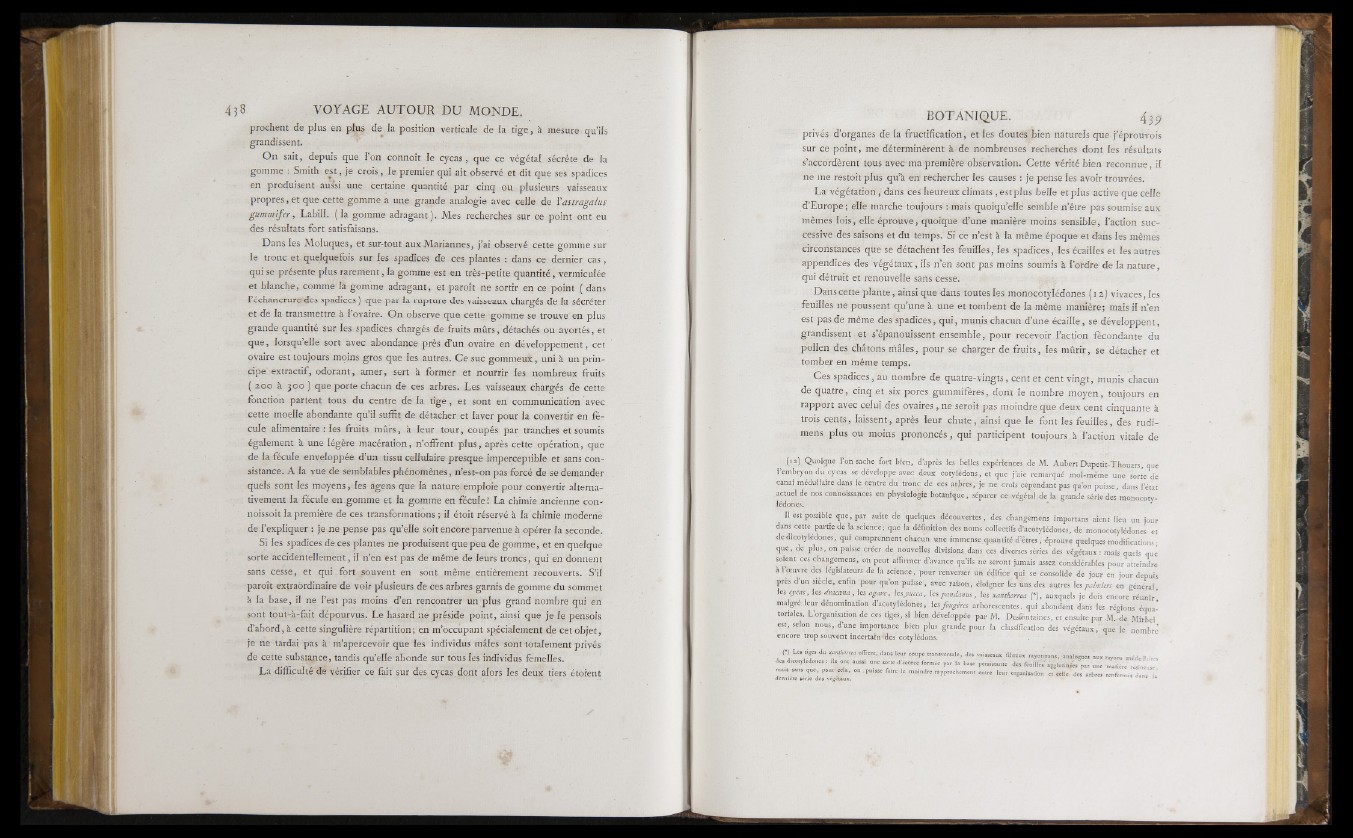
prochent de plus en plus de la position verticale de la t ig e , à mesure q u ’ils
grandissent.
O n sait, depuis que l’on connoît le c y c a s , que ce v ég éta l sécrète de la
gomme : Smith e s t , je c ro is , le premier qui ait observé et dit que ses spadices
en produisent aus’si une certaine quantité par cinq ou plusieurs vaisseaux
p ro p re s , et que cette gomme a une grande analogie avec celle de Vastragalus
gummifcr, Labill. ( la gomme adra g ant). M es recherches sur ce point ont eu
des résultats fort satisfaisans.
Dans les M o lu q u e s , et sur-tout aux Mariannes, j ’ai observé cette gomme sur
ie tronc et quelquefois sur les spadices de ces plantes : dans ce dernier cas ,
qui se présente plus rarement, la gomme est en très-petite quan tité , vermiculée
et b lanche, comme la gomme adragant, et paroît ne sortir en ce point ( dans
l ’échancrure des spadices ) que par la rupture des vaisseaux chargés de la sécréter
et de la transmettre à l ’ovaire. O n obseiTe que cette gomme se trouve en plus
grande quantité sur les spadices ch.argés de fruits mûrs, détachés ou avortés, et
q u e , lorsqu’elle sort avec abondance près d’un ovaire en d év e lo p p em en t, cet
ovaire est toujours moins gros que les autres. C e suc g om m eu x , uni à un p r incipe
extractif, od o rant, amer, sert k former et nourrir les nombreux fruits
( 200 à 300 ) que porte chacun de ces arbres. Les vaisseaux chargés de cette
fonction pan en t tous du centre de la tige , et sont en communication avec
cette moelle abondante qu’il suffit de détacher et laver pour la convertir en fé cu
le alimentaire : les fruits m ûrs, à leur tou r , coupés par tranches et soumis
également à une légère macération, n’offrent p lu s , après cette opération, que
de la fécule enveloppée d’un tissu cellulaire presque imperceptible et sans consistance.
A ia vue de semblables phénomènes, n’est-on pas forcé de se demander
quels sont les m o y en s , les agens que la nature emploie pour convertir alternativement
la fécule en gomme et la gomme en fécule ! La chimie ancienne con-
noissoit la première de ces transformations ; il étoit réservé à la chimie moderne
de l ’expliquer : je ne pense pas qu’elle soit encore parvenue à opérer la seconde.
Si ies spadices de ces plantes ne produisent que p eu de g om m e , et en quelque
sorte accidentellement, il n’en est pas de même de leurs troncs, qui en donnent
sans cesse, et qui fort souvent en sont même entièrement recouverts. S’il
paroît extraordinaire de voir plusieurs de ces arbres garnis de gomme du sommet
k ia base, il ne l’est pas moins d’en rencontrer un plus grand nombre qui en
sont tout-à-fait dépourvus. Le hasard ne préside p o in t, ainsi que je le pensois
d’abord, à cette singulière répartition; en m’occupant spécialement de cet o b je t,
je ne tardai pas à m’apercevoir que ies individus mâles sont totalement privés
de cette substance, tandis qu’elle abonde sur tous les individus femelles.
L a difficulté de vérifier ce fait sur des cycas dont alors les deux tiers étoient
privés d’organes de la fructification, et les doutes bien naturels que j ’éprouvois
sur ce p o in t, me déterminèrent à de nombreuses recherches dont les résultats
s’accordèrent tous avec ma première observation. C e t te vérité bien re con n u e, il
ne me restoit plus qu’à en rechercher les causes : je pense les avoir trouvées.
L a v égétation , dans ces heureux climats , e stp lu s b e lle et plus active que celle
d’Europe ; elle marche toujours ; mais quoiqu’elle semble n ’être pas soumise aux
mêmes lo is , elle ép ro u v e , quoique d’une manière moins sensible, l ’action successive
des saisons et du temps. Si ce n’est à la même époque et dans ies mêmes
circonstances que se détachent les feu ille s , les spadices, les écailles et les autres
appendices des vég étaux , ils n ’en sont pas moins soumis à l ’ordre de la n a tu re ,
qui détruit et renouvelle sans cesse.
Dans cette p la n te , ainsi que dans toutes les monocotylédones {12) v iva ce s, les
feuilles ne poussent q u ’une à une et tombent de la mêiue manière; mais il n’en
est pas de même des spadices, q u i, munis chacun d’une é c a iile , se d év e lop p ent,
grandissent et s’épanouissent en semble , pour recevoir l ’action fécondante du
p o llen des chatons niâles , p ou r se charger de fru its , les mûrir, se détacher et
tomber en même temps.
C e s spadices, au nombre de q u atre -vin g ts, cent et cent v in g t , munis chacun
de qu a tre , cinq et six pores gummiféres, dont le nombre m o y en , toujours en
rapport avec celui des ovaires , ne seroit pas moindre que deux cent cinquante à
trois c en ts , laissent, après leur ch u te , ainsi que le font les feu ille s , des rudimens
plus ou moins prononcés , qui participent toujours à l ’action vitale de
(.2) Quoique l’on sache fort bien, d’après ies belles expériences de M. Aubert Dupetit-Thouars, que
i ’embryon du cycas se développe avec deux cotylédons, et que j ’aie remarqué moi-méme une sorte de
canal médullaire d.ans le centre du tronc de ces arbres, je ne crois cependant pas qu’on puisse, dans l'état
actuel de nos connoissances en physiologie botanique, séparer ce végétal de ia grande série des monocotv-
lcdones. ^
Il est possible que, par suite de quelques découvertes, des ch.ingemens impomns aient iieu un jour
dans cette partie de ia science; que ia définition des noms collectifs d’acotylédones, de monocotylédones et
de dicotylédones, qui comprennent chacun une immense quantité d’ètres , éprouve quelques modifications ;
que. de plus, on puisse créer de nouvelles divisions dans ces diverses séries des végétaux ; mais quels que
soient ces changemens, on peut affirmer d’avance qu’ils ne seront jamais assez considérables pour atteindre
à l’eruvre des législateurs de la science, pour renverser un édifice qui se consolide de jour en jour depuis
près d’un slccle, enfin pour qu’on puisse, avec raison, éloigner les uns des autres les palmiers en général
les cycas. les , les agave, Vsyvcca, pandanvs. les xaathorrea (*}, auxquels je dois encore réunir’
maigre leur dénomination d’acotylédones, ies/cgères arborescentes, qui abondent dans les récrions équa’
tonales. L'organisation de ces tiges, si bien développée par M. Dcs&mtaines, et ensuite par -.M..°de Mirbe'l
est, scion nous, d’une importance bien plus grande pour la classification des végétaux, que ie nombre
encore trop souvent incertain des cotylédons.
(*) Les tiges du xcnthoirt
■ om-cu, Ja,.s Iccr coapc transversale, des vaisseaux r.I.rcox r.ryonnans, analogues aux r.ryons médull Cr,
des dieotylcdoucs : ils ont
USS, une sorte H'ieoree formic par la base persistante des feuilles'ag.lu.ioé'es pa, une „ratière resiueuse
m.iis sans que, pour cela,
.1. poisse faire ic .„oindre rapprodicmcnt entre leur organisation et celle des arbre, renfernu, dans I
dernière série des végétaux.