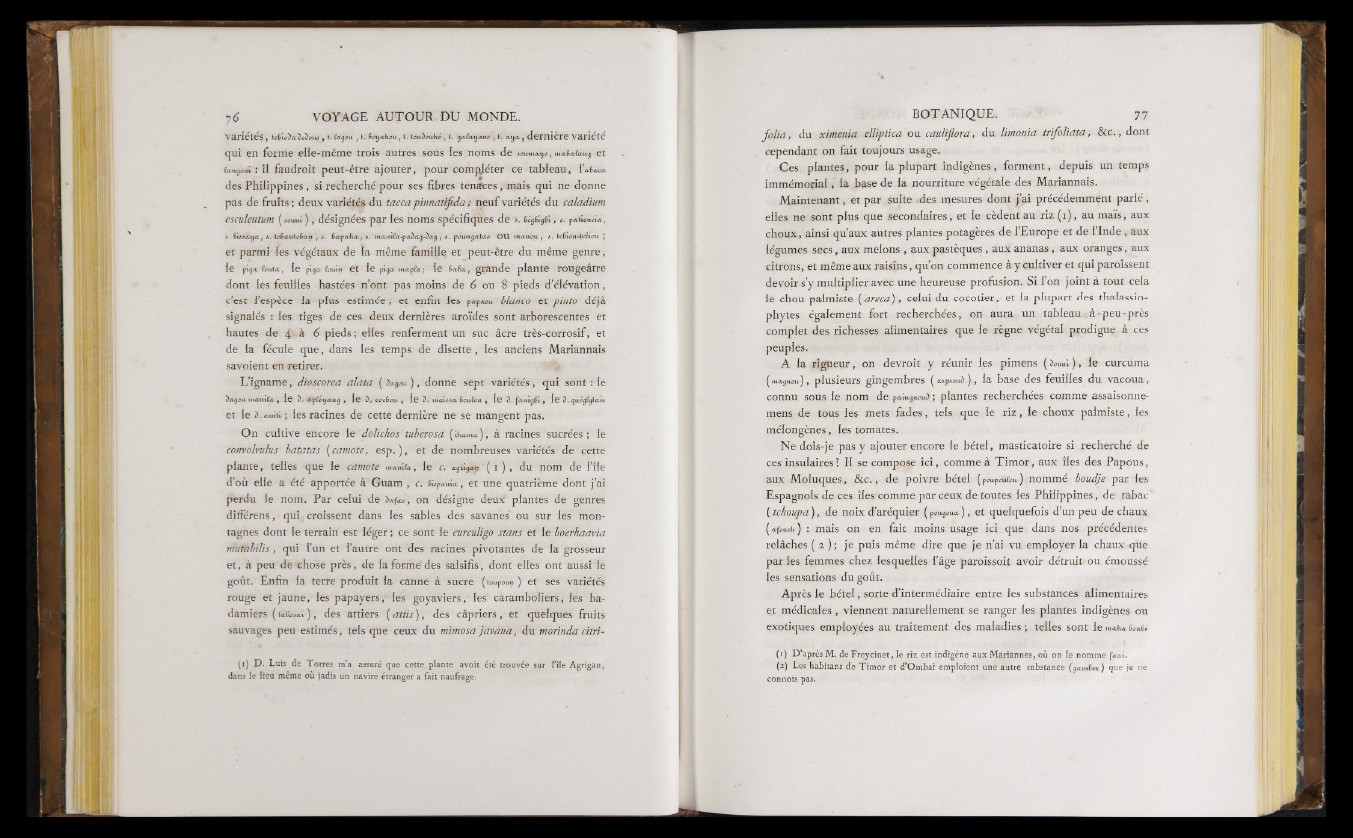
variétés, ktU’iaWciu , t. fagfii, i. icyahoii, t. toiiJouiiJ, h. guttijaiic, t. aija, deiTiiere vai'iété
qui en forme elle-même trois autres sous les noms de jouu.wyi, iiiittafaiu, et
fctiig«,;. : il faudroit peut-être ajouter, pour compléter ce tableau, Dtaca
des Philippines, si recherché pour ses fibres tenaces, mais qui ne donne
pas de fruits; deux variétés du tacca pinnatifida ; neuf variétés du caladium
esculentum (.tou,.; ) , désignées par les noms spécifiques de 4. tôgêigti, 4. pcule.«;«,
i.', b. tcÊaiitcéa^ , é«. 6apak«x, i. iiiain^x-paicc^-iacj / b. poutiiiatao OU. iiiaiiou , b. fc&icuTc&icu ,
et parmi les végétaux de ia même famille et peut-être du même genre,
le piga fcuKx, ie plga Luip 6t le piga. iiiapEa; le 60.60,, grande plante rougeâtre
dont les feuilles hastées n’ont pas moins de ô ou 8 pieds d’élévation,
c’est l’espèce la plus estimée ; et enfin les popooo hlanco et pinto déjà
signalés : les tiges de ces deux dernières aroïdes sont arborescentes et
hautes de 4 à ô pieds ; elles renferment un suc âcre très-corrosif, et
de ia fécule q u e , dans les temps de disette , les anciens Mariannais
savoient en retirer.
L ’igname, dioscorea alata ( 3ogo.i ) , donne sept variétés, qui sont : le
Dogoti iiiamto , le D. oep6éi(Oiig , le t), cocêou , le c). iiiaiiJiC ËouCou , le t). [’a.iitgÊl , Ic t).
et le i. ainti ; les racines de cette dernière ne se mangent pas.
On cultive encore le dolichos tulerosa (ihomo), à racines sucrées; le
convolvulus batatas [camote, e sp .) , et de nombreuses variétés de cette
plante, telles que le camote n.oi.lfa, le c, ogiigop ( i ) , du nom de l’île
d’où elle a été apportée à Guam , C. êwpaHio. , et une quatrième dont j’ai
perdu le nom. Par celui de iofo», on désigne deux plantes de genres
différens, qui croissent dans les sables des savanes ou sur les montagnes
dont le terrain est léger ; ce sont le curcuïigo stans et le boerhaavia
mutabilis, qui l’un et i’autre ont des racines pivotantes de la grosseur
et, à peu de chose près, de la forme des salsifis, dont elles ont aussi le
goût. Enfin la terre produit la canne à sucre (loupoup) et ses variétés
rouge et jaune, les papayers, les goyaviers, les caramboiiers, ies badamiers
( tafL!4at ) , des attiers ( attis ) , des câpriers , et quelques fruits
sauvages peu estimés, tels que ceux du mimosa javana, du morinda citri-
(i) D . Luis de Terres m’a assuré que cette plante avoit été trouvée sur l’île Agrigan,
dans le lieu même où jadis un navire étranger a fait naufrage.
fo lia , du ximenia elliptica ou caulifiora, du limonia trifoliata, & c . , dont
cependant on fait toujours usage.
Ces plantes, pour la plupart indigènes, forment, depuis un temps
immémorial , la base de la nourriture végétale des Mariannais.
Maintenant, et par suite des mesures dont j’ai précédemment p a r lé ,
elles ne sont plus que secondaires, et le cèdent au riz ( i ) , au maïs, aux
choux, ainsi qu’aux autres plantes potagères de l’Europe et de l’Inde , aux
légumes sec s, aux melons , aux pastèques , aux ananas , aux oranges, aux
citrons, et même aux raisins, qu’on commence à y cultiver et qui paroissent
devoir s’y multiplier avec une heureuse profusion. Si l’on joint à tout cela
le chou palmiste {a re ca ), celui du cocotier, et la plupart des thalassio-
phytes également fort recherchées, on aura un tableau à-peu-près
complet des richesses alimentaires que le règne végétal prodigue à ces
peuples.
A la r igueur, on devroit y réunir les pimens ( 3ouul ) , le curcuma
(M,<tg.imi), plusieurs gingembres ( odgitotii) ) , la base des feuilles du v a co u a ,
connu sous le nom de paUignouJ ; plantes recherchées comme assaisonne-
mens de tous les mets fad e s, tels que ie r i z , le choux palmiste, les
mélongènes, les tomates.
N e dois-je pas y ajouter encore ie bétel, masticatoire si recherché de
ces insulaires ! Il se compose i c i , comme à T im o r , aux îles des Papous,
aux Moluques, & c . , de poivre bétel (poupoufou) nommé boudje par les
Espagnols de ces îles comme par ceux de toutes les Philippines, de tabac
( tchoupa ) , de noix d’aréquier ( pcgm.® ) , et quelquefois d’un peu de chaux
( afùuciv ) : mais on en fait moins usage ici que dans nos précédentes
relâches ( 2 ) ; je puis même dire que je n’ai vu employer la chaux que
par les femmes chez lesquelles l’âge paroissoit avoir détruit ou émoussé
les sensations du goût.
Après ie b é te l, sorte d’intermédiaire entre les substances alimentaires
et médicales , viennent naturellement se ranger les plantes indigènes ou
exotiques employées au traitement des maladies ; telles sont le mai,a 6ou66
(1) D ’après M. de F re y c in e t, le riz est indigène aux Mariannes, où on le nomme faai.
(2) Les habitans de T im o r et d’Ombai emploient une autre substance (¿lautSer) que je ne
connois pas.
t