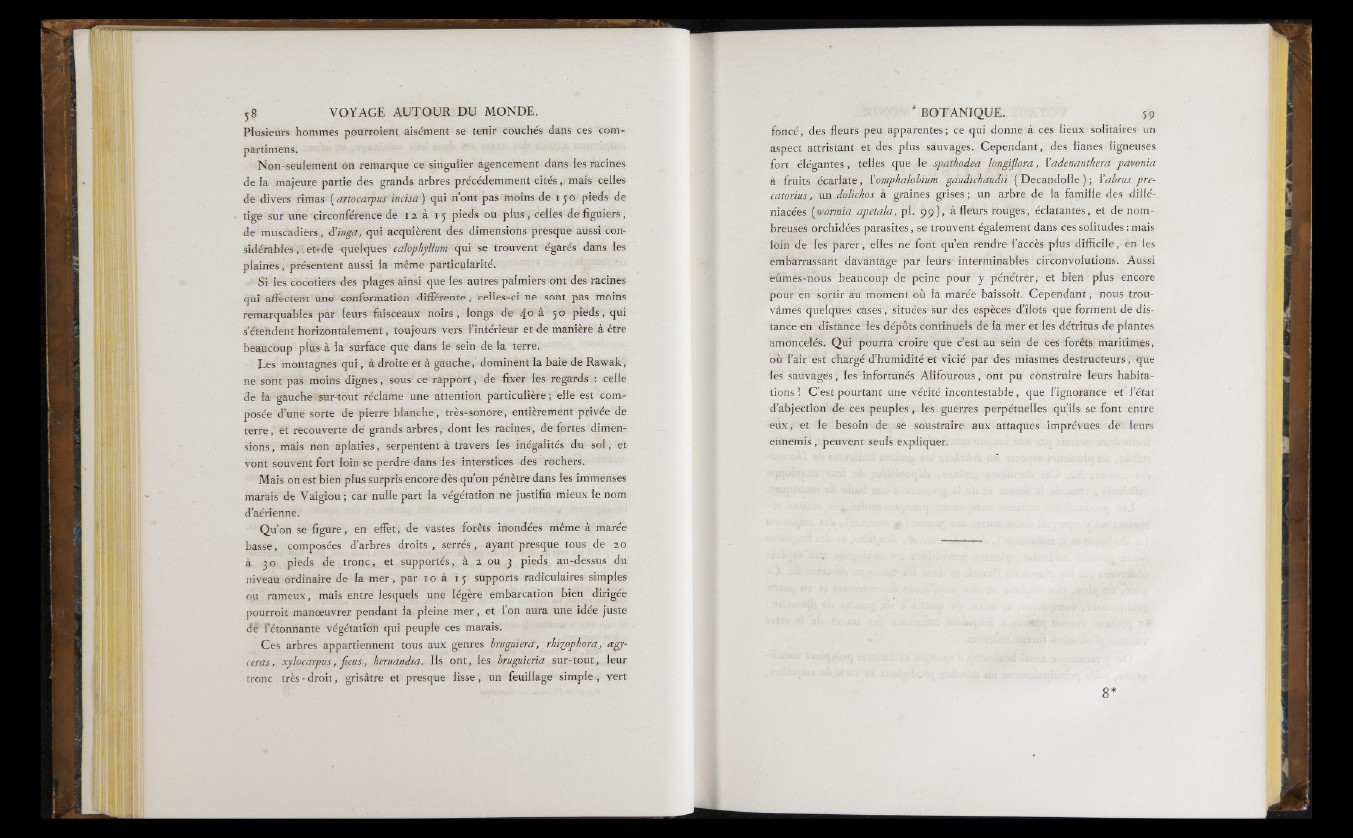
' 'i■fFil.» !, T: .1 ■ ,,'K, ' lin.!;',
'ilir :
Ik ■
Plusieurs hommes pourroient aisément se tenir couchés dans ces com-
partimens.
Non-seulement on remarque ce singulier agencement dans les racines
de la majeure partie des grands arbres précédemment c ité s , mais celles
de divers rimas ( artocarpus incisa ) qui n’ont pas moins de i 5 o pieds de
tige sur une circonférence de 1 2 à i 5 pieds ou plus , celles de figuiers,
de muscadiers, ^inga, qui acquièrent des dimensions presque aussi considérables
et-de quelques calophyllum qui se trouvent égarés dans les
plaines, présentent aussi la même particularité.
Si les cocotiers des plages ainsi que les autres palmiers ont des racines
qui affectent une conformation différente, celles-ci ne sont pas moins
remarquables par leurs faisceaux noirs, longs de 4 ° à 50 pieds, qui
s’étendent horizontalement, toujours vers l’intérieur et de manière à être
beaucoup plus à la surface que dans le sein de la terre.
Les montagnes q u i, à droite et à gauche, dominent la baie de Rawak,
ne sont pas moins dignes, sous ce rapport, de fixer les regards : celle
de la gauche sur-tout réclame une attention particulière ; elle est composée
d’une sorte de pierre blanche, très-sonore, entièrement privée de
terre, et recouverte dé grands arbres, dont les racines, de fortes dimensions
, mais non aplaties, serpentent à travers les inégalités du s o l , et
vont souvent fort loin se perdre dans les interstices des rochers.
Mais on est bien plus surpris encore dès qu’on pénètre dans les immenses
marais de Vaigiou ; car nulle part la végétation ne justifia mieux le nom
d’aérienne.
Q u ’on se figure, en effet, de vastes forêts inondées même à marée
basse, composées d’arbres d ro its , serrés, ayant presque tous de 20
à 30 pieds de tronc, et supportés, à 2 ou 3 pieds au-dessus du
niveau ordinaire de la mer , par i o à 15 supports radiculaires simples
ou rameux, mais entre lesquels une légère embarcation bien dirigée
pourroit manoeuvrer pendant la pleine m e r , et l’on aura une idée juste
de l’étonnante végétation qui peuple ces marais.
Ces arbres appartiennent tous aux genres hruguiera, rhiiophora, ægy-
ceras, xylocarpus, ficus, hernandia. Ils ont, les bruguieria sur-tout, leur
tronc très - dro it, grisâtre et presque lis se , un feuillage simple , vert
foncé, des fleurs peu apparentes; ce qui donne à ces lieux solitaires un
aspect attristant et des plus sauvages. Cependant, des lianes ligneuses
fort élégantes , telles que ie spathodea longifiora, [’adenanthera pavonia
à fruits écarlate , Xomphalohium gaudichaudii ( Decandolle ) ; Xahrus pre-
catorius, un dolichos à graines grises; un arbre de la famille des diilé-
niacées [wormia apetala, pl. 9 9 ) , à fleurs rouges, éclatantes, et de nombreuses
orchidées parasites , se trouvent également dans ces solitudes : mais
loin de les pa rer, elles ne font qu’en rendre l’accès plus difficile, en les
embarrassant davantage par leurs interminables circonvolutions. Aussi
eûmes-nous beaucoup de peine pour y pénétrer, et bien plus encore
pour en sortir au moment où la marée baissoit. C epend ant, nous trouvâmes
quelques cases, situées sur des espèces d’îlots que forment de distance
en distance les dépôts continuels de la mer et les détritus de plantes
amoncelés. Q ui pourra croire que c’est au sein de ces forêts maritimes,
où l’air est chargé d’humidité et vicié par des miasmes destructeurs, que
les sauvages , les infortunés Aiifou rous, ont pu construire leurs habitations
î C ’est jrourtant une vérité incontestable, que l’ignorance et l ’état
d’abjection de ces peuple s , les guerres perpétuelles qu’ils se font entre
eu x, et le besoin de se soustraire aux attaques imprévues de leurs
ennemis , peuvent seuls expliquer.