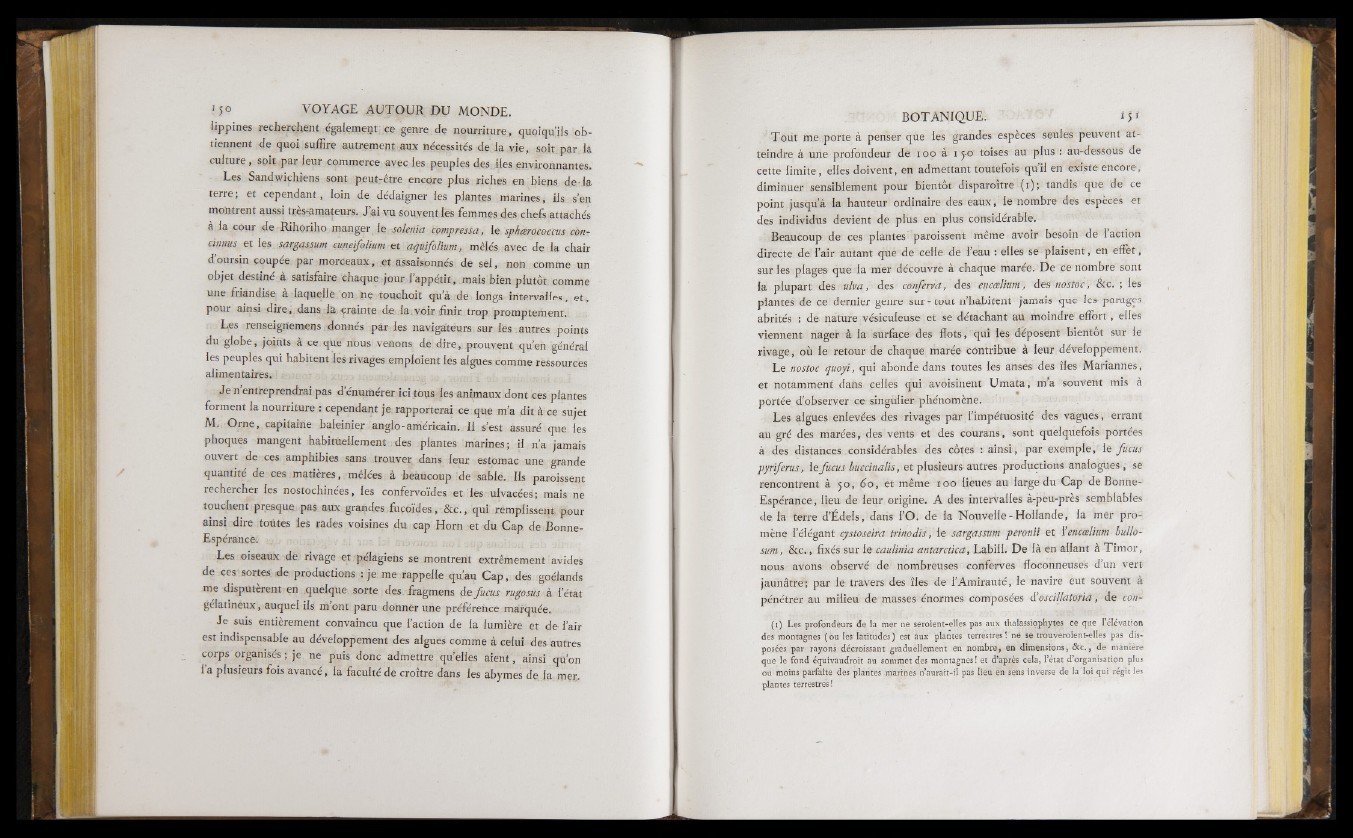
iippines recherchent également ce genre de nourriture, quoiqu’ils obtiennent
de quoi suffire autrement aux ne'cessités de ia v ie , soit par la
culture , soit par leur commerce avec les peuples des îles environnantes.
Les Sandwichiens sont peut-être encore plus riches en biens de la
terre ; et cependant, loin de dédaigner les plantes marines, ils s’en
montrent aussi très-amateurs. J’ai vu souvent les femmes des chefs attachés
à la cour de Rihoriho manger le solenia compressa, le spharococcus concinnus
et les sargassum cuneifolium et aquifolium, mêlés avec de la chair
d’oursin coupée par morceaux, et assaisonnés de s e l, non comme un
objet destiné à satisfaire chaque jour l’appétit, mais bien plutôt comme
une friandise à laquelle on ne touchoit qu’à de longs intervalles, e t ,
pour ainsi dire, dans la crainte de la voir finir trop promptement.
Les renseignemens donnés par les navigateurs sur les autres points
du globe, joints à ce que nous venons de dire, prouvent qu’en général
les peuples qui habitent les rivages emploient les algues comme ressources
alimentaires.
Je n’entreprendrai pas d’énumérer ici tous les animaux dont ces plantes
forment la nourriture : cependant je rapporterai ce que m’a dit à ce sujet
M. O rn e , capitaine baleinier anglo-américain. II s’est assuré que les
phoques mangent habituellement des plantes marines; il n’a jamais
ouvert de ces amphibies sans trouver dans leur estomac une grande
quantité de ces matières, mêlées à beaucoup de sable. Ils paroissent
lechercher les nostochinées, les confervoïdes et ies ulvacées; mais ne
touchent presque pas aux grandes fucoïdes, & c . , qui remplissent pour
ainsi dire toutes les rades voisines du cap Horn et du Cap de Bonne-
Espérance.
Les oiseaux de rivage et pélagiens se montrent extrêmement avides
de ces sortes de productions : je me rappelle qu’au C a p , des goélands
me disputèrent en quelque sorte des fragmens àe fucus rugosus à l’état
gélatineux, auquel ils m’ont paru donner une préférence marquée.
Je suis entièrement convaincu que l’action de la lumière et de l’air
est indispensable au développement des algues comme à celui des autres
corps organisés ; je ne puis donc admettre quelles a ien t, ainsi qu’on
l ’a plusieurs fois avancé, ia faculté de croître dans les abymes de la mer.
T o u t me porte à penser que les grandes espèces seules peuvent atteindre
à une profondeur de lo o à i yo toises au plus : au-dessous de
cette limite, elles doivent, en admettant toutefois q u il en existe encore,
diminuer sensiblement pour bientôt disparoître ( i) ; tandis que de ce
point jusqu’à ia hauteur ordinaire des e au x , le nombre des espèces et
des individus devient de plus en plus considérable.
Beaucoup de ces plantes paroissent même avoir besoin de I action
directe de l’air autant que de celle de l’eau : elles se plaisent, en e ffe t ,
sur les plages que la mer découvre à chaque marée. De ce nombre sont
la plupart des ulva, des conferva, des encoelium, des nostoc, &c. ; les
plantes de ce dernier genre sur - tout n’habitent jamais que les parages
abrités : de nature vésiculeuse et se détachant au moindre e ffo r t, elles
viennent nager à la surface des flots, qui ies déposent bientôt sur le
rivage, où le retour de chaque marée contribue à leur développement.
Le nostoc quoyi, qui abonde dans toutes les anses des îles Mariannes,
et notamment dans celles qui avoisinent Umata, m’a souvent mis à
portée d’observer ce singulier phénomène.
Les algues enlevées des rivages par l’impétuosité des vagues, errant
au gré des marées, des vents et des courans, sont quelquefois portées
à des distances considérables des côtes : ainsi, par exemple, le fucus
pyriferus, le fucus buccinalis, et plusieurs autres productions analogues, se
rencontrent à 50, 60, et même 100 lieues au large du Cap de Bonne-
Espérance , iieu de leur origine. A des intervalles à-peu-près semblables
de la terre d’É dels, dans l’O . de la N ou v e lle -H o llan d e , la mer promène
l’élégant cystoseira trinodis, le sargassum peronii et Xencoelium hullo-
smn, & c , , fixés sur le caulinia antárctica, Labill. De là en allant à Timor,
nous avons observé de nombreuses conferves floconneuses d’un vert
jaunâtre; par le travers des îles de l’Amirauté, le navire eut souvent à
pénétrer au milieu de masses énormes composées dXoscillatoria, de con-
( i) Les profondeurs de !a mer ne seroient-elles pas aux thalassiophytes ce que l’élévation
des montagnes (o u les latitudes) est aux plaiîtes terrestres! ne se trouveroient-elles pas disposées
par rayons décroissant graduellement en nombre, en dimensions, & c . , de manière
que le fond équivaudroit au sommet des montagnes! et d ’après cela, l’état d’organisation plus
ou moins parfaite des plantes marines n’aurait-il pas lieu en sens inverse de la loi qui régit ies
plantes terrestres!